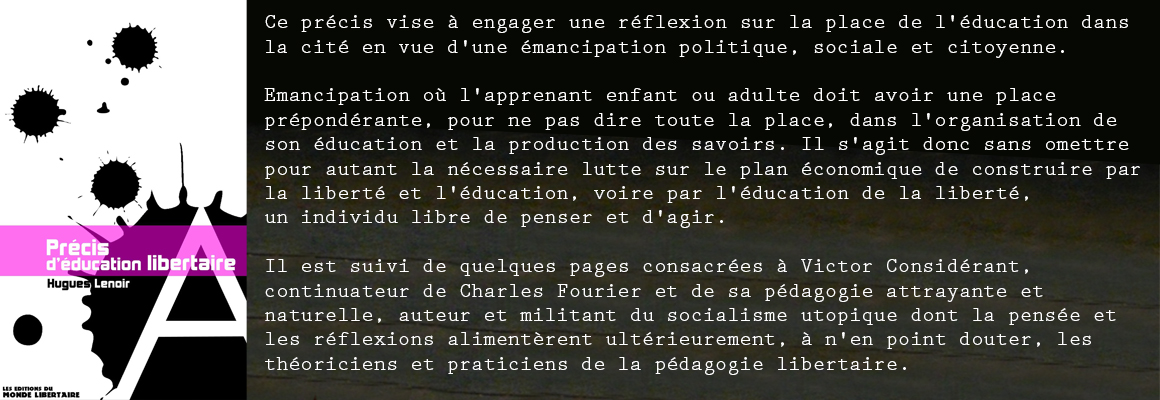Syndicalisme et Formation :
une histoire en tension
Il ne saurait être question dans cet article de seulement reprendre les grands thèmes du colloque que nous avons organisé à l’Université de Nanterre sur la question du lien entre syndicalisme et formation[1]. Nous tenterons, en évoquant précisément certains aspects de ce colloque, d’en élargir la problématique en offrant ici d’autres éclairages permettant de mieux comprendre le lien étroit et dialectique qui associent ces deux composantes – le syndicalisme et l’éducation – qui en s’interpénétrant œuvrent à une toujours plus large autonomie individuelle et collective.
En étudiant les rapports que le fait syndical entretient avec le fait éducatif, il apparaît assez rapidement que selon les époques, les idéologies qui animent le syndicalisme, la conscience des militants et le projet sociétaire, l’articulation entre les deux termes est l’objet de plus ou moins de tension, plus ou moins de consensus. Nous ne reviendrons pas sur l’origine du syndicalisme[2] où l’éducation est strictement associée au travail d’émancipation au point qu’elle en devient l’un des leviers principaux. Il est vrai qu’à l’époque le syndicalisme, suite à la Charte d’Amiens (1905) qui rend inopérantes les visées guesdistes d’utilisation du syndicat à des fins partidaires, est encore unifié et animé de sa mission éducatrice et par conséquent émancipatrice.
Pour éclairer notre propos, quant aux postures évolutives, historiquement et contextuellement datées du syndicalisme, des syndicalismes serait-il plus juste d’écrire aujourd’hui, nous évoquerons une autre période où la formation et l’éducation permanente furent au cœur de la réflexion syndicale. Cette période est celle où se discuta et se négocia l’accord interprofessionnel de juillet 1970 et d’où découla la loi sur le droit à la formation de juillet 1971. Nous aurions pu utiliser les textes de la période actuelle autour de la réduction du temps de travail, des 35 heures et de la Loi dite Aubry mais nous manquons de recul. Comme, nous aurions pu choisir la loi de 1959 sur la promotion sociale ou celle de décembre 1966 qui octroie au travailleur le droit de bénéficier d’un congé éducation. Mais la loi de 1971, petite fille des événements de mai 1968 plutôt que loi Aubry II et son article 17, enfant abandonné à l’issue de trente ans d’offensive libérale, nous est apparue plus symptomatique et surtout plus facile d’usage quant à notre tentative de description des postures évolutives et des constantes des représentations syndicales.
Accord interprofessionnel de 1970 et Loi de 1971 : le compromis historique[3]
La loi de juillet 1971 à dire vrai aurait sans doute vu le jour, tant le consensus était grand, sans les journées noires et rouges du printemps 1968. Elle est en quelque sorte l’aboutissement de plusieurs années de réflexions, d’accords et de textes législatifs sur la question de la formation permanente du Travail, mai 1968 ne permit que quelques inflexions. Cette loi est en fait le résultat d’un besoin et d’une exigence qui, conjoncturellement dans une période économique faste, se conjuguent et annulent (provisoirement) les termes de la contradiction[4], au moins sur ce point, entre le capital et le travail. En d’autres termes, au fait des trente glorieuses malgré les sursauts de la rue Gay Lussac, le patronat français a besoin, souhaite et a les moyens d’adapter, voire de promouvoir, une partie de la main d’œuvre pour faire face au développement économique et à la modernisation liés à la société dite de consommation. La formation sera pour lui un investissement, la réponse au besoin d’adaptation d’une main d’œuvre toujours plus qualifiée. De son côté, le syndicalisme éclaté (après la scission de la C.G.T. en 1947 et celle de la CFTC en 1964) est encore fort de ses valeurs, celles d’Emile Pouget sans doute mais surtout celles des maquis et de la Libération héritées des grands anciens. L’exigence est de toujours : plus d’éducation et de formation, non seulement elles favorisent la reconnaissance et la protection du travail mais surtout, à terme, elles permettent de dessiner en filigranes une société plus libre et plus juste. Dans l’attente, elle sera l’occasion pour beaucoup de se saisir d’une deuxième chance – que l’on sait largement illusoire aujourd’hui – pour se promouvoir et surtout pour accéder à la connaissance libératrice. En bref, cette loi, n’est que le résultat d’une conjonction favorable d’intérêts divergents. Qu’en disent à l’époque les acteurs sociaux, patronat et syndicats ?
Malgré la remarque de Yves Palazzeschi sur l’évolution critiques des positions des acteurs sociaux au cours des années qui ont suivi la négociation et le vote sur la formation, les textes dont nous nous inspirons, et qu’il a exhumés, éclaireront notre hypothèse. En effet, même si nous ne nous appuyons pour la formuler sur des sources lacunaires rappelons que Yves Palazzeschi considère le texte retenu – que nous utiliserons – pour chacune des organisations comme celui rendant “le mieux compte de la doctrine[5]” de chacune d’entre elles. Affirmation qui confère une forme de représentativité à ces textes et, qui du même coup, limite l’espace des interprétations tout en ouvrant de nouvelles pistes de recherche sur les rapports complexes que le syndicalisme entretient avec la formation.
�La position patronale
Avant d’analyser les positions syndicales et afin de mieux les comprendre, observons tout d’abord le discours du patronat français. Pour le C.N.P.F. (aujourd’hui M.E.D.E.F.) en 1970, la cause est entendue : “diriger une entreprise, c’est d’abord diriger des hommes. Négliger la formation, c’est renoncer à diriger”[6]. L’acte de formation est un acte de direction qui à l’époque ne se partage pas, qui ne se co-investit pas, comme en attestera longtemps le livre IX du code du travail. Il n’est plus question de laisser au salarié une part de responsabilité quant au développement et au maintien de sa compétence (le mot est déjà utilisé). La formation est déjà pensée comme un atout stratégique, comme un facteur de compétitivité. En effet, ajoute François Ceyrac, le “patron des patrons” comme l’on dit alors, “sur le plan économique d’abord, nous en arrivons à ce stade de développement économique où l’augmentation de qualification et de compétences constitue le facteur de croissance le plus influent (…). Il serait incohérent pour le patronat de pousser à l’industrialisation, de chercher à augmenter la productivité, de vouloir de meilleures possibilités de financement tout en négligeant cet immense réservoir de richesses que sont les hommes. C’est pourquoi l’investissement éducatif s’inscrit désormais au premier plan des investissements rentables[7], la formation et le perfectionnement des hommes sont les outils de l’expansion et les instruments de la croissance économique”[8]. En bref, cet accord et cette démarche s’inscrivent “dans la continuité d’une action pédagogique menée par de très nombreuses entreprises”[9].
Notons qu’à l’époque, le patronat largement influencé par le projet d’un capitalisme participatif cher au général De Gaulle et à l’association Capital-Travail que cela sous-entend donne, lui aussi une chance à la deuxième chance et s’inscrit dans la lutte contre la fracture sociale que certains sentent déjà poindre. Il s’agit donc poursuit François Ceyrac de faire en sorte que la formation rétablisse un peu d’égalité entre les travailleurs. “Il n’est pas possible en effet d’admettre que notre système économique fasse coexister d’une part des travailleurs qui, du fait de leur emploi, continuent à accroître leur qualification en face d’autres qui, pour les mêmes raisons, stagnent ou régressent sur le plan de la compétence et se trouvent progressivement poussés dans la catégorie des indésirables de l’emploi. L’accord (sur la formation) devrait donc chercher à rendre cette seconde catégorie d’hommes et de femmes moins vulnérables à toutes les fluctuations de l’emploi qu’engendre un progrès industriel rapide et à les maintenir aptes à participer activement à la croissance, en leur apportant une compétence accrue”[10]. Enfin, il reconnaît que la formation sera un bénéfice pour toutes les entreprises mais que de toute façon le problème de la formation était posé et que si “nous (le patronat) ne nous étions pas occupés, une solution aurait été apportée. Le sens profond de l’accord du 9 juillet c’est que la solution sera trouvée avec nous, non pas sans nous ou contre nous[11]“. A l’époque, la formation est une chose trop sérieuse pour la laisser à l’initiative de l’Etat mais surtout de la négliger au risque que les travailleurs ne s’en occupent seuls. Il s’agit donc de passer un compromis équilibré avec les organisations syndicales afin que les intérêts du Capital (surtout) et du Travail soient préservés.
L’oubli de la C.G.T.
Quant à la C.G.T., organisation la plus puissante à l’époque, héritière directe de Fernand Pelloutier et des Bourses du Travail qui firent de l’éducation un des outils privilégiés du syndicalisme d’émancipation, elle réaffirme la rupture déjà consommée depuis longtemps avec le syndicalisme des origines, qui dans la tradition proudhonienne se défiait de l’état. En effet, en 1970, la Confédération Générale du Travail considère “que la formation et le perfectionnement professionnel entrent dans le cadre des devoirs et des obligations de l’Etat en matière d’Education nationale (…) et regrette qu’en grande partie, les réalisations actuelles soient laissées à l’initiative privée, notamment patronale, insuffisante, dispersée, et de valeur très inégale”[12]. Point d’émancipation et d’éducation par les travailleurs eux-mêmes, l’Etat providence doit répondre à toutes les attentes et satisfaire tous les besoins même si de manière incantatoire la C.G.T. réaffirme régulièrement que pour elle, “l’accord de juillet 1970 et la loi de juillet 1971 n’étaient pas des textes sacrés, immuables, mais comme tous les textes, le résultat d’un compromis et l’objet d’un enjeu de classe”[13]. Bien que renonçant aux intérêts futurs de la classe ouvrière la C.G.T. veille aux intérêts immédiats du travail, ceux dont elle se sent encore porteuse après avoir laisser l’initiative transformatrice à d’autres sphères du politique. Elle confirme, elle aussi dans une vision prospective que “pour l’ensemble des travailleurs, confrontés aux transformations rapides des conditions de production, il est indispensable de leur donner les moyens de renouveler et d’enrichir en permanence leurs connaissances[14]“. Il s’agit donc de prévenir des évolutions industrielles aux conséquences néfastes et d’anticiper “des transferts importants de main d’œuvre (qui engendreront) de nouvelles et graves difficultés pour les adaptations massives aux nouvelles techniques (…). En conséquence, (les salariés) sont fondés à réclamer des garanties légales et des possibilités concrètes, assorties de mesures sociales appropriées, susceptibles de permettre et de faciliter leur adaptation et leur conversion”[15] . En outre, la C.G.T. insiste sur le fait de la nécessaire reconnaissance de la formation et déclare que “les connaissances acquises (…), sanctionnées par un diplôme, (seront considérées) comme une garantie de qualification, donc de rémunération[16]“.
Il s’agit donc bien d’anticiper et de préparer la main d’œuvre aux évolutions de l’appareil de production, afin que les conditions de travail soient les moins pénibles possibles et les conversions les moins génératrices de souffrances et les salaires plus élevés. Néanmoins, au-delà de cette stricte logique réformiste, en termes feutrés, mais pouvait-il en être autrement, réapparaissent quelques traces d’un temps où le syndicalisme et à son service la formation avait d’autres ambitions. Ainsi, pour la confédération, “la nécessité de la formation et du perfectionnement professionnels répond à des besoins sociaux affirmés avec de plus en plus de force. Les travailleurs dans leur masse sont très sensibles au besoin d’élever leur niveau de formation et à l’avantage qu’ils doivent en tirer, tant en ce qui concerne leur rémunération que leurs responsabilités[17]“. De quelles responsabilités est-il question ? Sont-ce les dernières traces d’un souhait maquisard de promotion sociale, celles du grand soir autogestionnaire, ou n’est-ce ici qu’une formule de circonstance, au lecteur averti d’en décider. D’autres textes de la CGT attesteraient sans doute du lien permanent qu’elle tisse et entend maintenir entre Education et Emancipation. Néanmoins, l’absence d’une allusion explicite à cette dimension, dans ce mémorandum au Premier Ministre publié de la Confédération Générale du Travail, nous a paru suffisamment significative, même si celle-ci n’était que conjoncturelle, pour que nous la soulignions.
Le soubresaut de la C.G.T.-F.O.
Contradictoirement en 1972, la C.G.T.-Force Ouvrière, animée d’une longue tradition réformiste depuis Léon Jouhaux développe pour une part un discours décalé par rapport à son mode d’action mais en accord avec ses statuts même si ces derniers sont méconnus du plus grand nombre. Pour F.O., la loi de 1971 s’inscrit dans la lignée éducationniste dont se réclame une partie du mouvement ouvrier. La confédération considère donc “qu’il n’est pas excessif de prétendre” que le droit à la formation est “un acte révolutionnaire qui peut se traduire, à terme, par des transformations profondes de notre société. Il dépendra donc largement des travailleurs eux-mêmes et de leurs organisations syndicales que ce droit soit utilisé judicieusement aux fins d’améliorer leur degré de connaissances et de jugement, de favoriser leur esprit de décision et leur sens des responsabilités et de concourir ainsi à leur promotion et à leur émancipation[18]“. Si éducation permanente rime avec émancipation, elle peut aussi rimer si le syndicalisme n’y prend pas garde avec subordination. Ainsi, il conviendra d’être vigilant qu’en à l’application de la loi et la gestion du compromis sur la formation. En effet, certaines organisations patronales ont déclaré “vouloir occuper le terrain et de ne laisser à personne d’autres qu’elles le soin de maîtriser l’application de l’accord et ses conséquences”. Le Guide pratique pour les entreprises, édité par le C.N.P.F. ne manque pas de souligner que : “mis à part la consultation préalable du comité d’entreprise, la liberté d’action des chefs d’entreprises est totale”. Il y a donc d’ores et déjà dans le patronat, une tendance nettement marquée à s’approprier un droit prétorien de décision en matière d’organisation et d’orientation des moyens de formation professionnelle[19]“. Et Force Ouvrière de rappeler avec vigueur que “dans l’esprit, tant de l’accord du 9 juillet 1970 que de la loi du 16 juillet 1971, la formation en faveur des adultes ne doivent pas être exclusivement corporatistes et utilitaristes[20]“. Le terme corporatisme, pour ceux qui s’intéressent au fait syndical n’est pas neutre, son emploi est une forme de mise en garde feutrée mais ferme. En conséquence, la centrale syndicale en cohérence avec ses pratiques et la tradition du grain à moudre en appel à un juste partage des responsabilités en matière de formation. Elle convient donc que “certaines typologies de formation du type de l’adaptation ne peuvent être conçues hors des lieux de travail[21]“. Il convient donc d’obtenir partout où cela sera possible “le droit de co-décison[22]“. Cette incitation confédérale à la co-gestion dans la plus pure tradition réformiste implique donc que Force Ouvrière ne peut pas “laisser aux entreprises un droit discrétionnaire et unilatéral de décision en matière de gestion des ressources financières dégagées à ce titre (celui de la formation). Les salariés disposant d’un large droit d’initiative quant au choix des formations auxquelles ils souhaitent recourir, c’est à l’organisation syndicale qu’il doit appartenir de rassembler leurs besoins[23]“. On sait aujourd’hui qu’il n’en fut rien, la co-gestion n’était pas, même en ce qui concerne la formation, à l’ordre du jour. Le C.N.P.F considérant que la formation est un acte de direction qui ni ne se délègue, ni ne se cogère. Seul, quelques années plus tard, le Congé individuel de formation (C.I.F.) viendra engager un coin dans ce droit régalien.
Pour garantir les travailleurs des dérives et des abus patronaux toujours possibles, F.O. souhaite un large recours au service public d’éducation modernisé pour assurer les formations. Mais l’organisation veillera aussi, pour que chacun puisse exercer son droit à la formation, à ce que “la presse, la radio, la télévision (soient) utilisées au mieux pour faire connaître aux travailleurs l’existence de ces lieux d’information auxquels ils pourront s’adresser[24]“. Sur ce point du chemin reste encore à parcourir qu’en on sait depuis plus de dix ans ce qu’il en est du niveau d’information de la population active sur son droit à la formation et à la validation des acquis. Ce qui peut apparaître le plus innovant dans les propositions de cette confédération, c’est son souci de former et d’engager des équipes militantes sur la question de l’éducation permanente. Ainsi, puisqu’elle “ne pourra pas, seule, suivre les développements de l’application des textes sur l’éducation permanente. Un ou plusieurs militants devront être spécialisés dans les fédérations et les unions départementales. A leur intention, la confédération organise actuellement une série de sessions régionales d’une semaine, consacrées à l’étude approfondie des textes et de leurs implications (…). Il est encore envisagé d’organiser ultérieurement des sessions de formation de formateurs qui auront à charge d’améliorer la compétence de nos délégués syndicaux et de nos membres de comités d’entreprise[25]“. Enfin, la confédération Force Ouvrière craignant l’apparition d’un “marché de la formation” veillera à ce que “le droit à la formation ne soit pas exploité à des fins de pur profit et que la formation des hommes, sources de transformations profondes, ne soient pas confiée à des organismes qui n’en ont ni la compétence, ni la vocation[26]“. Avec le recul du temps, ce texte de F.O. étonne à la fois par sa naïveté et sa clairvoyance. Au demeurant, si ces propos sont souvent restés incantatoires, ils s’inscrivent bien dans la trajectoire syndicale de cette organisation écartelée entre une tradition historique et une pratique relevant du pragmatisme.
La C.F.D.T. et le maintien tradition
La toute nouvelle Confédération Française Démocratique du Travail, héritière de la très chrétienne C.F.T.C. porte en matière de formation une double marque. A la fois, celle issue de son passé, plus précisément de Marc Sangnier et du Sillon qui se proposent d’œuvrer à “une rénovation de l’homme et une démocratisation de l’ordre social (et qui pour parvenir à leur fin souhaitent aider) à créer par l’éducation, une élite ouvrière dont l’action transformera la société”[27]. Et celle, de sa minorité autogestionnaire, pour une part issue du mouvement libertaire, qui militera quelques années à la C.F.D.T. avant d’en être exclue ou de la quitter.
En 1972, la C.F.D.T. qui entend se démarquer fortement de la C.G.T. considère la formation comme un levier majeur de changement. Elle renoue ainsi avec la tradition syndicaliste révolutionnaire du début de Xxe siècle. Dans le texte commenté ici[28], cette confédération après avoir rappelé brièvement les intérêts du patronat, car consciente des contradictions et du consensus de la Loi de juillet 1971, rappelle l’ensemble de ces positions sur la formation. En effet, si la C.F.D.T. a bien conscience d’avoir signé un texte de compromis, elle ne saurait être dupe de ce que le C.N.P.F. peut en retirer, elle compte bien faire de la formation un atout majeur de transformation sociale. Selon elle à l’évidence, “pour le patronat, la formation professionnelle continue répond à deux objectifs : assurer un meilleur ajustement des qualifications au marché de l’emploi, aux objectifs de croissance et de rentabilité tels que les conçoivent les entreprises capitalistes ; assurer une conformité entre la politique de formation et l’organisation du travail et de la vie sociale afin de consolider le pouvoir des classes dirigeantes, les structures hiérarchiques, la division sociale et l’organisation du travail[29]“. En termes clairs et sans ambages, “la formation conçue par les patrons, lie les travailleurs aux objectifs de l’entreprise et à l’idéologie dominante[30]“. Certaines de ses mesures confirment d’ailleurs “les inégalités sociales et culturelles (…)[31]” et sur le plan idéologique, “les politiques du patronat et du pouvoir visent à vider de leur contenu nos propres objectifs – en particulier ceux d’un droit inaliénable à la formation[32] – pour les reprendre à leur compte en les dénaturant pour duper les travailleurs[33]“.
Face à cette stratégie patronale, la C.F.D.T. n’entend pas laisser l’initiative et le contrôle de la formation aux seuls employeurs et souligne avec vigueur la double finalité, immédiate et future, de qualification et de transformation, qu’elle souhaite voir jouer à de la formation. Ainsi, ses “perspectives de socialisme démocratique, exigent qu’une formation de qualité soit acquise pour tous les travailleurs. La C.F.D.T. luttera contre tout processus visant à perpétuer ou à former un sous-prolétariat culturel. Ces perspectives imposent une priorité à la formation pour les “laissés pour compte” de la société néo-capitaliste. Il s’agit de concevoir et de réaliser une formation permettant aux personnes : – de développer leur compétence professionnelle, leur permettant de maîtriser leur travail, donc d’influer dans l’immédiat sur leur activité et sur les évolutions techniques (et) – de développer leur compétence fondamentale pour participer aux décisions en se situant mieux dans l’environnement économique, social et politique afin d’agir sur cet environnement, sur la finalité du travail et sur la société en général[34]“. Et la confédération de préciser s’il en était besoin à l’époque que “nous devons permettre aux personnes de se construire et de construire une société socialiste. Ceci n’est possible que par une action et une prise de conscience collective ce qui suppose une prise en charge collective des problèmes liés à la formation. (Conception de la formation) qui se développe selon une visée de transformation sociale profonde[35]“.
Pour ce faire, la C.F.D.T. compte en appeler, elle aussi, au renforcement du service public et à une conception pédagogique “conscientisante”, toujours d’actualité, aux accents de celle préconisée par Paolo Freire. Pour cette organisation, “la formation doit partir de la constatation que l’adulte se forme lui-même. C’est donc en partant de la vie, de l’expérience, de la pratique sociale, que la formation doit se développer. Elle doit permettre aux travailleurs la prise de conscience de leur situation d’être dépendants, aliénés, exploités, et permettre la découverte de la solidarité de classe qui les unit[36]“. En bref, la formation doit œuvrer à la transformation sociale et pour cela user d’une pédagogie adaptée à ses fins donc qui remette en cause “une relation pédagogique de type domination-soumission et en la transformant en un rapport plus égalitaire qui contribuera à établir un nouveau mode de rapports sociaux[37]“.
Le texte de la Confédération Française Démocratique du Travail est limpide, sans ambiguïté, l’éducation permanente, telle qu’elle la conçoit, s’inscrit bien dans la tradition syndicaliste, Pierre Monatte s’y serait sans doute retrouvé. Si la loi de 1971 était pour la C.F.D.T. un texte de compromis, une lame à double tranchant, elle entendait bien en constituer un outil au service de l’émancipation des travailleurs, “un instrument de leur libération leur permettant d’être les agents de leurs propres conditions de travail et de vie[38]“.
Évolutions et/ou renoncement, rupture ou continuité ?
Nous ne reviendrons pas sur la position du CNPF d’hier même si elle apparaît plus progressiste et plus humaniste que les propos actuels du M.E.D.E.F. et ses litanies sur la responsabilité individuelle en matière de maintien et de développement de la compétence quand on sait qu’aucune prévision sérieuse, compte tenu des évolutions scientifiques et technologiques, n’est en mesure de nous décrire les métiers et les emplois de demain[39].
Quant à évolutions syndicales, les textes que nous avons utilisés pour construire notre hypothèse démontrent à la fois une grande permanence et une grande variabilité. Telle organisation peut renoncer à un moment de son histoire à son passé éducationniste révolutionnaire, telle autre le faire ressurgir, voire inviter à sa table des traditions étrangères et plus radicales, telle autre naviguer avec habileté sur les vagues de la tension ou se laisser prendre au mythe réformiste de la co-responsabilité en matière de gestion d’entreprise. Au demeurant et malgré l’éclatement syndical qui caractérise le syndicalisme hexagonal, gageons que pour longtemps encore la double posture face à l’éducation perdurera. Tant celle de la formation considérée comme un outil d’accompagnement des modernisations et des évolutions du travail dans laquelle se sont engagées les grandes centrales aujourd’hui majoritairement réformatrices. Tant celle de l’éducation considérée comme un levier essentiel et incontournable à l’émancipation du travail et à la transformation radicale de la société que se sont réappropriées de petites organisations minoritaires comme S.U.D ou la C.N.T. La première se réclamant de la C.F.D.T. autogestionnaire des années 1970, la seconde de l’anarcho-syndicalisme de la première C.G.T. et de la Charte de Lyon adoptée au congrès constitutif de la CGT-SR[40].
Hugues Lenoir
CEP-CRIEP, Paris X
[1] Voir le texte de Jean-Louis Marais dans de même numéro.
[2] Se reporter à l’article de Hugues Lenoir (2000), A l’origine du syndicalisme : l’Education ou éduquer pour émanciper, in Syndicalisme et Formation,Paris, L’Harmattan, pp. 17-50.
[3] Pour illustrer sommairement cette première partie, j’ai utilisé les textes présentés par Yves Palazzeschi (1998) in Introduction à une sociologie de la formation, anthologie de textes français, 1944-1994, Paris, L’Harmattan, pp. 186-204.
[4] Sur ce point consulter Hugues Lenoir, Contradictions sociales et formation entre rupture et suture, Actualité de la formation permanente, n° 159, mars-avril 1999.
[5] Palazzeschi Y., op. cit., p. 186.
[6] Ceyrac F., La formation et l’éducation concernent directement le chef d’entreprise, Patronat n° 311, décembre 1970 in Yves Pallazzeschi, op. cit., p. 186.
[7] Souligné par nous. A noter que F. Ceyrac utilise déjà le terme d’investissement qui fera flores dans les années 1985
[8] Ceyrac F., op. cit., p. 186.
[9] Ibid., p. 186.
[10] Ibid., p. 187.
[11] Ibid., pp. 187-188.
[12] CGT, Mémorandum sur la formation et le perfectionnement professionnels, Le Peuple, n° 852, in Yves Pallazzeschi, op. cit., pp. 188-189.
[13] Moissonnier H., 10 ans : formation professionnelle continue, Le Peuple, n° 1087, in Yves Pallazzeschi, op. cit., p. 362.
[14] C.G.T., Mémorandum sur la formation et le perfectionnement professionnels, Le Peuple, n° 852, in Yves Pallazzeschi, op. cit., p. 188.
[15] Ibid., p. 189.
[16] Ibid., p. 190.
[17] Ibid. p. 188.
[18] F.O., Formation professionnelle et éducation permanente, F.O. hebdo, n° 1300, 8 mars 1972, in Yves Pallazzeschi, op. cit., p. 196. Souligné par nous.
[19] Ibid., p. 197. Souligné par nous.
[20] Ibid., p. 197. Souligné par nous.
[21] Ibid. p. 198.
[22] Ibid. p. 197.
[23] Ibid. p. 198. Souligné par nous.
[24] Ibid. pp. 199-200.
[25] Ibid., p. 200.
[26] Ibid., p. 200.
[27] Terrot N. (1983), Histoire de l’éducation des adultes en France, Edilig, Paris, p. 127.
[28] C.F.D.T., La formation professionnelle et l’éducation permanente, Formation numéro spécial, sept-oct. 1972, in Yves Pallazzeschi, op. cit., pp. 192-196.
[29] Ibid., p. 192.
[30] Ibid., p. 192.
[31] Ibid. p. 193.
[32] Ajouté par nous.
[33] Souligné par nous.
[34] CFDT, art cité, in Yves Pallazzeschi, op. cit., p. 194.
[35] Ibid., p. 194.
[36] Ibid., p. 194.
[37] Ibid., p. 195. Souligné par nous.
[38] Ibid., p. 196.
[39] Carmona-Schneider J.-J., Di Ruzza R., Le Roux S., Vandercammen M., (éds), (1999), Le travail à distance, analyses syndicales et enjeux européens, De Boeck Université, Paris-Bruxelles, p.190. Les auteurs en référence aux travaux de la Commission européenne (Livre vert, vivre et travailler dans la société de l’information : priorité à la dimension humaine, 1996) écrivent : “que 80 % des technologies employées actuellement seront obsolètes dans dix ans, mais que 80 % des actifs disposeront d’ici là d’une formation bien antérieure à ces dix années”. Mais à l’évidence, peu d’actifs seront en mesure seuls d’anticiper, en toute “responsabilité” sur les compétences et les savoirs à se construire.
[40] Cette charte dite de Lyon, lieu où se tînt le congrès constitutif de la CGT Syndicaliste Révolutionnaire (1er et 2 novembre 1926), fut adoptée, suite au départ de la CGT-U (unitaire) d’un certain nombre de militants syndicalistes révolutionnaires, dont Pierre Besnard, qui considéraient la main mise “bolchevique” sur la confédération comme préjudiciable au développement d’un syndicalisme autonome et émancipateur.