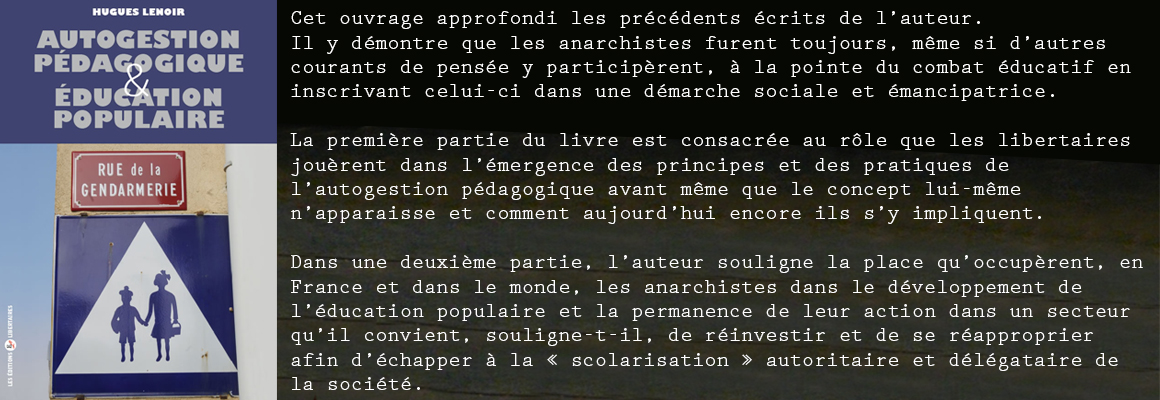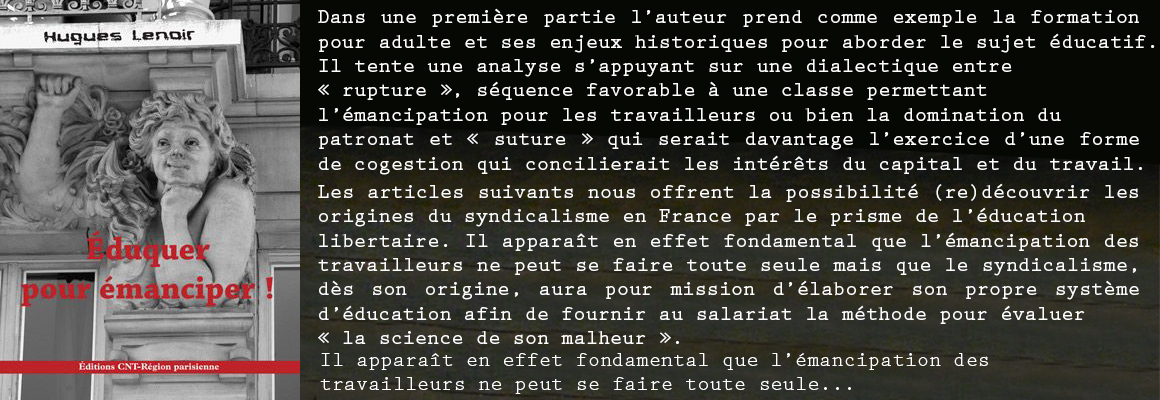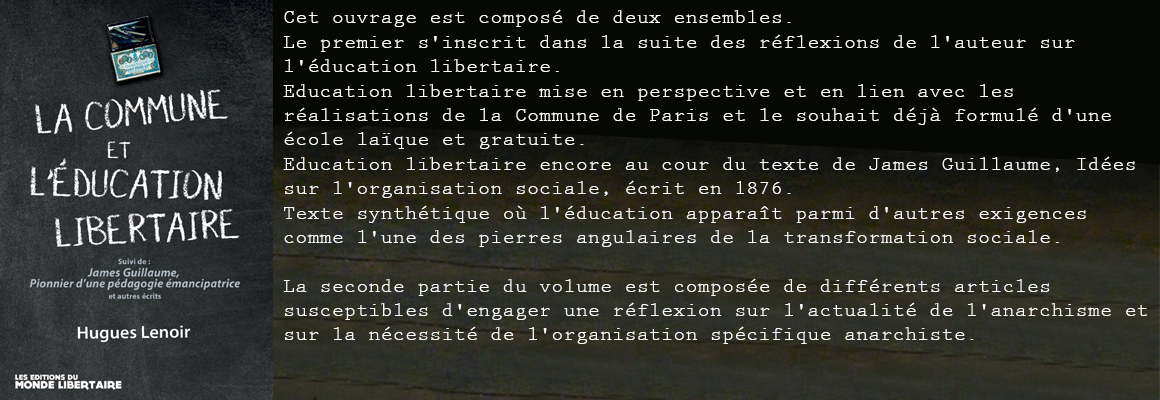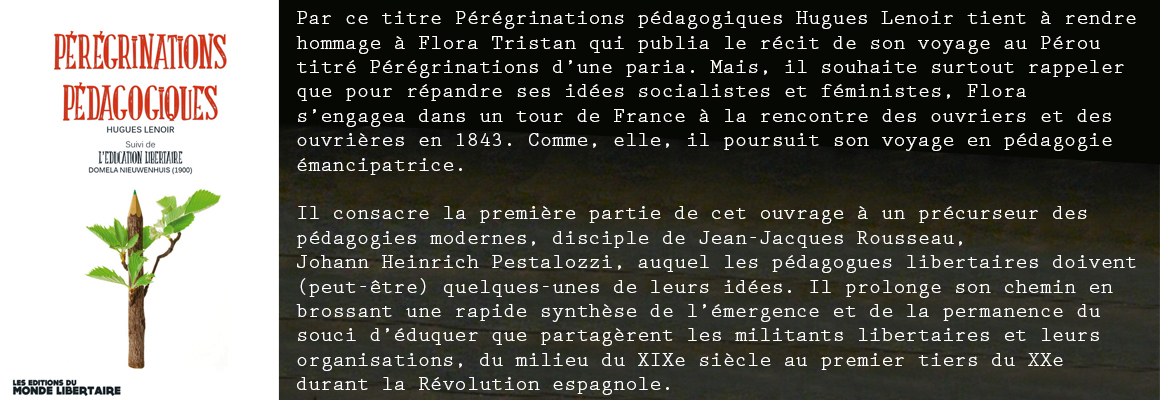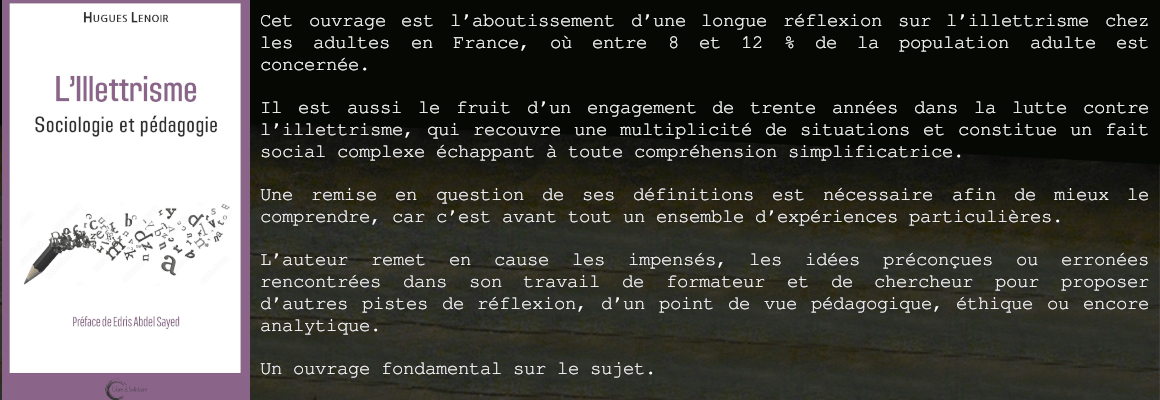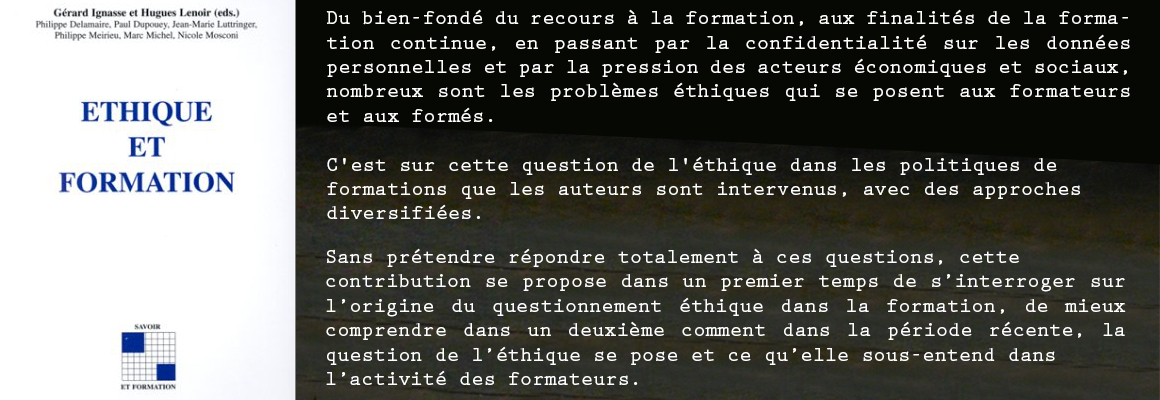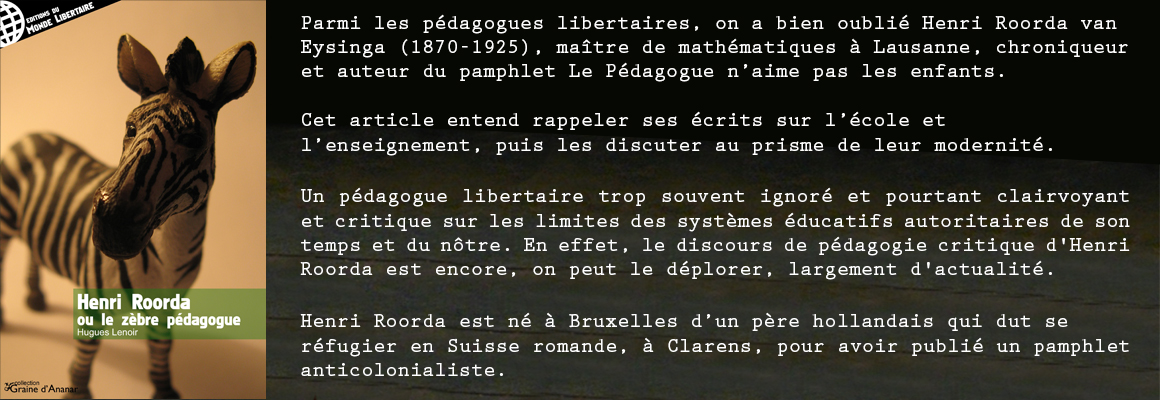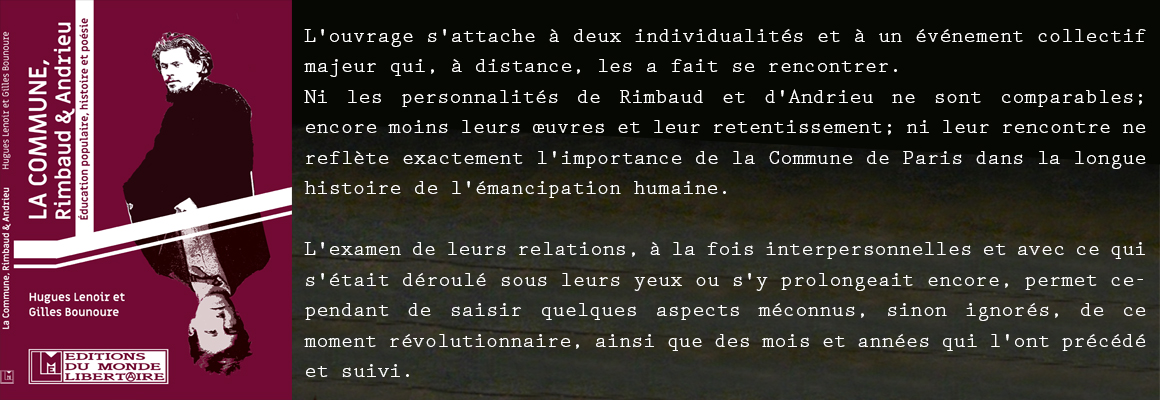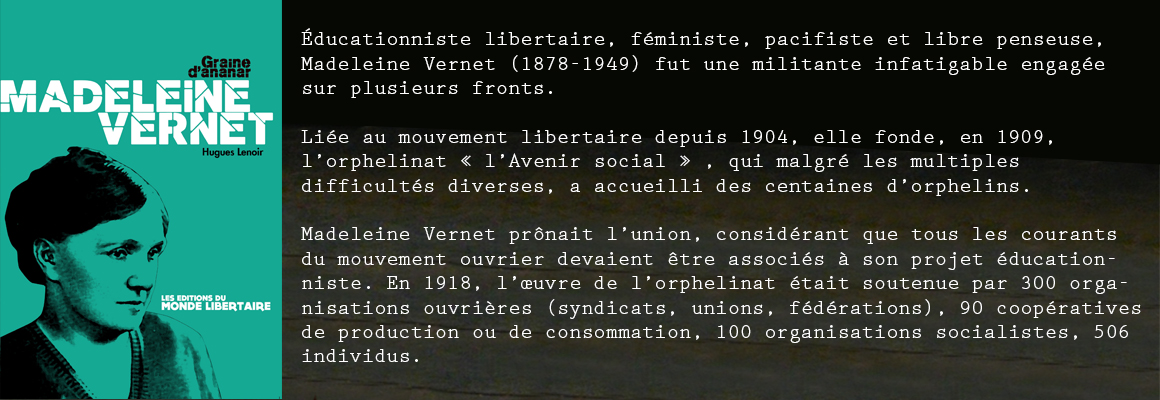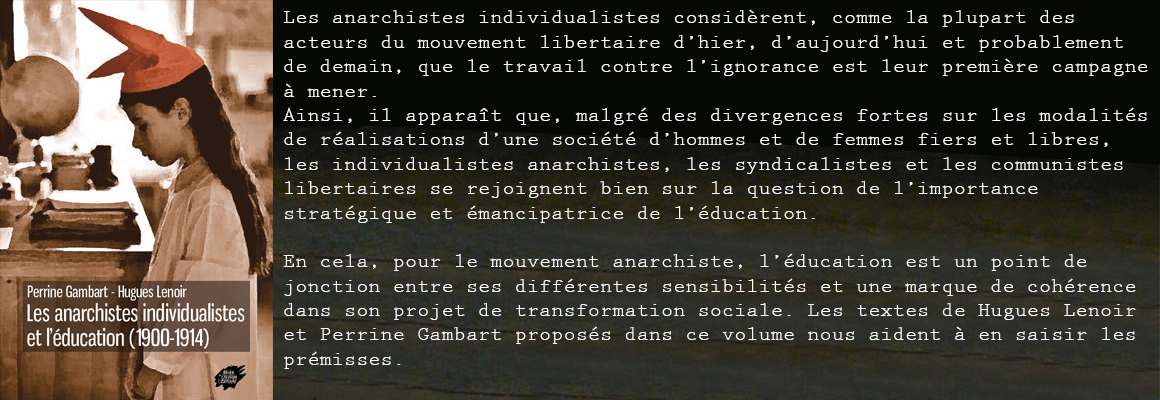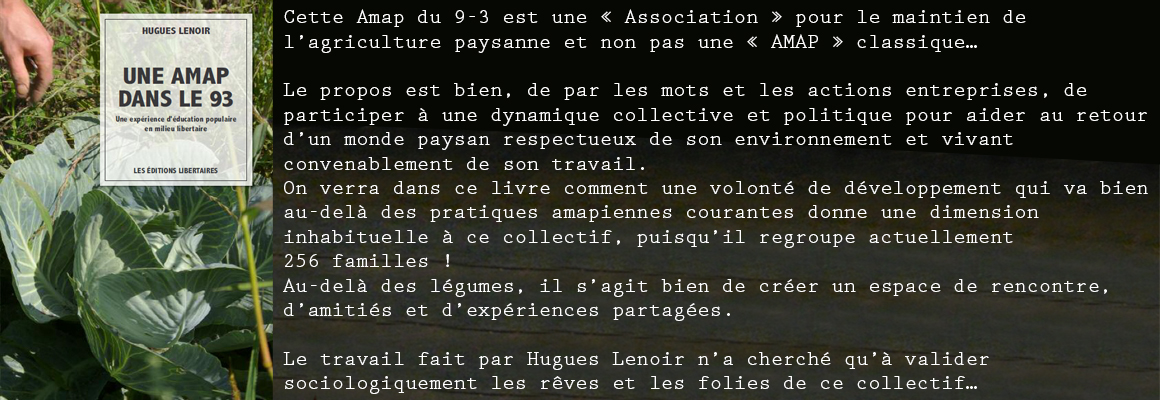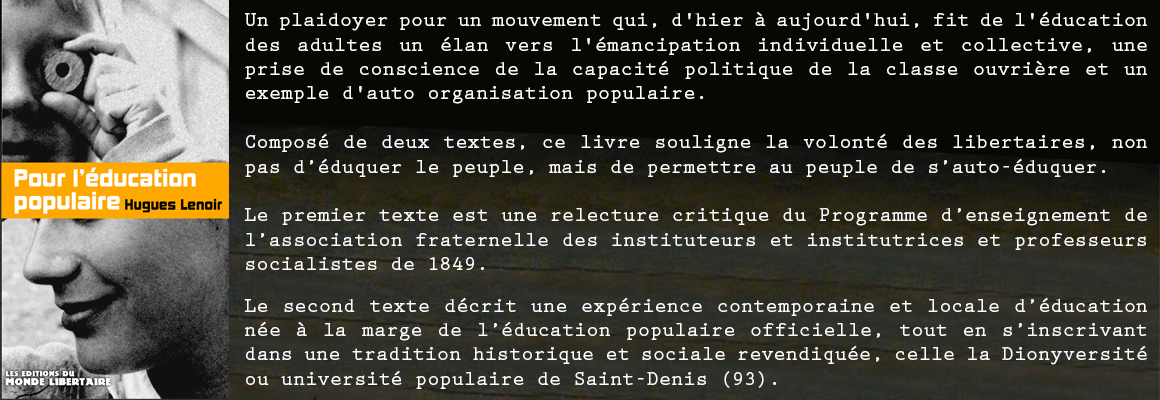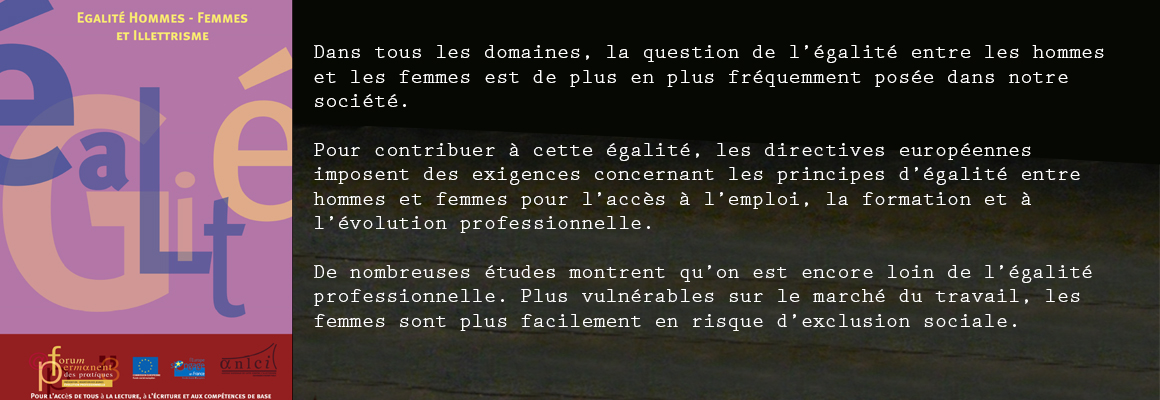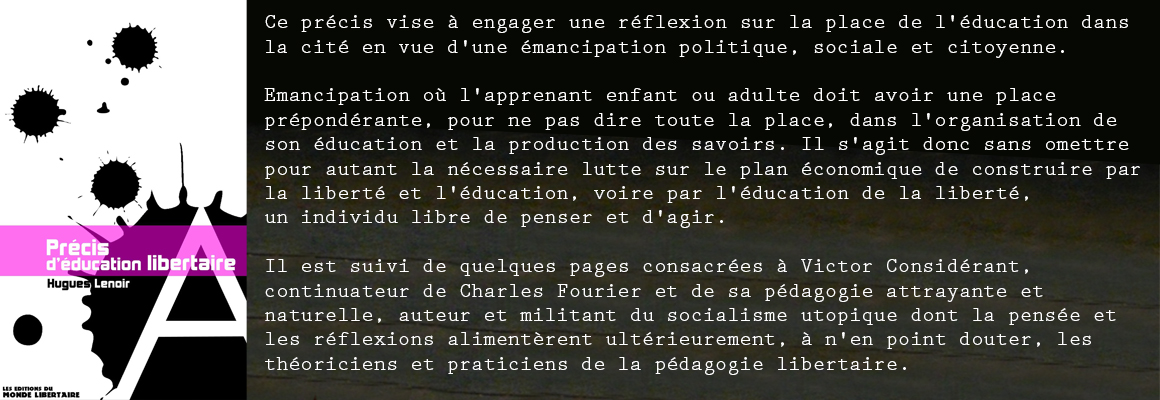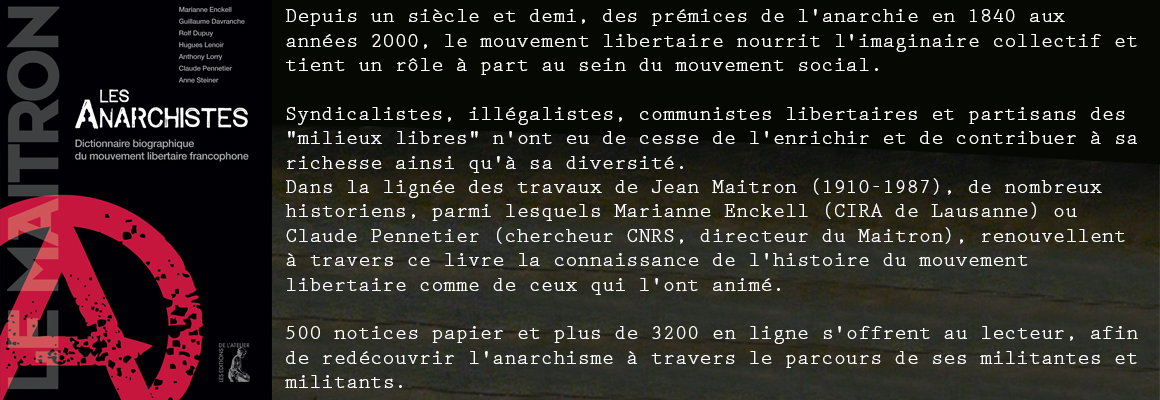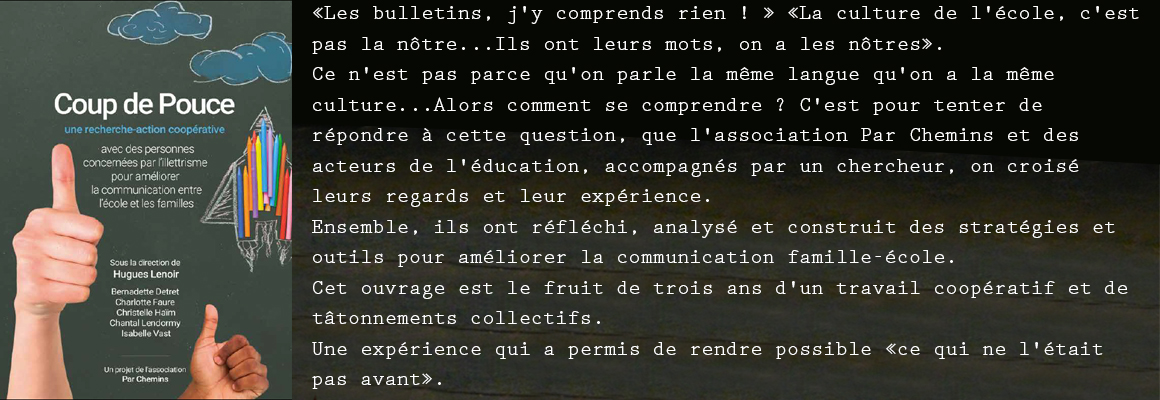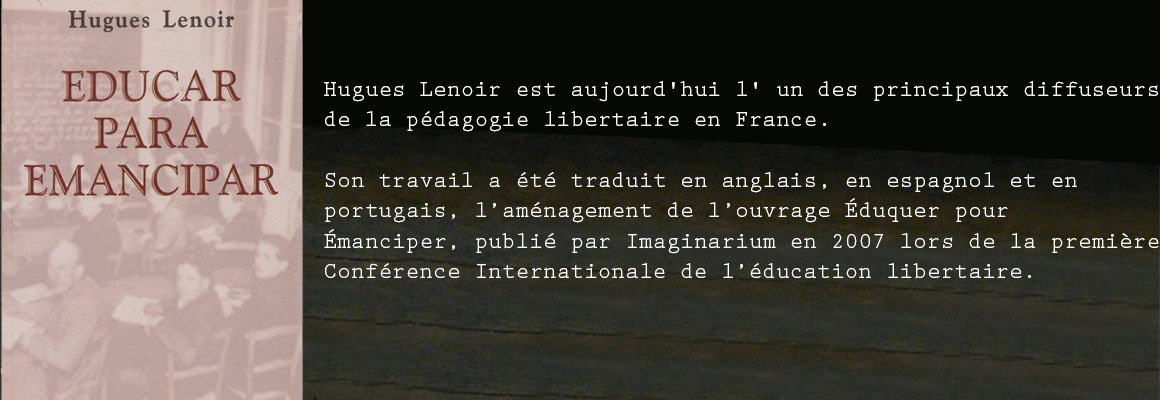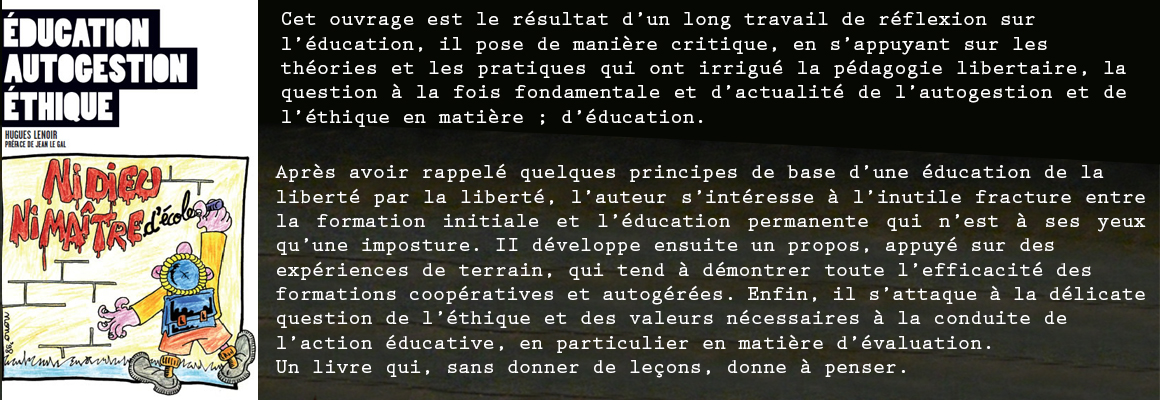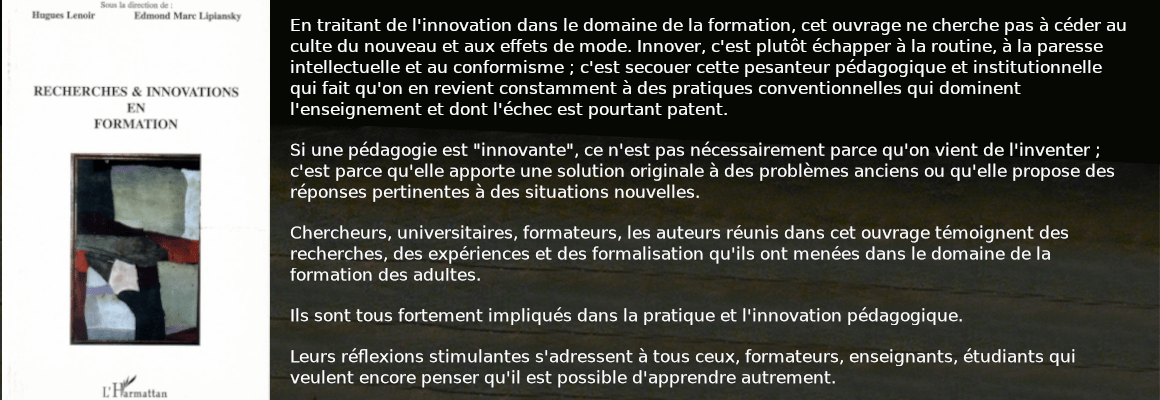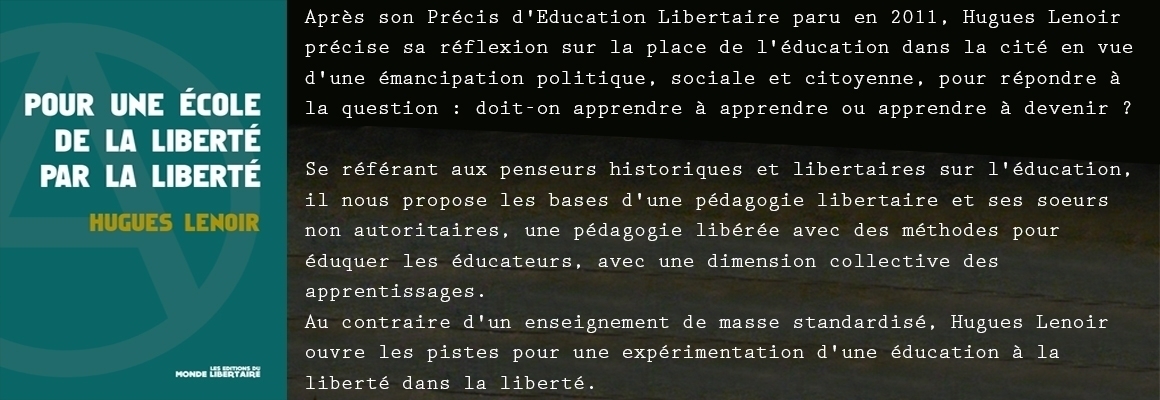Repères et Réflexion sur l’écrit
Analphabétisme, illettrisme, allettrisme
« Les mots qui vont surgir
Savent de nous
Ce que nous ignorons d’eux »
René Char
Ce texte n’a pas la prétention de faire l’histoire de l’écrit ni même de l’alphabétisme ou encore de l’illettrisme. Il est le résultat de prises de notes systématiques de longue date dans de nombreux ouvrages issus de nombreux auteurs de champs différents : historiens, sociologues, spécialistes des Sciences de l’éducation, anthropologues… Notes qui, une fois relues et organisées, m’ont semblé prendre sens à la manière d’un patchwork où des pièces juxtaposées et cousues forment un tout. Il est construit à partir de citations et de réflexions qui me sont propres sans souci d’exhaustivité. Ce texte pourrait apparaître comme un texte d’opinion ou de parti pris, peut-être l’est-il, mais il est avant tout le reflet des convergences de points de vue entre de nombreux auteurs dont beaucoup font autorité.
Rompre avec une surreprésentation de l’écrit
La pouvoir de l’écrit
Avant de revenir sur le rôle de l’écrit en général et plus particulièrement en France depuis le moyen-âge, je souhaite revenir sur la croyance souvent forte que l’écrit serait le nec plus ultra d’une progression civilisationnelle. Ainsi pour Bernard Lahire, que je rejoins sur ce point, « l’illettrisme, la diffusion puis l’intériorisation [de cette réalité est l’aboutissement] de l’idée selon laquelle la définition de l’ « Homme », de la pleine humanité, passe nécessairement par l’entrée dans la culture de l’écrit »[1]. En effet, rien ne nous permet d’affirmer que la lecture soit éternelle car indépassable. Elle n’est comme bien d’autres faits de société qu’une pratique sociale historiquement, socialement et économiquement marquée. Certains anthropologues, dont… Scott James C[2], formulent même l’hypothèse que certains groupes humains auraient pu utiliser un temps puis abandonner l’usage de l’écriture suite à des événements sociaux importants (guerre, pillage, esclavage, déplacement de population…).
Je me plais aussi à rappeler après d’autres que l’écriture est une activité récente chez Sapiens, quelques milliers d’années tout au plus, et qu’il a vécu beaucoup plus longtemps sans écriture, ce qui ne l’a pas empêché d’inventer des modes d’organisation sociale et de faire preuve de culture : outils de pierre, peintures rupestres, sculptures d’objets, traditions orales d’une immense richesse… De plus l’écriture à ses débuts fut, dans la plupart des cas, utilisée par les régimes autoritaires comme outil de gestion économique et de contrôle. A cela ajoute Scott James : « la connaissance de l’écriture dans les sociétés prémodernes était dans le meilleur des cas réservée à une infime fraction de la population que l’on évalue avec une quasi-certitude à moins de 1% »[3].
Nicolas Offenstadt nous rappelle en effet que « pour les populations du Moyen Age, largement illettrées [analphabètes], les informations ordinaires, comme extraordinaires, passent en effet par l’oralité et souvent par la bouche du crieur public. L’écoute et la discussion publiques sont ainsi cruciales pour bâtir des communautés politiques, à l’échelle urbaine, à celles des principautés ou encore à celle du royaume »[4]. Culture orale qui perdurera encore largement après la Renaissance comme le souligne Roger Chartier. « Prenons garde, déclare-t-il, à ne pas projeter sur le passé notre monde dans lequel le livre, la lecture et l’école définissent la transmission des connaissances.
Dans le monde du 16e et du 17e siècle, les modes d’accès à la connaissance sont à la fois équivalents et multiples. Il existe une culture qui n’est pas de l’écrit, y compris pour les élites, les lettrés et la cour et, à l’inverse, il y a une culture écrite pour les illettrés dans la mesure où à partir du 16e siècle, au moins en ville, les écritures sont multiples : écritures épigraphiques, affiches, pamphlets, libelles, enseignes… »[5]. Au demeurant le recours à l’écrit a quelquefois permis de préserver la mémoire et l’art d’« illettrés » hautement qualifiés. C’est le cas pour les tous premiers livres de cuisine. En effet, « L’histoire du goût en Europe occidentale commence avec les premiers livres de recettes. Le tout premier est danois et date de peu après 1200. Vers 1300 en France, en Italie, en Angleterre et en Allemagne, d’autres ouvrages de cuisine apparaissent.
Cela reste d’ailleurs une énigme : pourquoi apparaissent-ils à une époque où les cuisiniers ne regardaient pas dans les livres pour faire la cuisine et ne savaient pas lire ? A qui donc étaient destinés ces livres ? Certains ont été écrits sur commandes, comme celui de ce cuisinier savoyard rédigé en 1425 : il explique que son maître, le duc de Savoie, lui a demandé de rédiger ses recettes pour montrer comme on mangeait bien chez lui. L’auteur n’a jamais lu un livre de cuisine de sa vie et ne sait pas écrire : aussi son maître lui a procuré un notaire, à qui il a dicté ses recettes »[6].
Néanmoins analphabètes et illettrés comprirent dès le 16e siècle la valeur de l’écrit, la plupart du temps rédigés par des clercs afin de porter leurs revendications. Dès cette époque, des « exemples de procédures de contestation du pouvoir paraissaient autoriser toutes sortes de mécontentements à recourir directement au monarque en cas d’inquiétude ou de désaccord. Les révoltes, mêmes celles où dominaient des paysans illettrés, savaient l’usage de ces requêtes, rédigées en forme de catalogues de revendications. Elles énuméraient des plaintes minuscules ou dramatiques, décomposaient en articles maladroits des projets qui allaient parfois jusqu’à mettre en cause les bases de l’Etat »[7].
Écrit qui par ailleurs est doté d’une force symbolique importante, peut-être liée à la tradition du Livre en Europe. A propos des actes écrits au 17e et 18e : « se découvre l’ambivalence du document dans les civilisations orales et illettrées. Incompris, il est, en même temps admiré et redouté. On lui prête un pouvoir magique, il prouve, établit, fonde et lie, non par son contenu, mais par sa matérialité même. La preuve écrite jouit dans l’ancienne société d’une force étonnante »[8].
Écrit et pouvoir d’agir
Autre surreprésentation de l’écrit, celle qui légitimerait la capacité à agir comme acteur social et citoyen du fait de sa maîtrise et qui impliquerait pour les illettrés et analphabètes une totale inaptitude à la gestion sociale. L’histoire ouvrière souvent méconnue voire ignorée à dessein nous en offre pourtant de nombreux exemples.
Dans la première moitié du 19e siècle, Agricol Perdiguier s’en fait le témoin dans ses mémoires. Il écrit : « ce Vivarais-le-Cœur-Content ne savait ni lire ni écrire ; il était faible sur la conversation, il n’était nullement orateur ; et cependant il occupait la première fonction de la Société ! Et ce qui paraîtra singulier à des gens qui n’ont pas vu les hommes à l’œuvre (…), c’est qu’il s’acquitta parfaitement de sa mission »[9], gérer la Société des compagnons menuisiers de Chartres durant l’année de son mandat. Il en va de même parmi les premiers militants du syndicalisme ouvrier au début du 20e siècle. Lors de l’élection du nouveau secrétaire général de la Bourse du Travail de Lyon en 1895, Jules Thozet est élu « malgré l’illettrisme presque totale de celui-ci, [ce] qui a laissé de nombreux délégués sceptiques sur ses capacités à assumer ce poste.
Thozet est un militant reconnu comme laborieux, intelligent et beaucoup écouté en milieu ouvrier […]. Il occupera le poste de secrétaire général de la Bourse, considéré avec respect et sérieux par l’ensemble des délégués, durant plusieurs années, jusqu’à sa mort en 1903 »[10]. La Révolution espagnole (1936-1939) fut assez largement animée elle aussi par des ouvriers mais surtout des paysans à la fois conscients socialement et analphabètes. Les exemples des capacités de ces militants « sans lettres » sont multiples, à l’image d’un « Roque Provencio […qui], fut l’initiateur et l’âme de la collectivité (village autogéré durant la Révolution sociale espagnole) par ses initiatives et son travail formidable, bien qu’il fut analphabète […] Cette collectivité de mille travailleurs fonctionnait avec trois charges rétribuées : le secrétaire Roque Provencio, le comptable (Salomon Vasquez ?) et une dactylo qui était indispensable pour rédiger ce que dictait Roque Provencio qui signait avec son tampon.
Trente ans après ces faits (85 en 2021), il semble incroyable qu’une œuvre d’une telle nature ait pu être faite par des analphabètes »[11]. Témoignage qui conforte les résultats de mes propres recherches conduites en France parmi des militants syndicaux des années 2005 dans Syndicalisme et situations d’illettrisme, militants et savoirs de base[12]. Enfin et dans un autre domaine, il convient d’évoquer le cas de députés au Bénin élus bien dépourvus des savoirs que certains considèrent comme le sésame de la capacité à agir dans la société. Serge Loko dans un article repris dans Courrier international intitulé « Députés analphabètes pour électeurs illettrés » écrivait :
« L’assemblée nationale béninoise compte deux élus qui ne savent ni lire ni écrire, comme 80 % de leurs concitoyens (…). Ces deux citoyens béninois n’ont pas pris leur fauteuil de force. Ils se retrouvent à l’Assemblée nationale parce qu’ils sont réellement influents dans leur circonscription électorale. La simple évocation de leur nom draine des électeurs »[13].
Malgré de tels exemples de militants et d’élus analphabètes ou en situation d’illettrisme, nombreux parmi les libertaires et les progressistes considérèrent dès la fin du 19e siècle que l’accès à l’écrit deviendrait de plus en plus un outil incontournable pour agir avec efficacité et changer le monde, même si de nombreux exemples de militants sans ce savoir perdurèrent. C’est le constat que fit le grand pédagogue Albert Thierry en 1913. Il notait déjà à propos du lire, écrire, compter : « on exagère la valeur de ce savoir, on n’a pas exagéré l’utilité de ces instruments.
Certes, il y a de magnifiques âmes sans lettres, de bons ouvriers qui ne sauraient pas lire […]. Aujourd’hui, l’homme qui ne sait pas lire, l’homme qui ne sait pas écrire nous apparaissent bizarres et maladroits comme des revenants. La civilisation jadis était plastique et orale, elle est devenue alphabétique et imprimée »[14]. Dans la suite de ce texte, nous le verrons, d’autres acteurs sociaux s’intéresseront à l’alphabétisation du peuple mais pas toujours dans une recherche d’émancipation.
Les enjeux de l’alphabétisation
Les enjeux qui président à l’alphabétisation des couches populaires, on le verra, sont contradictoires. Selon les acteurs, ses finalités sont de nature différente : nécessité pacificatrice ou moralisatrice dans l’esprit de Falloux, nécessité industrielle et économique, nécessité citoyenne et émancipatrice…
Pour l’Église médiévale
Il convient de rappeler néanmoins que l’alphabétisation n’eut pas que des effets positifs et qu’elle eut aussi pour conséquence un recul et un appauvrissement culturel et humain. En ce sens François Ploux écrit : « L’alphabétisation rurale, qui impliquait la disparition de toute une culture orale essentiellement collective – puisque conditionnée par l’intensité des échanges à l’intérieur du groupe – fut l’un des principaux facteurs de la décomposition des solidarités coutumières »[15]. Au reste, l’Eglise s’émeut de l’ignorance de certains laïcs demi-alphabétisés qui pouvaient devenir les vecteurs de croyance erronées. « En 1277, remarque Raoul Vaneigem, le synode de Trèves déplore que les bégards (membres de communautés libres) et autres illettrati répandent hérésies et erreurs parmi le peuple »[16]. Une note de l’auteur précise que ces « illettrés » sont des gens simples mais aussi ceux qui ne sont pas clercs ou qui ignorent le latin donc qui ne peuvent ni lire ni comprendre les Écritures et donc encore moins les interpréter dans le sens d’une lecture correspondant aux prescriptions ecclésiales.
Émotion qui ne se limite d’ailleurs pas qu’aux laïcs mais aussi au bas niveau de savoir de ces clercs ruraux beaucoup moins éduqués que ceux de grandes concentrations urbaines. Georges Minois citant un texte de l’époque nous rappelle que dès le Moyen Age, « l’illettrisme » fait des ravages et du même coup est cause d’athéisme, « d’où viennent nos curés ? Ce n’est pas à leurs études ou à leurs écoles qu’on les a arrachés pour leur confier des paroisses, mais bien à leur charrue ou à leurs instruments de travail. Ils ne comprennent guère mieux le latin que l’arabe ; il y en a même, j’ai honte de le dire, qui ne savent pas lire et sont à peine capable de distinguer le a du b. […] Que voulez-vous que je vous dise des connaissances littéraires et doctrinales du clergé, alors que presque tous les prêtres, sans comprendre ni les paroles, ni leur sens, sont à peine capables de lire lentement syllabe par syllabe ? Quels fruits auront-ils pour les autres, eux pour qui ce qu’ils lisent est du barbare »[17] ?
Pour l’armée
Dès la fin du 19e et au début du 20e siècle les autorités militaires se préoccupent de l’alphabétisation des jeunes recrues. En effet, malgré la loi Ferry de 1881, de nombreux jeunes hommes maîtrisent souvent très mal la lecture et encore moins l’écriture. L’armée engagea donc un travail important d’alphabétisation non pas dans une volonté émancipatrice mais, comme le souhaite un Ministère d’alors, afin de prendre « des initiatives dans un but moralisateur »[18].
En d’autres termes, des initiatives visant à conformer toute une classe d’âge aux valeurs d’une République loin d’être sociale et égalitaire. Michel Auvray rappelle qu’« en 1880, ceux qui sont alphabétisés pendant le service militaire représentent environ 90 % des recrues, et le taux se stabilise à 75 % dans les années suivantes. En 1901 encore, le taux général d’illettrisme est de 48 %, alors qu’il n’est plus que de 18,1 % chez les soldats renvoyés dans leurs foyers »[19]. De tels chiffres posent la question de la définition de l’illettrisme dans cette période, ainsi que celle du mode de calcul, des outils d’évaluation et du niveau requis pour ne plus être considéré en situation d’illettrisme. Ils donnent néanmoins un aperçu du niveau de littératie des jeunes hommes au début du 20e siècle.
Dans la grande muette, poursuit l’auteur : « entre 1902 et 1904, les circulaires se succèdent, fixant comme l’une des principales tâches de l’instruction, celle de « préparer à la vie sociale » le citoyen sous les drapeaux. Elles recommandent d’abord l’installation dans le casernement de salle de lecture et de récréation, la tenue de conférences éducatives »[20]. Préparation à la vie sociale, ce qui laisse penser que les jeunes gens des milieux populaires ne sont pas socialisés comme ils se devraient de l’être. « La loi du 27 juillet 1910 établi[ra] un examen annuel de l’instruction primaire des conscrits. Et, un an plus tard, une circulaire ministérielle précise[ra] le but à atteindre : ne laisser aucun appelé rentré chez lui illettré après son temps de service »[21].
Enfin, pour clore ce projet de mise en conformité des jeunes hommes après être passés sous la férule des hussards noirs de la République, ils trouveront moyen durant leur service militaire de parfaire leur éducation. A cette fin, un proche de Lyautey dénommé André écrit : « le régiment […] est quelque chose de plus qu’une grande famille : c’est une école. Le maître d’école se prolonge dans l’officier, qui est l’enseignant de la nation »[22].
Pour le monde des élites
Certains courants des élites politiques et économiques dès les années 1830 se préoccupèrent aussi de l’alphabétisation des couches populaires. Si quelques groupes, à la suite de Charles Fourier, tel Pierre Joseph Proudhon et sa Démopédie ou des Saint-Simoniens de l’association polytechnique, voyaient dans l’éducation un moyen pour susciter le progrès industriel et politique des sociétés et un levier pour améliorer la condition ouvrière, d’autres y voyaient un moyen d’encadrer une classe dangereuse en formation. Après 1848, écrit Martyn Lyons « les élites sociales considéraient que l’alphabétisation en elle-même ne suffisait pas ; elle devait servir à diriger les classes populaires vers des lectures qui les incitent à accepter les valeurs bourgeoises et à s’intégrer dans la société française. Le développement du mouvement des bibliothèques populaires en France doit être considéré comme une part du combat mené pour réussir l’alphabétisation sociale »[23].
Préparation à la vie sociale pour les uns (cf. : supra), alphabétisation sociale pour d’autres, tel est l’attendu en matière d’éducation du peuple pour certains. L’auteur ajoute, de ce fait : « les historiens des bibliothèques du XIXe siècle ont été tentés d’y voir les instruments du contrôle social et un moyen pour une classe dominante d’imposer ses propres choix idéologiques. Les partisans des bibliothèques publiques et les philanthropes partageaient un espoir selon lequel les bibliothèques populaires émousseraient l’acuité du conflit des classes »[24].
Quant au Républicain Jules Simon, il recommandait pour le peuple de lui donner « sans hésitation la grande morale, et autant que possible, donnez-la-lui dans le langage des maîtres, car il ne faut pas séparer les deux choses, la belle langue, la belle doctrine… pour le grand enfant qu’on appelle le peuple, Corneille, Molière, Racine, Shakespeare, Schiller ne sont pas trop beaux »[25]. Propos et intentions paternalistes visant à civiliser et dresser la classe laborieuse. Malgré tout, l’effort d’alphabétisation paye et petit à petit les élites voient les choses de leur point de vue progresser. Ainsi, un notable de Roubaix déclare en 1885 devant la Société d’émulation : « Il y a progrès du reste, on entend plus de parents vous dire qu’on a pas besoin de savoir lire et écrire pour boire, manger et travailler, mais tous n’apprécient pas à sa juste valeur l’importance de l’instruction »[26].
Pour le monde économique
Du côté du monde économique, qui partage bien souvent le point de vue évoqué ci-dessus, se jouent aussi des enjeux d’une autre nature. Jean Macé, le fondateur de la Ligue de l’enseignement, considérait l’éducation comme essentielle aux équilibres républicains. Celui-ci, malgré des positions plutôt progressistes, « obtient pourtant un soutien très fort des industriels rhénans, surtout ceux d’origine protestante, qui voyaient dans les bibliothèques populaires un moyen commode d’améliorer l’efficacité de leur main-d’œuvre »[27].
L’éducation au-delà de moraliser aurait pour vertu de rendre la main-d’œuvre plus compétente et plus productive. C’est ce qu’avaient compris quelques chevaliers d’industrie dès la fin du 19e siècle. La suite de l’histoire industrielle a depuis largement confirmé ce pari. Quelques années plus tard, malgré l’effort en matière d’éducation consenti et son impératif économique, il reste des poches importantes d’illettrisme dans la population ouvrière.
En 1918, le président de la chambre consultative de Roubaix écrit au Ministre des finances que : « les ouvriers employés à la fabrication de nos étoffes sont en général assez ignorants pour trouver beaucoup de difficultés à imprimer les marques et les numéros dans les tissus et à ne pas confondre les pièces qu’ils fabriquent tantôt l’une, tantôt l’autre »[28]. En ces temps se posait déjà la question des effets de l’illettrisme sur la qualification et les compétences de la main d’œuvre, une vieille affaire toujours d’actualité.
Laissons à Yves Palazzeschi le soin de conclure sur les enjeux politiques et économiques quant à la nécessaire éducation du peuple suite aux décisions de ses élites. Décision et intention qui ne sont toujours ou pas seulement philanthropiques mais liées aux intérêts bien compris d’une classe dominante vigilante quant à la préservation de ses propres positions. Pour le sociologue : « l’industrialisation naissante et l’établissement progressif de la démocratie […sont], deux transformations majeures du siècle dernier [qui] requiert une population moins illettrée (au sens de plus alphabétisée), des relations sociales plus moralisées, des individus plus citoyens »[29].
Pour le monde ouvrier
Dans le monde ouvrier, l’écrit joua un rôle considérable dans l’accès à la conscience et aux responsabilités sociales. Quelquefois même il était une condition sine qua non pour accéder au droit de suffrage ou à un mandat électif. Bornislaw Bazko rappelle que le très libéral et autoritaire Directoire dans « la Constitution de 1795 introduira un cens culturel : pour exercer les fonctions de citoyen il faudra savoir lire et écrire, clause qui ne devait s’appliquer qu’aux jeunes, nouveaux inscrits sur les listes électorales, et seulement dans dix ans. Or cette Constitution n’a survécu que quatre ans, et par la suite l’idée de cens culturel a été abandonné »[30].
Au demeurant, la culture orale longtemps encore fut un moyen privilégié de prise de conscience et de diffusion de la contestation. Michel Winoch souligne par exemple que « pour juger du succès croissant de Béranger, il faut rappeler que la majorité des conscrits sous la Restauration (entre 1815-1830) ne savent ni lire ni écrire. C’est donc par la chanson, plus que par les journaux que se propagent les opinions »[31] en particulier dans les cabarets des villes ou la parole sociale se libère peu à peu. Ce n’est que plus tard, suite à la loi sur la liberté de la presse de 1881, que les journaux républicains et révolutionnaires joueront un grand rôle dans l’éducation politique des couches populaires. Le même auteur ajoute que « le développement de l’instruction, en abaissant la moyenne nationale de l’analphabétisme des jeunes gens de 20 ans, de 53 % sous la monarchie de juillet (1832) à 8,5 % en 1892, a multiplié sensiblement le lectorat potentiel des journaux, qui connaissent alors, jusqu’en 1914, leur âge d’or.
C’est par eux que le combat politique, y compris celui des écrivains, passe désormais, sans contrainte »[32]. Propos à nuancer dans la mesure où malgré les efforts consentis suite au loi Ferry, de nombreux jeunes ouvriers et ouvrières quittaient l’école fort tôt ou ne la suivaient pas avec assiduité, le travail des enfants représentant souvent pour les ménages les plus pauvres des apports monétaires indispensables à la survie. L’amélioration économique progressive de la condition ouvrière eut aussi des effets positifs sur l’activité de lecture. C’est ce dont Xavier Vigna témoigne, pour lui : « le développement massif de la scolarisation à compter des années 1880 a fait que tous les ouvriers nés en France ont pu apprendre à lire et à écrire.
Au terme de cette période on peut constater des pratiques récurrentes de lectures, facilitées par l’abaissement tendanciel de la durée du travail et du coût du livre depuis la fin du XIXe siècle, même si la lecture coûte toujours »[33]. Période où se développent des pratiques de lectures collectives dans les cafés et les estaminets et des apprentissages individuels de la lecture dans les nombreux journaux militants.
Les acteurs politiques et syndicaux se préoccupèrent aussi très tôt de la question de l’accès des classes populaires à la lecture et l’écriture. Jaurès, qui a commis de nombreux articles et discours à la Chambre sur l’éducation, écrit par exemple dans la Dépêche en 1888 un article intitulé Aux instituteurs et institutrices où il insiste sur la nécessité de savoir lire avec facilité « sans hésitations » afin d’accéder au sens, en d’autres termes d’être par la lecture « en relation familière avec la pensée humaine » et il ajoute « qu’importe vraiment à côté de cela quelques fautes d’orthographe de plus ou de moins »[34].
Dans le même temps, les militants syndicalistes et libertaires autour de Fernand Pelloutier mettent en place dans les Bourses du travail des cours pour adultes et des bibliothèques sociales afin que l’ouvrier puisse accéder à « la science de son malheur, [… afin] de connaître les causes de sa servitude ; […] de pouvoir discerner contre quoi doivent être dirigés ses coups »[35] autrement dit accéder à la compréhension de sa condition et de ses causes afin de pouvoir commencer à œuvrer individuellement et collectivement à la recherche d’autres modes d’organisation sociale. Il s’agit pour eux de faire de la connaissance un outil d’émancipation, donc il convient
d’« instruire pour révolter »[36]. Quelques années plus tard, en 1907, la militante Anna Mahé propose des articles en ortograpfe sinplifiée (sic) dans les colonnes du journal l’anarchie (sic)[37] afin de faciliter l’accès à la lecture et l’écriture cette fois au plus grand nombre[38] de compagnons. Même préoccupation chez les instituteurs radicaux de la CGT.
L’un d’entre eux, Gabrielle Bouët écrivait déjà dans L’Émancipation n° 172 du 30 septembre 1922 : « la connaissance parfaite de la lecture est le seul moyen de salut pour les enfants de nos écoles. La somme des connaissances acquises durant la scolarité n’est rien s’ils n’ont pas le goût de la lecture. Elle doit être considérée comme la base de l’enseignement, puis après la scolarité, comme la condition du progrès individuel »[39].
L’Éducation populaire ne fut pas en reste, elle fut dès ses débuts et elle l’est encore, l’un des vecteurs important de la revendication permettant un accès de tous à l’écrit et à la lecture. L’Educ pop considère en effet le livre comme l’outil indépassable d’amélioration des sociétés, Jean-Marie Mignon écrit à ce propos : « le livre, lui aussi, ou « expression écrite » dans le langage des instructeurs, a toujours joué un rôle essentiel dans le travail d’éducation populaire, pour des raisons bien compréhensibles : la lecture et l’écriture sont les premiers outils d’insertion et d’émancipation du peuple »[40].
Lecture et écriture : le niveau monte ?
Il convient aussi sur cette question de dédramatiser et de revenir à la raison sur la question toujours polémique du niveau d’apprentissage de l’écrit des jeunes hexagonaux. Soulignons qu’avant la scolarisation obligatoire mise en place durant la Commune de Paris puis reprise dans les lois de 1881, la scolarisation ouvrière et paysanne est très aléatoire et de moindre exigence. Le compagnon Perdiguier qui, plus tard, rédigera d’imposantes mémoires, y écrivait que vers 1830 : « nous mîmes tous un peu les pieds dans l’école du village ; les filles envoyées par la mère, les garçons par le père. Le tarif des mois était de 1 franc pour les enfants qui apprenaient seulement à lire, de 1 fr. 50 centimes pour ceux qui menaient de front la lecture et l’écriture […].
J’étais à peine allé deux ou trois mois à l’école ; je savais lire, écrire, calculer, mais d’une manière forte incomplète ; il fallut travailler »[41]. Et Perdiguier d’ajouter : « pour l’école, nous ne pouvions depuis longtemps n’y aller que le soir, et encore dans les soirées d’hiver seulement. Nous savions passablement lire, pas trop bien écrire, peu calculer. Nos sœurs étaient de notre force, tout au plus […]. Notre instruction était celle de tous les autres petits campagnards, ni plus, ni moins »[42]. Situation qui perdura peu ou prou encore longtemps. Dans les années 1930-1938, « s’il n’y avait plus d’illettrés, les paysans dépassaient rarement le niveau élémentaire. Les cours complémentaires agricoles étaient rares »[43].
Quant aux enfants des couches populaires urbaines au début du 20e siècle, la situation n’était guère plus brillante. André Burgos cite l’enquête de l’inspecteur Edouard Petit qui notait en 1895 : les éducateurs « constatent qu’à onze ans les savoirs balbutiants de l’école se changent vite en ignorance, que la mémoire oublie tôt ce qui ne s’est adressé qu’à elle »[44]. Constat partagé par Pierre Kropotkine qui anticipait d’ailleurs sur la notion d’illettrisme récurrent que nous connaissons aujourd’hui. Celui-ci constatait que les enfants des ouvriers « sont envoyés dès l’âge de treize ou quatorze ans à la mine ou à la fabrique, où ils s’empressent d’oublier le peu de choses qu’ils ont appris à l’école primaire »[45].
La polémique sur le niveau d’apprentissage de l’écrit et de la lecture ≠ ne date pas d’hier. En 1914, malgré un taux de scolarisation élevé : « l’Administration s’émeut de la publication de statistiques révélant que dans l’arrondissement de Montreuil un conscrit sur dix (c’est le double de la moyenne nationale) est illettré. L’inspecteur d’académie met en cause devant le conseil général l’enseignement de la lecture à l’école (« On ne lit pas assez dans nos écoles, et on y ressasse toujours le même livre ») et va jusqu’à parler de « faillite des lois scolaires »[46]. Baisse du niveau dont s’emparèrent hier les ennemis de l’école laïque ou aujourd’hui encore les tenants des pédagogies autoritaires centrées sur les seules disciplines académiques.
Un article de Charles Maurras du 20 janvier 1931 dans l’Action française illustre cette position décliniste : « la date du cinquantenaire de l’école laïque couvre un mensonge. Il est faux que l’école d’État soit un progrès car le nombre des illettrés ne fait que grandir… C’est une régression qu’il faut constater »[47]. Dès 1935, la méthode d’apprentissage utilisée est incriminée, un certain Pierre Liquier écrit à ce propos : « la « lecture expliquée », abordée à la fin des études primaires élémentaires, ne doit pas faire négliger la « lecture courante » aux cours moyen et supérieur.
Les illettrés se recrutent en grande partie parmi ceux qui ânonnaient lorsqu’ils ont quitté l’école. C’est seulement lorsqu’on lit sans peine, avec aisance, qu’on lit avec plaisir et qu’on continue de lire »[48]. Mêmes difficultés d’apprentissage constatées quelques années plus tard. Patrice Pelpel et Vincent Troger rapportent : « nous apprenons souvent à écrire correctement à des élèves âgés déjà de 17 ans, nous leur apprenons seulement à lire sans ânonner » écrit en 1952 un professeur de lettres d’un CA (Centre d’apprentissage futur CET).
Un de ses collègues, décrivant son action dans deux sections jugées difficiles, parle la même année d’élèves sans souci de l’orthographe et dont la susceptibilité à vif l’oblige à rester calme en toutes circonstances, et à renoncer certains jours à obtenir le moindre résultat de sa classe »[49]. Encore aujourd’hui de nombreux débats, souvent houleux, mettent au centre de ce pseudo constat de la baisse du niveau de lecture, la méthode d’apprentissage : globale, semi-globale, alphabétique, naturelle… ? Qu’en est-il vraiment ?
Il est essentiel de rappeler quelques éléments nécessaires à la compréhension sur cette question de niveau. D’abord souligner encore une fois, opinion que je partage avec Bernard Lahire, à savoir que les modes et les niveaux d’apprentissage sont entachés des valeurs sociales dominantes, qu’ils varient selon les périodes ou les groupes qu’ils servent et qui les utilisent. Il n’y a donc pas de neutralité, même scientifique, dans les savoirs. Ils ne sont que des outils ou des prétextes à la domination de quelques-uns, même si le plus souvent ils sont présentés comme naturels voire universels d’où l’intérêt de faire émerger l’implicite qui les légitime. Il faut aussi, écrit Lahire « plus radicalement encore, se demander ce que signifient « savoir lire » et « savoir écrire » à tel ou tel moment de l’histoire »[50].
En effet, les exigences en lecture et écriture hier (1930) et aujourd’hui (2020) furent définies en fonction de critères et de classements sociaux contextualisés. Qu’en sera-t-il demain avec le numérique et la digitalisation généralisée des supports de toute nature ?
En 1882 par exemple, seuls « 15 % des garçons et filles d’une même classe d’âge réussissent leur certificat d’études. Cette proportion passe à 35 % en 1902, puis à 50 % en 1936. Le taux de réussite baisse au lendemain de la Seconde Guerre mondiale »[51]. Ajoutons à cela les précisions de Vincent Troger pour qui, suite aux travaux de C. Baudelot et R. Establet contrairement aux discours portés par certains, il est évident que « le niveau global de la population (s’est) élevé simultanément à l’extension de la scolarisation. L’évolution des résultats de l’école primaire permet d’évaluer cette amélioration. Seulement la moitié des jeunes obtenaient le certificat d’études primaires en 1930.
Or, le niveau en était peu élevé par rapport aux exigences d’aujourd’hui en fin de CM2 : le certif’ se limitait en français à la dictée et à la lecture à haute voix assortie de questions de vocabulaire, alors que les tests nationaux d’entrée en sixième évaluent désormais, outre la grammaire et l’orthographe, la compréhension et la production de textes »[52] donc un niveau d’exigences de maîtrise des savoirs et/ou compétences de base bien supérieur à celui d’autrefois.
Au reste, il est par ailleurs incontournable de s’interroger sur les exigences numériques d’aujourd’hui pour les nouvelles générations de lecteurs et de scripteurs. Questionnement déjà formulé en 2000 et encore plus crucial en 2020. De facto, l’on peut craindre un effet du numérique sur le renforcement d’une absence de maîtrise partielle ou totale de ces outils par une partie de la population sujette à l’illectronisme. « Ces innovations (TICE, Technologies d’information et de communication dans l’enseignement) ne vont-elles pas creuser les inégalités entre les élèves capables de naviguer aisément dans les divers hypertextes et ceux qui maîtrisent mal les apprentissages de bases »[53] ? se demandait Martine Fourier en 2000, nous y sommes et c’est ce que tendent à prouver les chiffres les plus récents. « En 2019, 15 % des personnes de 15 ans ou plus n’ont pas utilisé Internet au cours de l’année, tandis que 38 % des usagers manquent d’au moins une compétence numérique de base et 2 % sont dépourvus de toute compétence.
Ainsi, l’illectronisme, ou illettrisme numérique, concerne 17 % de la population. Une personne sur quatre ne sait pas s’informer et une sur cinq est incapable de communiquer via Internet. Les personnes les plus âgées, les moins diplômées, aux revenus modestes, celles vivant seules ou en couple sans enfant ou encore résidant dans les DOM sont les plus touchées par le défaut d’équipement comme par le manque de compétences. En France, le niveau global de compétences numériques est semblable à la moyenne européenne »[54].
Malgré ces inquiétudes légitimes sur les usages de l’écrit, le tableau n’est pas toujours aussi noir qu’il n’y paraît et qu’il convient de le nuancer. A cette fin, rappelons que les résultats de l’enquête PISA, bien que souvent critiqués à juste titre sur leur absence de prise en compte des appartenances culturelles des enquêtés, constatent pour les jeunes hexagonaux âgés de15 ans et scolarisés qu’après un fort décrochage entre 2000 et 2006, la France stabilise ses résultats en 2018 : en compréhension de l’écrit, le score moyen des élèves français est stable à 493 (496 en 2009) et nettement au-dessus de la moyenne de l’OCDE (487 points). Les élèves français sont au niveau de l’Allemagne ou encore de la Belgique entre le 20 et 26e rang des pays de l’OCDE[55].
Conclusion
Illettrisme, retour sur sa quantification
Pour conclure, je souhaite revenir sur les chiffres de l’enquête Insee sur le nombre d’adultes en situation d’illettrisme. Selon l’institut de la statistique : « en 2011, 16 % des personnes de 18 à 65 ans résidant en France métropolitaine éprouvent des difficultés dans les domaines fondamentaux de l’écrit, et pour 11 % ces difficultés sont graves ou fortes. Parmi celles qui ont été scolarisées en France, 7 % sont dans ce cas et peuvent donc être considérées en situation d’illettrisme »[56]. Bien que ces chiffres soient le résultat d’une enquête d’une grande rigueur scientifique, il convient de les analyser de plus près.
Les 7 % d’adultes reconnus en situation d’illettrisme renvoient à une population répartie entre 18 et 65 ans. Il faudrait donc pour obtenir une quantification plus exacte de l’illettrisme y ajouter nombre de jeunes gens de moins de 18 ans, sortis de l’obligation scolaire qui sont dans cette situation. Situation bien connue d’ailleurs des professionnels des missions locales, des médiathèques et des responsables de la défense nationale. A ces jeunes il faudrait aussi y associer les personnes âgées d’au moins 65 ans dans la même situation qui représentaient en 2018, 19,6 % de la population[57]. 7 % semble donc une quantification largement sous-estimée dans la mesure où elle exclut une part non négligeable de la population.
Illettrisme, retour sur sa définition
Au Moyen Age déjà certains étaient considérés comme des illettrés mais alors la définition était loin de celle que nous connaissons aujourd’hui. Au 11e et 12e siècle sont « classés dans la catégorie illiterati » des laïcs lecteurs qui ne lisent que leur langue vernaculaire. « La notion de litteratus servant à désigner un individu qui maîtrise le latin »[58]. Catégorisation confirmée dans un entretien avec Isabelle Heulant-Donat intitulé Ce que savoir lire (et écrire) veut dire dans le même numéro de L’Histoire. Elle déclare : « en haut de la hiérarchie se trouve le litteratus, celui qui maîtrise le latin. L’illiteratus est celui qui l’ignore ».
A l’époque, l’illettré était donc un lecteur, ce qui au regard de la définition actuelle donne à penser. Distinction et catégorisation qui perdurera jusqu’au 18e siècle au moins comme en témoigne Hervé Terral. Il écrit : « l’illettrisme reçoit, chacun le sait, diverses acceptions et mesures, hier comme aujourd’hui. Dans le mitan du XVIII siècle, Lord Chesterfield peut ainsi écrire à son fils :
« Les connaissances classiques, c’est-à-dire le grec et le latin, sont absolument nécessaires à tout le monde, parce que tout le monde s’accorde sur ce point et le mot illettré, dans son acception commune, qualifie un homme qui ignore ces deux langues »[59].
Tout en conservant la définition de l’illettrisme définit par l’ANLCI en 2003 qui me semble toujours pertinente, il faudrait sans doute y ajouter en 2020 une allusion à la nécessaire acculturation au numérique. Je la rappelle pour mémoire : « l’illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu’ayant été scolarisées, ne parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des situations de leur vie quotidienne, et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre des informations simples.
Pour certaines personnes, ces difficultés en lecture et écriture peuvent se combiner, à des degrés divers, avec une insuffisante maîtrise d’autres compétences de base comme la communication orale, le raisonnement logique, la compréhension et l’utilisation des nombres et des opérations, la prise de repères dans l’espace et dans le temps, etc. Malgré ces déficits, les personnes en situation d’illettrisme ont acquis de l’expérience, une culture et un capital de compétences en ne s’appuyant pas ou peu sur la capacité à lire et à écrire. Certaines ont pu ainsi s’intégrer à la vie sociale et professionnelle, mais l’équilibre est fragile, et le risque de marginalisation permanent.
D’autres se trouvent dans des situations d’exclusion où l’illettrisme se conjugue avec d’autres facteurs ». Définition qui a le mérite de reconnaître des talents et des compétences à certains d’entre nous dépourvus ou mal pourvus en matière de maîtrise de l’écrit.
Si cette définition est acceptable pour les sociétés alphabétisées, je souhaite pour clore ce texte revenir sur l’importance des cultures des sociétés orales qui sans alpha ne sont pas autant bêtes et dépourvues de mille et un savoirs.
Connaissances autres qu’il serait bon de préserver par-delà la nécessité de l’écrit. James Scott, et j’en terminerai là, à mon sens en a parfaitement cerné la problématique. Il écrit : « j’ai choisi d’utiliser les termes d’allettrisme et d’oralité, plutôt que de parler d’illettrisme [au sens d’analphabétisme note HL], afin d’attirer l’attention sur le fait que l’oralité constitue un vecteur différent et potentiellement positif de la vie culturelle, par opposition à une pure déficience »[60].
Proposition à laquelle je m’associe sans réserve même si je considère le livre à l’instar de quelques progressistes de la fin du 19e siècle comme un vecteur incontournable de l’émancipation.
Hugues Lenoir
Enseignant chercheur émérite, Université Paris-Nanterre
Lisec EA 2310
[1] Lahire B., 1999, L’invention de l'”illettrisme”, Paris, éditions la Découverte, p. 316.
[2] Scott James C., 2019, Zomia ou l’art de ne pas être gouverné, une histoire anarchiste des hautes terres d’Asie du Sud-Est, Paris, Seuil.
[3] Scott James C., 2019, op. cit., p. 414.
[4] Offenstadt Nicolas, Les crieurs publics au Moyen Age, L’Histoire, n° 362, mars 2011. Les crochets ajoutés par moi.
[5] Les Lumières ou le désir d’écrire, entretien avec Roger Chartier, L’Histoire, n° 334, septembre 2008.
[6] Une histoire des plaisirs de la table, rencontre avec Jean-Louis Flandrin, propos recueillis par Nicolas Journet, Sciences humaines, n° 106, juin 2000.
[7] Bercé Y.-M., 1980, Révoltes et Révolutions dans l’Europe moderne, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, PUF, p. 12.
[8] Ibid., p. 129.
[9] Perdiguier A., 1851, (2002 réédition), Mémoires d’un compagnon, Paris, La découverte, p. 258.
[10] Rappe D., 2004, La Bourse du Travail de Lyon, une structure ouvrière entre services sociaux et révolution sociale, Lyon, Atelier de Création libertaire, p. 44.
[11] Mintz F., 1999, Autogestion et anarcho-syndicalisme, analyses et critiques sur l’Espagne 1931-1990, Paris, Editions CNT Région parisienne, pp. 69-70.
[12] Lenoir H., 2005, Syndicalisme et situations d’illettrisme, militants et savoirs de base, CREF-CRIEP-Paris X.
[13] Loko S., Députés analphabètes pour électeurs illettrés, Le Marabout, Ouagadougou in Courrier international
n° 616, Août 2002.
[14] Thierry A., 1964 (?), Réflexions sur l’Education, Blainville s/mer, L’amitié par le livre, p. 57, publié en 1913 à la Librairie du travail.
[15] Ploux François, Les curés historiens de village et les tentatives de restauration de l’autorité cléricale après la Révolution, Le Mouvement social, n° 224, juillet-septembre 2008, p. 30.
[16] Vaneigem R., 2005, Le Mouvement du libre esprit, Aoste, L’or des fous éditeurs, p. 194.
[17] Minois Georges (1998), Histoire de l’athéisme, Paris, Fayard, p. 99.
[18] Auvray M., 1998, L’âge des casernes, histoire et mythes du service militaire, Editions de l’aube, p. 157.
[19] Ibid., p. 172.
[20] Ibid., p. 157.
[21] Ibid., p. 158.
[22] Ibid., p. 156.
[23] Lyons M., Librairies et bibliothèques au XIXe siècle in Girault J. (dir.), 1998, Ouvriers en banlieue, Paris, Editions de l’Atelier, pp. 393-394.
[24] Ibid., pp. 393-394.
[25] Ibid., p. 398
[26] Ravier J., L’histoire de la formation technique et professionnelle à Roubaix de 1800 à 1940 in Bodé G., Marchand P., 2003, dir., Formation professionnelle et apprentissage, Revue du Nord-INRP, Paris-Lille, p.198.
[27] Lyons M., op. cit., p. 396.
[28] Ravier J., op. cit., p. 195.
[29] Palazzeschi Y., 1998, Introduction à une sociologie de la formation, les pratiques constituantes et les modèles, tome 1, Paris, L’Harmattan, p.19. L’auteur fait allusion au 19e siècle. Entre parenthèses, ajouté par moi.
[30] Baczko Bronislaw, Et le peuple devint souverain (entretien), L’Histoire, n° 342, mai 2009, p. 46.
[31] Winoch M., 2001, Les voix de la Liberté, Paris, Seuil, p. 82.
[32] Ibid., p. 549
[33] Vigna X., 2016, L’espoir et l’effroi, luttes d’écritures et luttes de classes en France au XXe siècle, Paris, Ed. La Découverte, p. 12.
[34] Jaurès J., 2005, De l’éducation (Anthologie), Paris, Editions Syllepse, pp. 96 et 97. Voir aussi sur le chapitre consacré à Jaurès in Lenoir H., 2020, Educateurs libertaires et socialistes, Convergence des pédagogies libertaires avec les courants de l’éducationnisme socialiste, Lyon, ACL.
[35] Pelloutier F., 1898, Le musée du travail, L’ouvrier des deux mondes (1er avril), p. 91. Réédité par Lecercle J.-P., 2002, in L’Art et la Révolte, Paris, Editions Place d’armes.
[36] Pelloutier F., L’ouvrier des deux mondes, n° 15, mai, 1898.
[37] Anna Mahé en cohérence simplifiait l’orthographe d’où la graphie utilisée dans ce texte. Idem pour le titre du journal sans majuscule. Elle fut supprimée, là encore dans un esprit de simplification.
[38] Se reporter à Lenoir H., 2015, Les anarchistes individualistes et l’éducation (1900 – 1914), Lyon, ACL.
[39] Le Porho G., 2016, Syndicalisme révolutionnaire et éducation émancipatrice, l’investissement pédagogique de la Fédération unitaire de l’enseignement, 1922-1935, Paris Ed. Noir et Rouge, p. 201.
[40] Mignon J.-M., 2007, Une histoire de l’éducation populaire, Paris, La Découverte, pp. 90-91.
[41] Perdiguier A. 1851 (2002 réédition), op. cit., pp. 40-41 et 44.
[42] Ibid., pp. 53-54.
[43] Borne D., Dubief H., 1989, La crise des années 30, (1929-1938), Nouvelle histoire de la France contemporaine T.13, Paris, Seuil, p. 264.
[44] Burgos A., 2002, Les cours d’adultes de Pierre Sacreste, instituteur de la IIIe République, Paris, Les Editions de Paris, p. 15.
[45] Cité par Baillargeon N., 2005, in Education et Liberté, Tome 1, 1793-1918, Lux éditeur, Montréal, p. 192.
[46] Chartier A.-M., Hébrard J., 2000, Discours sur la lecture (1880-2000), Paris, Bibliothèque du Centre Pompidou-Fayard, p. 319. Parenthèses et guillemets dans le texte.
[47] Chambat G., 2016, L’école des réac-publicains, Paris, Ed. Libertalia, p. 101.
[48] Chartier A.-M., Hébrard J., 2000, op. cit., p. 366. Italiques dans le texte.
[49] Pelpel P., Troger V., 2001, Histoire de l’enseignement technique, Paris, L’Harmattan, p. 170. En italiques dans le texte.
[50] Lahire B., Savoirs et techniques intellectuelles à l’école primaire in Van Zanten A., 2000, dir., L’école, l’état des savoirs, Paris, Editions la Découverte, p. 174.
[51] La « culture du certif », recension de Cabanel P., La République du certificat d’études, Paris, Belin in L’Histoire, n° 272, janvier 2003.
[52] Troger V., L’école en débat, Sciences humaines n° 100, sept. 1999.
[53] Fourier M., Les nouvelles technologies à l’école, Sciences humaines, n° 106, juin 2000.
[54] Insee première, n° 1780, octobre 2019
[55] Source : Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, education.gouv.fr.
[56] Insee première n° 1426 – décembre 2012.
[57] Insee, tableaux de l’économie française, Edition 2018
[58] Chastang P., Moyen-Age une révolution de l’écrit, L’Histoire n° 463, septembre 2019,
[59] TERRAL H., 2001, L’illettré(e) et son maître : Des fins politiques et morales aux processus d’acculturation. Etude des représentations dominantes dans la pensée pédagogique de la IIIe République de 1878 à 1918, Paris, L’Harmattan, p. 223, Terral cite la Lettre 120, Cousinet, 1954.
[60] Scott James C., 2019, Zomia ou l’art de ne pas être gouverné, une histoire anarchiste des hautes terres d’Asie du Sud-Est, Paris, Seuil, p. 409.