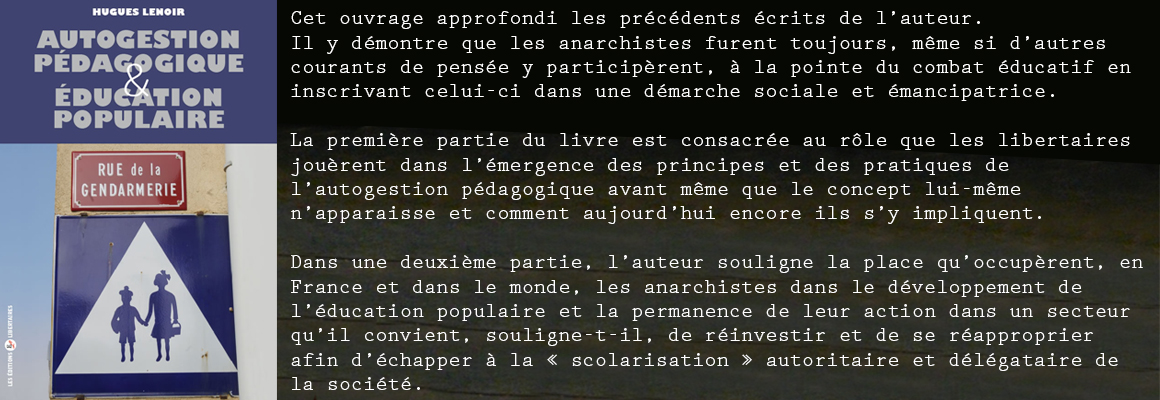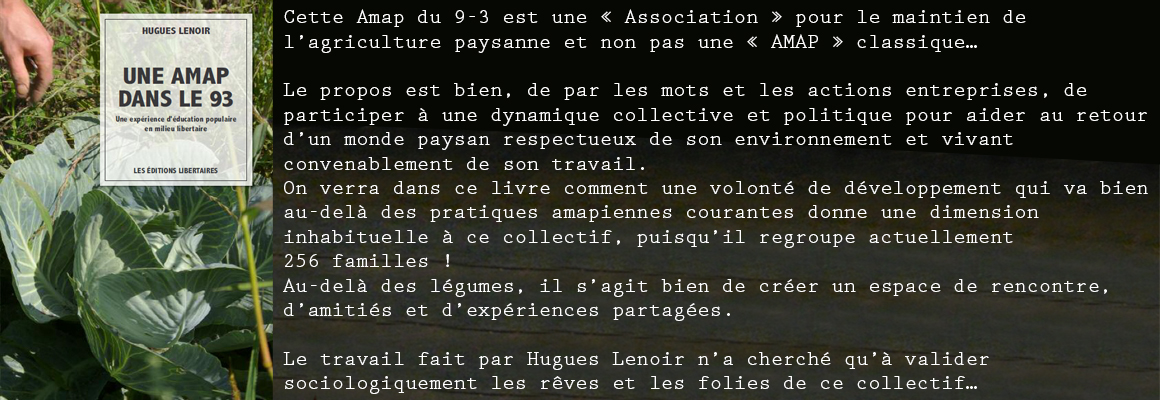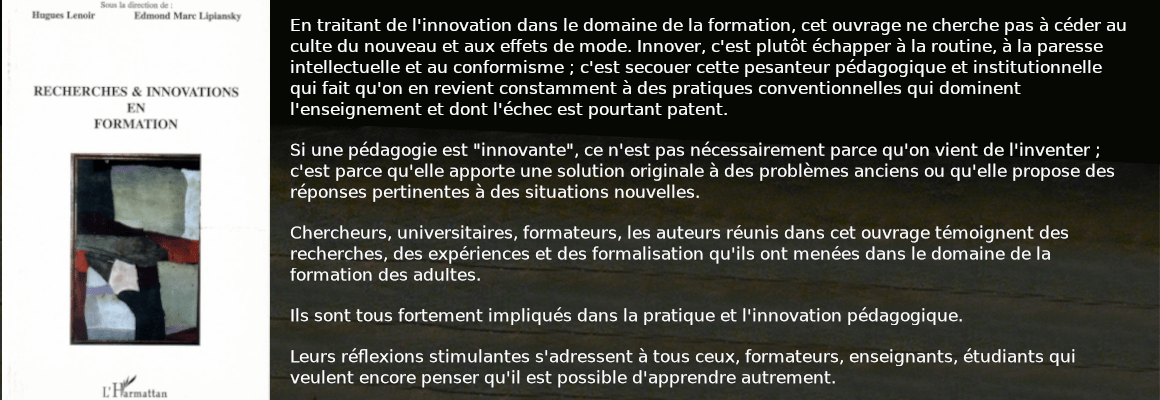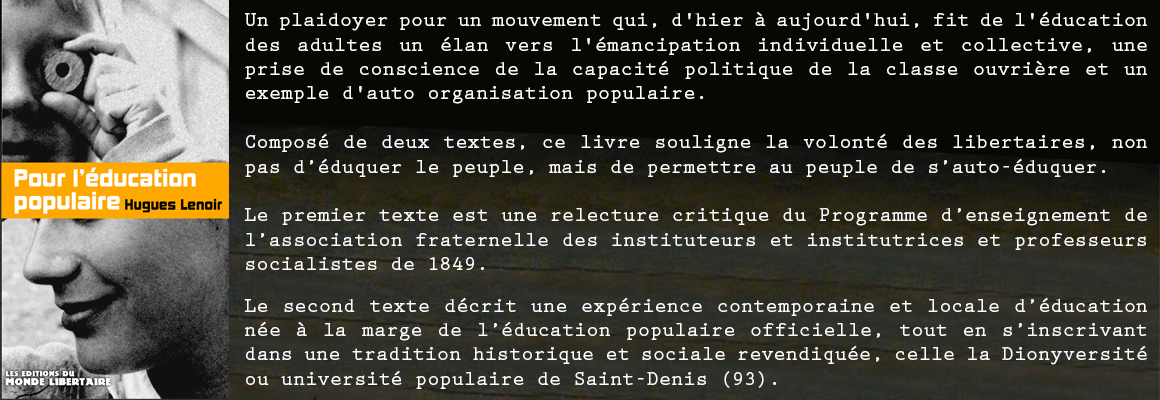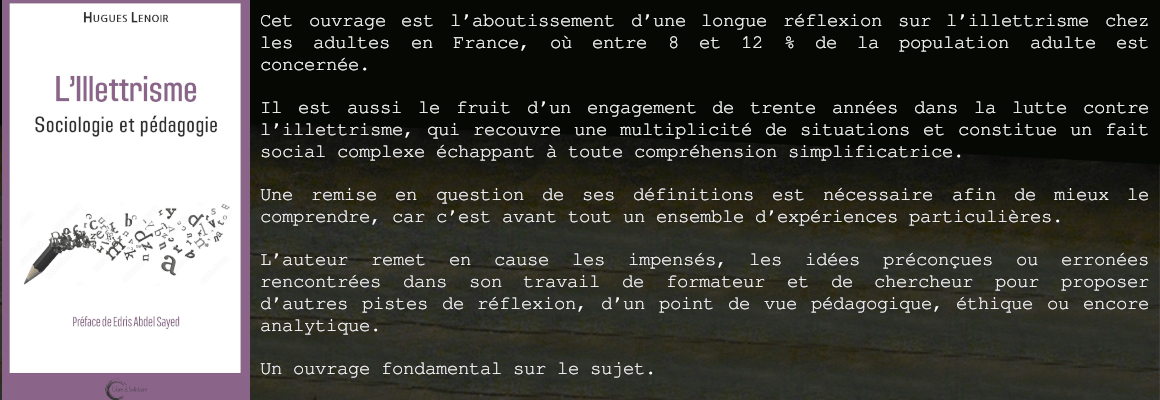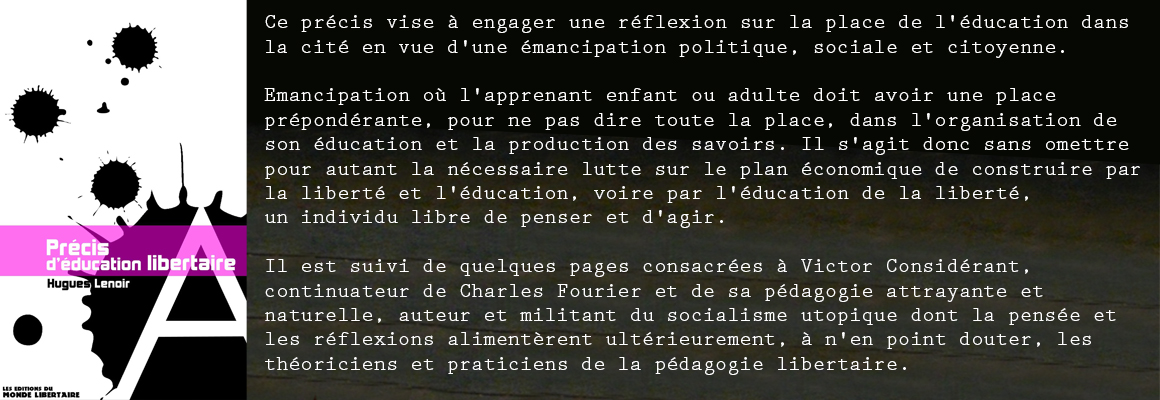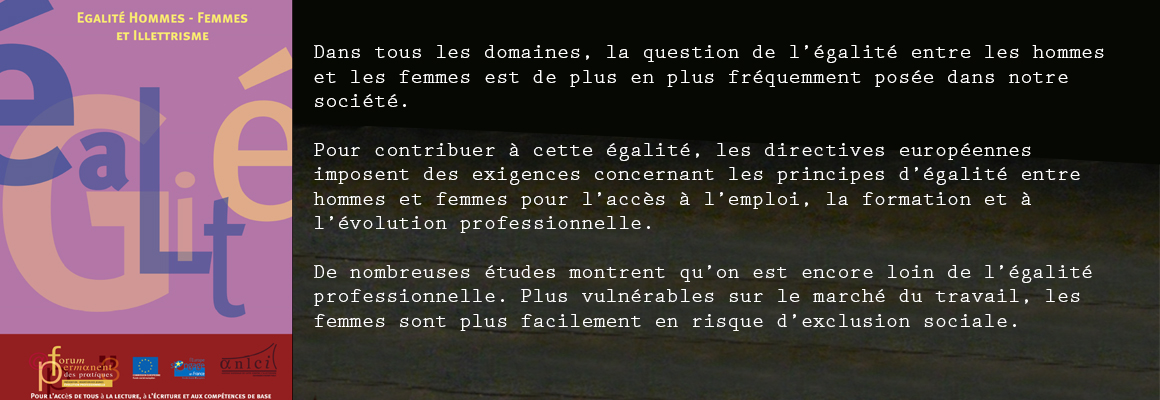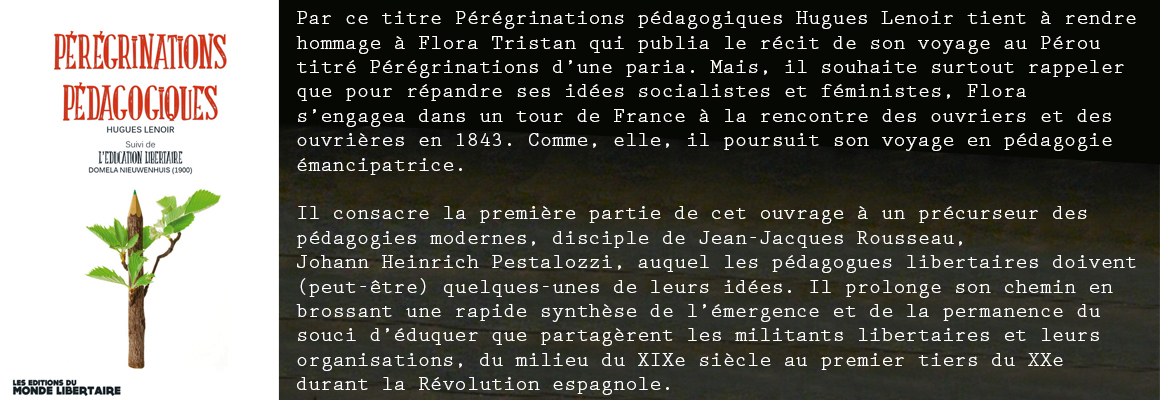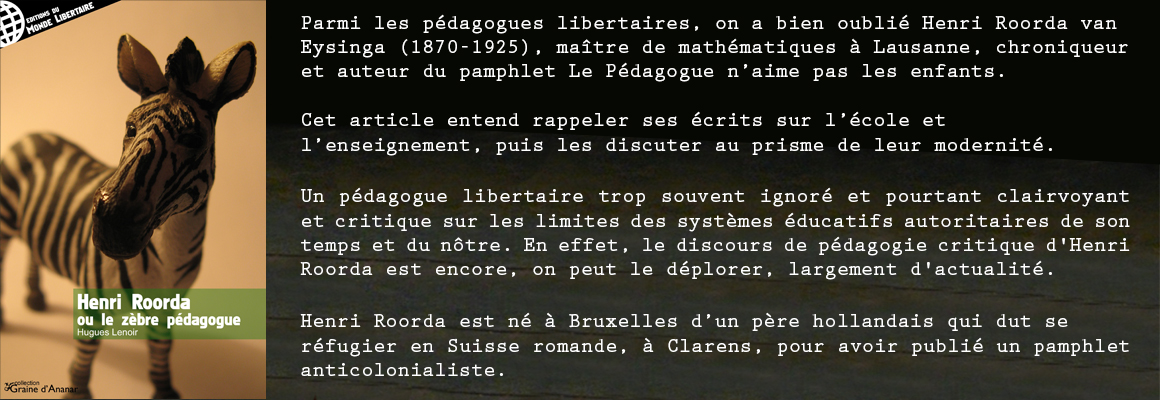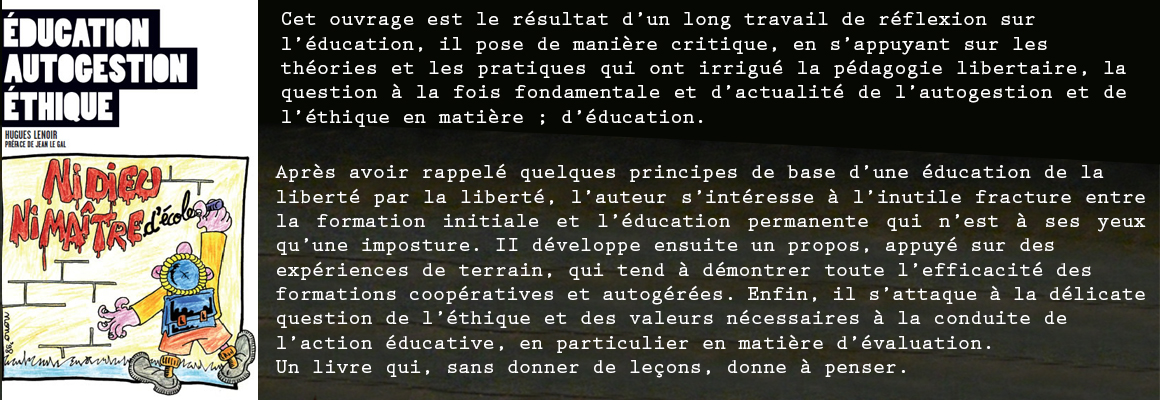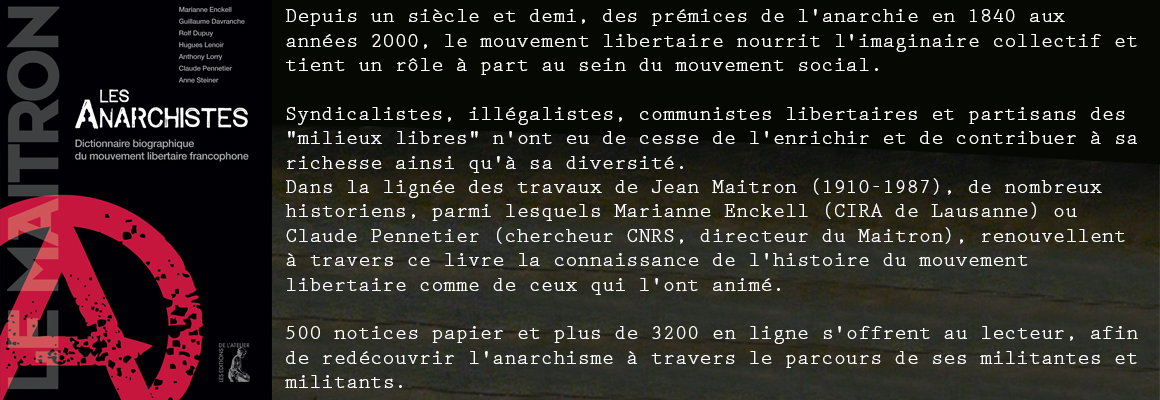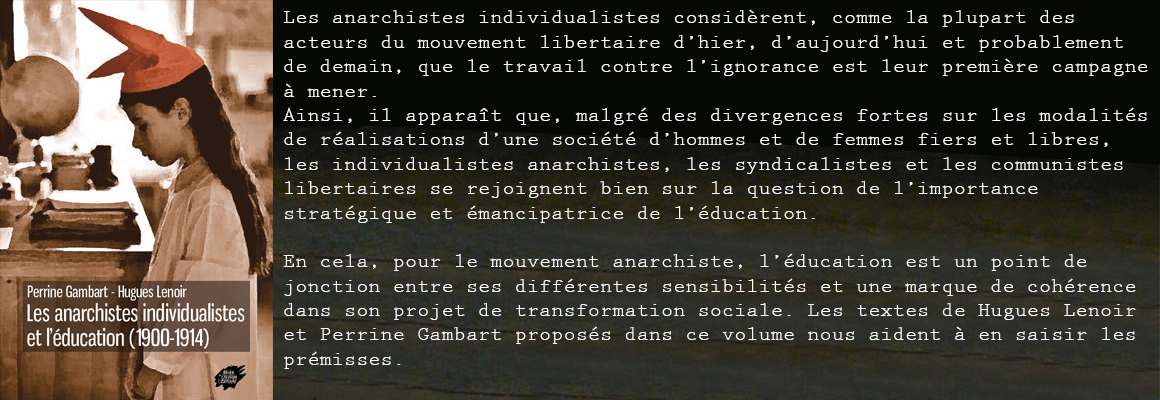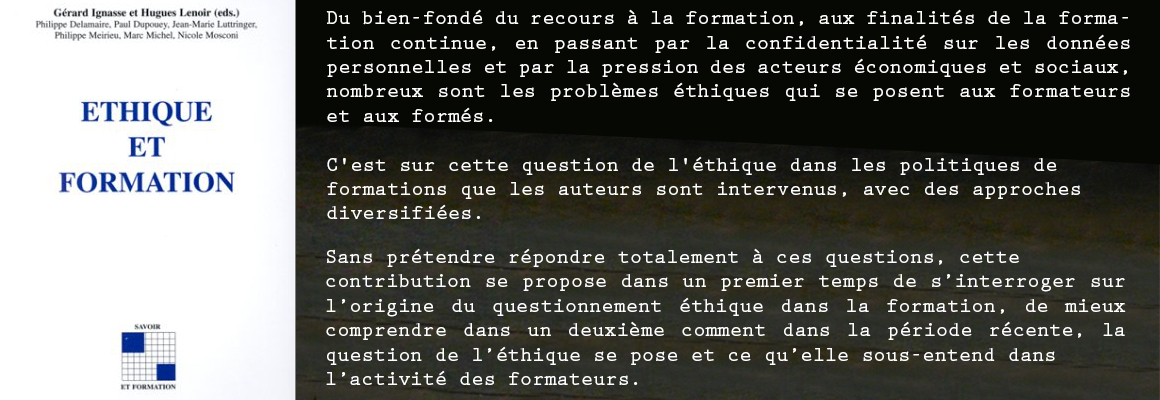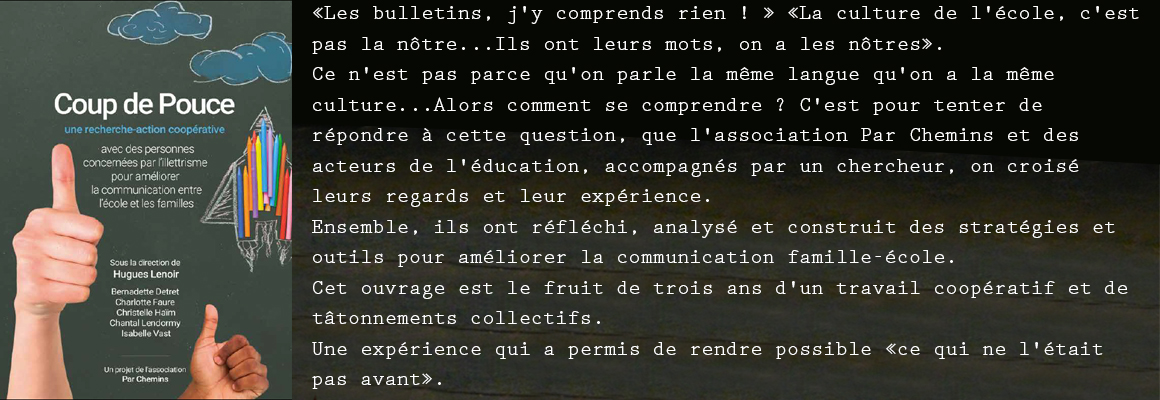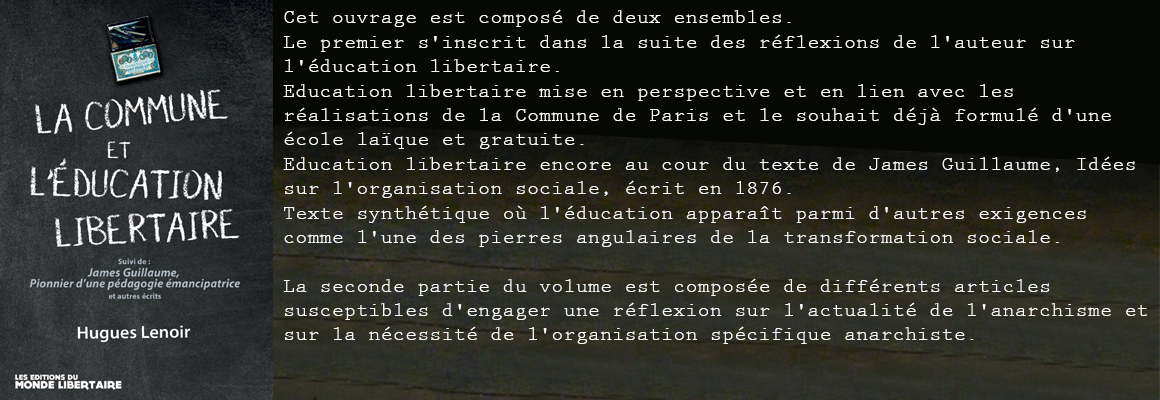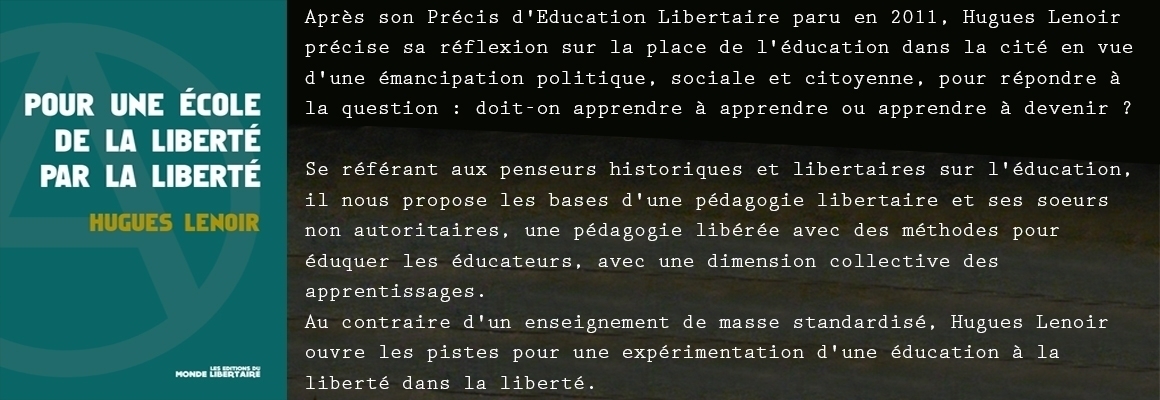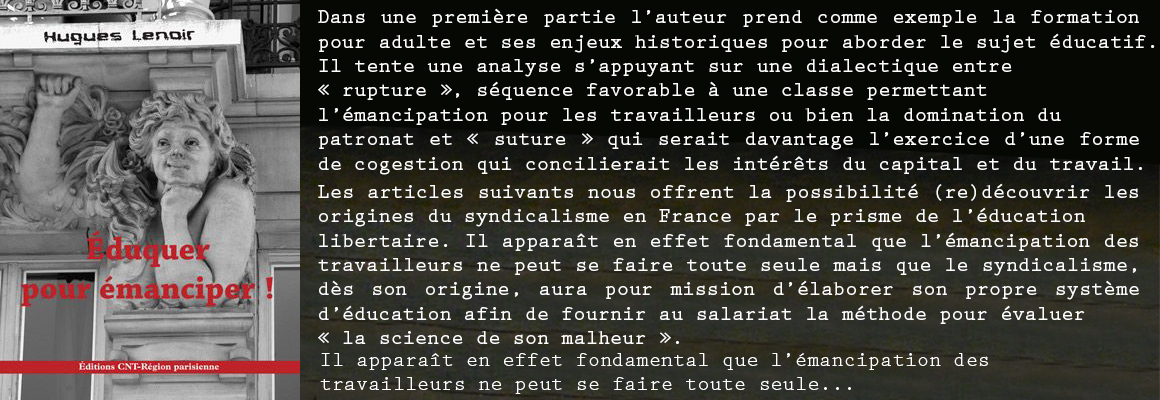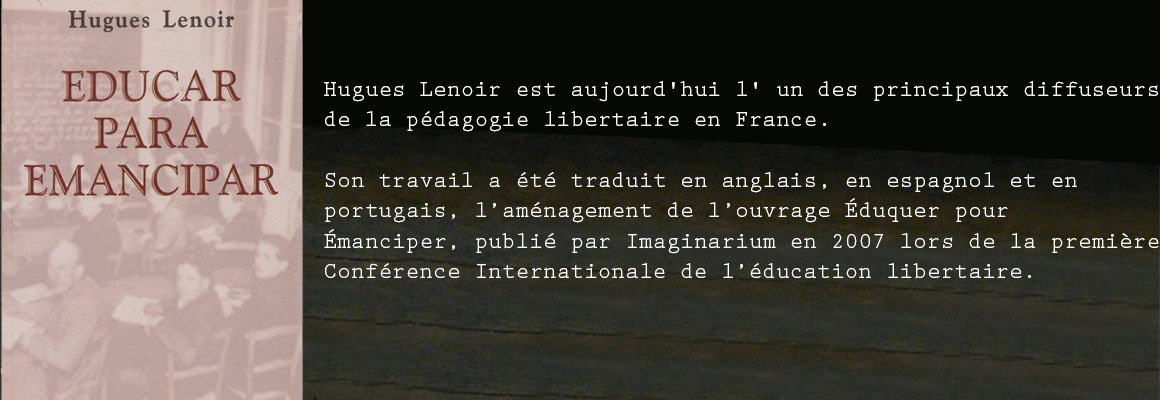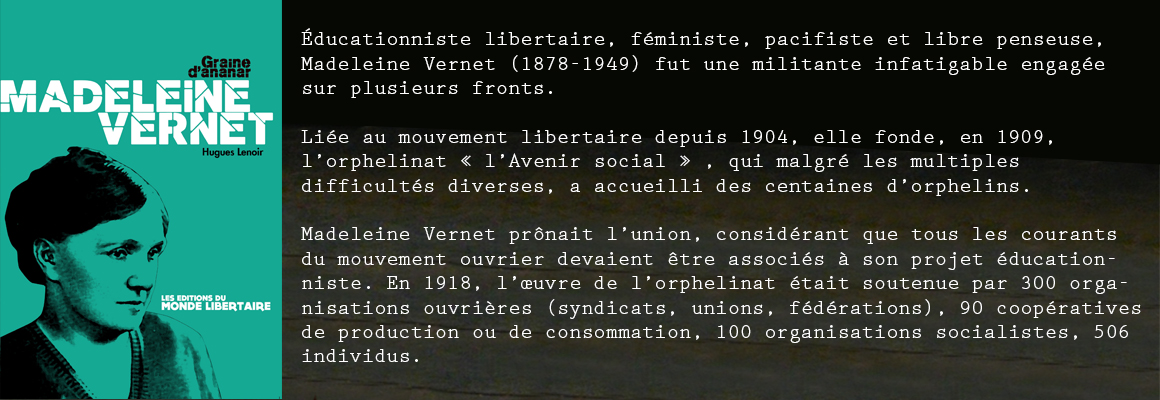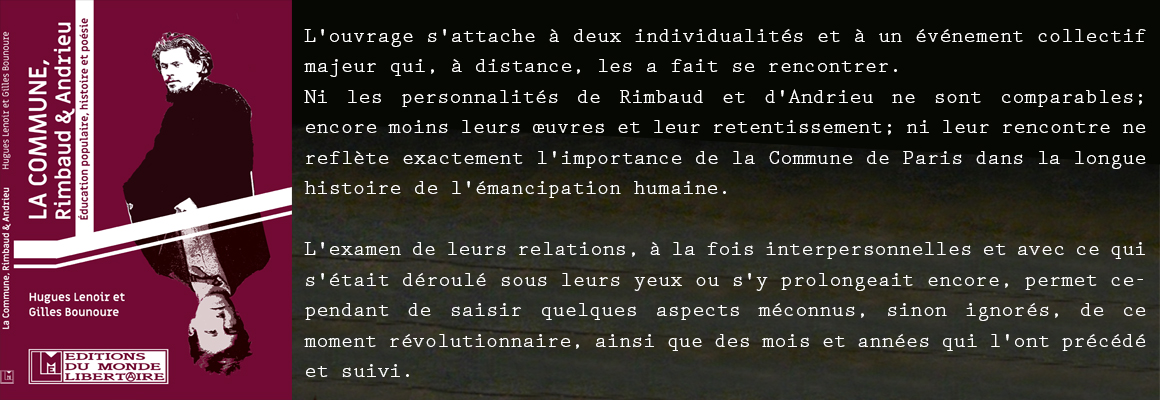VAE-Strasbourg
8 et 9 oct 09
VAE, compétences et Jury Universitaire
Cette communication repose sur ma propre posture de membre de jury VAE (Validation des acquis de l’expérience), de co-concepteur du module de formation à l’évaluation des acquis pour les enseignants chercheurs membres de jurys dans le cadre du plan de formation organisé par la Conférences des directeurs de services communs de formation continue et de ma réflexion sur l’évaluation et la Formation continue à l’Université.
Elle vise :
– à s’interroger sur la notion de compétence professionnelle et de qualification dans le monde universitaire,
– à s’interroger sur la légitimité des enseignants chercheurs quant à la validation de compétences professionnelles (et sociales) auxquelles leurs enseignements sont supposés préparer,
– à s’interroger sur la nature de la formation à proposer aux juges universitaires en matière de VAE donc de poser, plus généralement la question de l’évaluation,
– à engager une réflexion sur la nature et la forme des prescriptions en cas de validation partielle.
La VAE est de fait une source de rupture, plus ou moins acceptée et comprise dans le monde universitaire. Elle est à la fois une source de déséquilibre, de nouveautés, de résistance mais aussi d’intérêt voire d’enthousiasme militant. Elle est un nouvel élément à intégrer dans un univers assez conservateur à l’histoire multi séculaire. Elle représente un nouveau concept et de nouvelles pratiques à intégrer à un système complexe, quelquefois sans grande souplesse face à des forces exogènes dont on a du mal à penser les effets a priori.
I Quid de la compétence et de la qualification en milieu universitaire ?
1.1. Apparition de la compétence
La notion de compétence fait partie des termes et des concepts apparus récemment à l’Université, vers la fin des années 1990. A l’exception, il faut le souligner des Services Communs de Formation Continue (SCFC) et de quelques îlots en particulier les IUT ou les IAE par exemple en contacts étroits depuis longtemps avec les secteurs professionnels. Cette apparition s’est faite en plusieurs étapes et à partir de plusieurs sources convergentes. Il s’agit de fait d’un mouvement de fond, celui de la logique compétence. D’abord à l’œuvre à l’extérieur des universités, dans les entreprises, il a peu à peu impacté l’enseignement supérieur.
Tout d’abord chez les acteurs de la VAP (validation des acquis professionnels) et de la VAE depuis les lois de 1992 et 2002, avec dès 1993 la réalisation d’une « mallette pédagogique » sur la VAP qui contenait un glossaire où apparaissaient déjà les termes de mission, compétence, emploi, poste… Puis, au cours du processus de professionnalisation de certains titres en particulier les DESS et les DU. Enfin, dans le cadre du processus de Bologne (supplément aux diplômes) et du LMD (Licence et Master professionnels) pour l’inscription des DE et des DU au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) suite à la loi de 2002 avec l’obligation de produire des référentiels de compétences ou « fiche répertoire ».
Mais la résistance à la logique compétence s’explique par le fait que les universitaires ont de la mémoire et du savoir ce qui a rendu suspecte, aux yeux de certains, durant toute une période cette notion nouvelle. Et qu’il convenait de désamorcer un malentendu afin que ce concept puisse être entendu et accepté dans les milieux universitaires. Il s’agissait de clarifier cette notion aux multiples définitions et de préciser l’évolution de la compétence considérée comme un élément de la qualification et non comme concurrente de cette dernière. Qualification, constituée de compétences, qui implique une reconnaissance nationale et une durée longue. Et surtout de marquer le refus de l’arbitraire de la reconnaissance de la compétence par la seule entreprise et de refuser sa volatilité ainsi que son obsolescence au gré d’instances discrétionnaires.
En effet il convient de rappeler que le terme et le concept de compétence a été mis à la mode par le CNPF, aujourd’hui MEDEF, à la fin des années 1990 lors des journées de Deauville. Terme, qui fut à juste titre durant un temps considérée comme une machine de guerre contre la qualification, sa reconnaissance nationale et sa durée. Les travaux d’Elisabeth Dugué et Lucie Tanguy en témoignent encore.
Le CNPF donnait en 1998 la définition suivante de la compétence : « La compétence professionnelle est une combinaison de connaissances, savoir-faire, expériences et comportements s’exerçant dans un contexte précis. Elle se constate lors de la mise en œuvre en situation professionnelle à partir de laquelle elle est valable. C’est donc à l’entreprise qu’il appartient de la repérer, de l’évaluer, de la valider et de la faire évoluer »[1]. Même si les universitaires pouvaient s’accorder sur la première partie de cette définition, ils ne pouvaient accepter que la reconnaissance de la compétence, voire sa production, n’appartiennent qu’au monde de l’entreprise. En effet, si l’on s’en tient à cette définition, les universitaires sont immédiatement disqualifiés, mis hors du champ, d’où la nécessité de faire évoluer cette définition et/ou de considérer que d’autres lieux et d’autres indicateurs, en dehors des situations professionnelles observées, peuvent permettre de produire, repérer et valider les dites compétences. Cela implique de choisir et d’imposer, ou mieux de faire partager, au monde professionnel d’autres définitions plus compatibles avec le monde universitaire et les « compétences » des jurys en matière de délivrance des diplômes. Celle que donne Yves Lichtenberger va dans ce sens : « la compétence, selon lui, exprime la façon particulière dont un individu mobilise ses ressources et prend la responsabilité de l’activité professionnelle (ou sociale) qui lui est confié et ses enjeux »[2].
Cette première définition, plus consensuelle, place l’apprenant au cœur de la mobilisation de ses propres ressources qui lui donnent capacité à agir, à être compétent sans dire d’où proviennent ses ressources donc potentiellement de l’Université ce qui restitue une place légitime à celle-ci dans le processus de construction de la compétence. Ou encore, la définition de de Montmollin pour qui la compétence est un « ensemble stabilisé de savoirs et savoir-faire, de conduites types, de procédures standard, de types de raisonnements que l’on peut mettre en œuvre sans apprentissage nouveau »[3]. Seconde définition alternative à celle du CNPF qui postule que les savoirs acquis, sans en préciser le lieu et les circonstances, produisent des capacités à agir. Ces deux définitions permettent de faire l’hypothèse, voire de reconnaître, que le travail intellectuel prépare à l’action et éventuellement par réciprocité de faire accepter, en contre partie, que l’action, en tant que mobilisatrice de ressources, produit du savoir et ainsi de faire entendre l’idée d’une validation des acquis de l’expérience par les acteurs de l’université.
1.2 Diplôme et compétence
L’approche compétence fit apparaître un autre problème, celui de la conception et de la construction des diplômes. Jusqu’alors, en caricaturant, les diplômes étaient construits, d’une part, dans une logique de programme donc de contenu, c’est-à-dire exclusivement ou presque en termes de connaissances. D’autre part, les diplômes étaient conçus en lien avec les axes de recherche de l’équipe enseignante, en fonction des savoirs disponibles dans la dite équipe et souvent sans préoccupation forte des capacités « à faire » à l’issue du processus d’apprentissage. En bref, sans liaison stable, sauf exception, avec le monde professionnel. Ces diplômes étaient donc élaborés souvent sans interrogation sur le lien ou les proximités avec les qualifications visées, sauf en termes de niveaux de sortie, 3, 2, 1… Ils ne priorisaient pas la mise en œuvre des savoirs et ils ne privilégiaient pas les articulations immédiates et fortes avec des activités à conduire dans le monde professionnelle même si cela, je le répète, était la préoccupation de certains.
La compétence a pour conséquence de définir implicitement une nouvelle mission pour l’Université. Il ne s’agit plus de transmettre et de faire acquérir, voire produire des savoirs ex abrupto plutôt théoriques, abstraits bien souvent et sans lien forcément immédiats avec l’activité de travail. Il ne s’agit plus de former presque exclusivement l’intelligence (pôle cognitif) et de favoriser l’acquisition de connaissances sans nécessité immédiate d’application mais de transmettre des « savoirs pratiques », des « savoirs d’action ». Ceci implique une rupture avec l’hypothèse selon laquelle l’étudiant bien formé intellectuellement est par définition adaptable et compétent, ce qui de mon point de vue est vrai bien souvent. Une nouvelle mission en dehors de la tradition, à nuancer néanmoins, rappelons que les études de médecine ou celles des juristes sont aussi « pratiques » et conçues pour l’action. Mission qui impose aux universitaires de s’intéresser au travail réel, à l’insertion dans l’emploi donc à la production de compétences et de qualification. Ce qui conduit l’acteur universitaire à s’interroger : quels savoirs faire acquérir ? A quoi servent ou pourraient servir les savoirs que je souhaite partager ? Quelle finalité pratique aux enseignements que je propose ? En bref pour les universitaires en général, l’on peut affirmer qu’il y a autour de la compétence un réel changement de paradigme.
1.3 Risque de la compétence
Le danger bien réel de la logique compétence est de faire déraper l’exigence et le savoir universitaires vers une réalité plus triviale, celle de l’utilitarisme des savoirs, centré sur l’outillage, dans le meilleur des cas méthodologiques, au détriment du recul critique et de l’appareillage théorique. Passage du savoir savant au savoir d’action avec le risque pour les universitaires de voir naître un sentiment de « déqualification », voire d’incompétences dans la mesure où ils ne furent pas formés pour ce type de transmission ni techniquement ni culturellement, ni idéologiquement. En effet, il s’agit de glisser du savoir à dimension, ou pour le moins à prétention, universelle (université) aux savoirs en situation et contextualisés. Évolution ayant pour éventuelle conséquence la démonétisation des certifications, une dépréciation des savoirs et une déqualification des universitaires.
Crainte légitime, au regard de la professionnalisation à marche forcée si l’on en croit certains observateurs car d’autres exemples existent, même si tout n’est pas égal par ailleurs. En effet, si l’on en croit Moncef Marzouki ancien Président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme : « Dans les années 1960-1970, le niveau de débat dans les universités arabes était extrêmement élevé (…). L’Université arabe a joué à la fois le rôle de « grande école » des idées et d’apprentissage des actions (…). Malheureusement, à partir des années 1980, ce rôle central de l’Université comme espace de protestation à commencer à décliner (…). Elles ont été transformées malgré elles en « écoles professionnelles », perdant ainsi leur rôle d’école de la vie et encore davantage de lieux de formation politique »[4]. Il conviendrait donc de lever les craintes légitimes de certains et certaines. De telles mises en garde devraient, pour le moins, nous inciter à réfléchir aux limites, voire au danger de l’usage non distancié de la professionnalisation et de la compétence comme nous y invitent aussi Rachel Bélisle et Jean-Pierre Boutinet : « dans plusieurs pays, écrivent-ils, les formations elles-mêmes et les référentiels des diplômes tiennent d’avantage compte qu’avant des attentes du marché du travail, posant des défis de taille à l’intégration et à l’appropriation des savoirs scientifiques dans les formations de plus en plus professionnalisantes »[5].
II Quid de la légitimité des enseignants chercheurs ?
A l’évidence la compétence introduit une rupture avec la docte habitude universitaire et impose un nouveau questionnent : qu’est-ce que la compétence ? Quels sont les qualifications et les emplois auxquels préparent ce diplôme ? Quels contenus en conséquence y faire apparaître. Autant de questions nouvelles pour beaucoup, qui furent bien évidemment « in-posées[6] » aux universitaires le plus souvent sous forme d’injonctions : sans débat, sans préparation, sans formation…
2.1 Être ou devenir légitime
Être légitime du point de vue de la recherche n’implique pas de l’être du point de vue du Travail et de la sphère professionnelle, d’autant que, je le répète en dehors des IUT et des SCFC, les liens entre université et monde du travail étaient très distendus, voire inexistants. Il convient donc d’interroger la légitimité des universitaires à produire et à valider de la compétence à partir de la formation des enseignants du supérieur, de leur rapport au savoir, de leur expérience professionnelle – hors l’enseignement et la recherche – de leur connaissance du monde du travail et de l’environnement socio-économique, connaissance qui de fait est souvent partielle, faite de représentations ou encore souvent livresque, voire parfois même anecdotique. Un tel état des lieux a priori et en toute objectivité ne rend pas l’enseignant-chercheur automatiquement légitime, non pas pour attester l’acquisition de savoir, mais pour attester de compétences le plus souvent professionnelles. En effet, l’exigence professionnelle pour les enseignants-chercheurs est de produire du savoir, en s’appuyant sur la recherche, dans leurs enseignements ce qui implique souvent une recherche plus fondamentale qu’appliquée qui est laissée à d’autres acteurs. Dans ce contexte l’injonction « compétence, qualification, professionnalisation » produit une rupture forte dans l’Université, une rupture contre-épistémologique. La nature des savoirs à faire acquérir est d’une autre nature souvent considérée, à tord ou à raison, comme moins nobles et l’Université (avec une majuscule) devient dans cette dynamique professionnalisante un lieu d’enseignement technique et professionnel. Ce changement de finalité du travail universitaire est à interroger radicalement afin d’éviter le risque de se plier au pragmatisme et à l’utilitarisme des Écoles de Commerce.
Autre dilemme en débat qui renvoie à une posture éthique, la compétence en recherche implique-t-elle une compétence suffisante pour former d’autres personnes que des chercheurs ? Ceci implique que le mouvement de professionnalisation des diplômes et la production de compétences touche à l’identité professionnelle des enseignants-chercheurs et à leur formation voire même à des questions plus ontologiques : en quoi suis-je moi-même compétent ? Comment décliner mes compétences ? De plus, elle exige l’acquisition d’une nouvelle culture sur le travail et l’acceptation du changement de mission, hormis pour les études doctorales, de l’enseignement supérieur. Enfin, il faut ajouter, en filigrane, mais non pas sans fondement, la crainte de la main mise du secteur patronal sur le contenu des diplômes et les orientations de la recherche, sur l’autonomie et l’indépendance des équipe de recherche. Tension qui accentue encore le risque de rupture avec la tradition universitaire d’autonomie dans le contenu des diplômes et les axes auto-définis de recherche. Cette légitime crainte fut renforcée dans la dernière période par des textes récents (LRU), ce qui alimentent les résistances idéologiques et justifient l’éloignement souhaité par certains entre Éducation et Travail.
2.1 Pour un modus vivendi
Enfin la question de la compétence soulève aussi une question philosophique et épistémologique que l’on pourrait formuler ainsi : toutes les connaissances et tous les savoirs sont-ils faits pour l’action ? Et, si oui, pour quelle action : action en milieu de travail et/ou action dans l’espace social et citoyen ? L’injonction à la production de compétences ne concernerait que le monde professionnel. Est-ce bien là, la finalité de l’enseignement supérieur laïc ? En d’autres termes, tous les savoirs universitaires peuvent-ils, doivent-ils produire de la compétence (et si oui laquelle ?), doivent-ils viser à produire exclusivement de la compétence professionnelle ? Et en ce cas, quid de la compétence intellectuelle ? Quid de la compétence sociale, citoyenne ? Quid de l’humanisme et de l’universalisme affichés ?
Il est donc urgent et nécessaire de ré-interroger les notions de compétence et de qualification et sans les rejeter a priori y ajouter et y inclure une autre dimension que l’action en milieu de travail, une dimension sociale et citoyenne. Interrogation qui implique d’analyser ces concepts, de les déconstruire, de les reconstruire et de se former afin de pouvoir opérer une ré-écriture des programmes en référentiel de formation et/ou de certification, certes, mais sans se renier et sans faire fi des valeurs émancipatrices du savoir qu’il soit général, technique, scientifique… En bref, il y a nécessité de ré-investir et de s’approprier de manière universitaire, c’est-à-dire critique, ce concept valise de compétence afin de définir un modus vivendi et un modus operendi permettant à la fois de faire acquérir des savoirs et de produire des compétences observables et évaluables.
III VAE et jurys universitaires
Mesurer les savoirs académiques et évaluer les savoirs issus de l’expérience sont deux univers différents et demandent aux membres des jurys de VAE de mettre en œuvre d’autres pratiques, de définir d’autres critères, d’élaborer d’autres batteries d’indicateurs. Ce qui n’est pas rien dans un milieu où l’évaluation est loin d’être une « science » et où les pratiques en la matière sont le plus souvent issues de processus de reproduction que d’une réflexion théorique.
3.1 Une posture en évolution
Reste qu’évaluer des savoirs et évaluer de l’expérience productrice de savoirs demeurent, même pour les théoriciens de l’évaluation une question théorique fondamentale et bien réelle qui implique au-delà des pratiques, une évolution identitaire et un changement de posture des membres de jury. On ne juge pas la qualité et le niveau de l’expérience par la preuve comme on estime les savoirs par l’épreuve. Ce qui au-delà de la posture éthique déjà évoquée, relance l’interrogation : un universitaire est-il légitime pour certifier un niveau de compétences professionnelles ? Avant d’évoquer les compétences des jurys en matière d’évaluation des acquis de l’expérience, il convient de faire accepter aux acteurs universitaires que les savoirs transmis puissent produire de la compétence reconnue hors du monde universitaire où ils sont produits et de faire admettre que les savoirs de l’expérience ont même valeur, même s’ils sont de nature différente, que les savoirs académiques. Il convient aussi, de faire entendre que dans le monde contemporain, la reconnaissance professionnelle et la qualification sont aussi importantes que la légitimité académique.
Enfin, en matière de VAE, dans le cas d’une validation complète, il s’agit de faire accepter encore aux enseignants-chercheurs de n’avoir eu aucune prise, ni aucun contrôle a priori sur la production des compétences et des savoirs du candidat mais néanmoins de consentir, en toute souveraineté, à les valider académiquement et a fortiori professionnellement. Evolution considérable de la posture de l’enseignant-juge qui autrefois participait au processus d’acquisition/production du savoir, le sanctionnait et faisait éventuellement des hypothèses quant aux usages sociaux de ces savoirs.
Avec la VAE s’opère un renversement dialectique : l’enseignant n’a plus aucune responsabilité dans l’acquisition des connaissances et doit partager l’idée, par hypothèse, que l’expérience produit des savoirs légitimes avec « obligation » en tant que juge de les valider académiquement. La question n’est donc pas qu’une question de technique d’évaluation pour l’évaluateur, toujours solutionnable, mais bien une question éthique et un changement de posture radicale qui impacte fortement la tradition universitaire.
3.2 Former les jurys universitaires
Afin de parvenir à des jugements d’excellence et à des décisions sans possibilité de suspicion, les jurys universitaires, y compris les professionnels, devraient pouvoir systématiquement bénéficier d’une formation ad hoc. Celle-ci devrait[7], au-delà de savoirs sur l’évaluation, contenir des éléments de connaissance sur les textes juridiques qui organisent la VAE et sur l’esprit qui la fonde et la justifie. Il conviendrait aussi que cette formation aborde les concepts au cœur du processus de validation des acquis, à savoir les notions de compétences et de qualification, d’emploi-type, de référentiel… et qu’elle donne quelques clés en matière d’analyse du travail avec si possible, à des fins d’observation, un accès aux entreprises où la certification est en action.
Mais aussi, pour continuer ce catalogue à la Prévert, cette formation devrait permettre d’engager une réflexion commune sur la logique de la preuve et non de l’épreuve, sur cette posture évaluative renversée déjà évoquée ainsi que sur l’évaluation en VAE qui ne consiste plus à juger exclusivement des acquis du candidat au regard de son expérience mais aussi, et peut-être surtout, de son potentiel à devenir le porteur de la certification recherchée et exercer avec compétence l’emploi visé. Donc, il ne s’agit pas de juger termes à termes en enfermant le candidat dans un référentiel plus ou moins exhaustif et à jour mais plutôt d’estimer des compétences et non des savoirs (induits par hypothèse) avec en arrière fond cette question : qu’est-ce le candidat fait ou à fait et non qu’est-ce qu’il sait.
Enfin et de manière plus pragmatique, cette formation devrait « entraîner » les membres des jurys à la lecture et l’appréciation des dossiers de VAE à partir de critères et d’indicateurs partagés et à la recherche et à la formulation de prescriptions en cas de validation partielle, non nécessairement pensées comme un retour à l’université. De plus, elle pourrait porter sur les modes de questionnement lors de l’entretien (obligatoire dans le supérieur) qui n’est ni une soutenance ni une épreuve mais un temps de valorisation (mesure de la valeur) du candidat, un espace d’examen complémentaire (ou de vérification) de la preuve ainsi qu’un temps de confirmation de la décision (formulée hypothétiquement par chaque juge avant le jury).
On le constate, la fonction de juge universitaire en VAE, exige une forme de professionnalisation des acteurs de l’évaluation. D’autant qu’il conviendrait de la compléter par une connaissance du dispositif juridique de la formation continue, seule moyen d’adapter des prescriptions aux possibilités de formation ou non du candidat. A cela, on pourrait ajouter des techniques de veille sur les métiers et sur les compétences attendues pour faire évoluer les diplômes (évolution et obsolescence) et développer des compétences pour tisser et entretenir des liens avec des partenaires professionnels. Et pourquoi pas, des techniques nécessaires à l’accompagnement et au tutorat (suivi des prescriptions).
Autant reconnaître qu’en l’état, une telle formation et une telle mobilisation des acteurs relèvent de l’utopie éducationniste. Reste que c’est sans doute dans ce sens qu’il faut agir.
3.3 Indicateurs d’évaluation
On ne saurait clore cette communication portant sur « VAE, compétences et Jury Universitaire » sans essayer de proposer quelques critères et quelques indicateurs d’évaluation. Je considère que ceux-ci pourraient être construits et articulés à partir de la typologie proposée par Agnès Veilhan de Paris-3-Sorbonne Nouvelle, les 3P : Parcours, Projet(s), Potentiel[8] mais à définir en toute autonomie par chacune des universités en gardant à l’esprit toutefois la nécessaire égalité de traitement, seule garante de la valeur des certifications universitaires délivrées par la VAE ou pas. Cette batterie d’outils d’évaluation doit permettre d’analyser le parcours du candidat, de déterminer ses éléments significatifs (activités, durée, responsabilité, savoirs et méthodologie mobilisés…) et l’aire de compétences de ce dernier. Elle doit aussi faciliter la compréhension du/des projet(s) : projet de certification et projet(s) d’usage ultérieur et permettre corréler parcours et projet(s) en termes de compatibilité et de logique. Enfin, ces outils de mesure doivent « autoriser » à cerner le potentiel du candidat au travers de son parcours (évolution) en lien avec le projet : faisabilité et légitimité de l’octroi de la certification attendue ou de faire des prescriptions en lien avec des perspectives réalistes de réussite dans le temps et l’espace. Il s’agit d’adopter une démarche et une méthodologie « compréhensive » au sens où on l’utilise en sociologie.
Au demeurant, l’évaluation universitaire des acquis ne peut pas faire l’impasse sur l’acquisition des compétences clés au cœur des formations universitaires à savoir l’esprit critique et de la distanciation ainsi que, selon le niveau de la certification, sur la méthodologie et les capacités de recherche et d’élaboration de savoir sans production « systématique » d’un mémoire de type universitaire. Ceci implique d’identifier des situations sociales et professionnelles et/ou les expériences pouvant produire ces compétences attendues. Reste que l’évaluation raisonnée et outillée n’est pas et ne sera jamais une science exacte et qu’il ne convient pas d’être plus exigeant avec les candidats issus de la VAE qu’avec ceux « produits » en formation initiale ou continue.
Conclusion
La question de la VAE et de l’évaluation des acquis de l’expérience implique ou a impliqué une évolution profonde de l’Université et d’une partie de ses valeurs. Elle induit des postures et des pratiques nouvelles pour les équipes enseignantes et les membres du jury qui doivent se doter de nouvelles compétences en matière d’évaluation et se centrer d’avantage sur l’évaluation des parcours et des potentiels plutôt que des seules performances. Elle incite à conduire une réflexion de fond afin d’aboutir à une conception « rénovée » des certifications et à construire une relation nouvelle et égalitaire avec le monde professionnel. Il s’agit bien d’enjeux forts pour l’université afin qu’elle puisse garder son rang et son prestige, sans se renier dans le monde contemporain, avec pour objectif affiché de produire des savoirs de haute valeur et de hautes capacités à agir pour les étudiants et les stagiaires. Voilà le défi et la VAE peut nous y aider. Constat que je partage avec Isabelle Cherqui-Houot qui affirme que les universitaires « estiment majoritairement que les activités qu’ils ont menées dans le cadre des dispositifs de VAE, d’accompagnement comme de jury, sont de nature à féconder leurs pratiques pédagogiques traditionnelles en direction des étudiants »[9].
Hugues Lenoir
Université Paris X-Nanterre
Bibliographie indicative
Auras E. (2007), L’invention d’une norme sociale : les acteurs de la VAE dans une université in Neyrat F. (dir.), La validation des acquis de l’expérience, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, pp. 399-418.
Cherqui-Houot I., Actes de validation à l’université : un modèle entre le savoir, la personne et le collectif in Bélisle Rachel., Boutinet J.-P. (2009), dir., Demandes de reconnaissance et validation d’acquis de l’expérience, Québec, Presse universitaire Laval, pp. 71-102.
Bacquet C. (2009), La VAE… vous avez dit « complexe » ? Actualité de la formation permanente, n° 217, pp. 84-89.
Lenoir H., (2002), La VAE : une nouvelle donne pour l’Université, Connexions n° 78, pp 91-108.
Lenoir H. (2004), Pour une approche éthique de l’évaluation, Education permanente n° 158, pp. 51-72.
Lenoir H. (2008), Des effets sur les organisations in Ben Moussi (coord.), Validation des acquis de l’expérience, retour d’expérience à l’Université, Paris, L’Harmattan, pp.157-173.
Pons-Desouttier M. (2008), RNCP et VAE à l’Université, un couple indissociable ? in Ben Moussi (coord.), Validation des acquis de l’expérience, retour d’expérience à l’Université, Paris, L’Harmattan, pp. 175-186.
Veilhan A. (2004), L’éthique de l’accompagnement en validation des acquis de l’expérience : de l’individuel au collectif, Education permanente n° 159, pp. 107-116.
[1] Medef (1998), Journées internationales de la formation, Deauville, octobre.
[2] Lichtenberger Y. (1999), revue Travail et changement, n° 245, ANACT. Le contenu de la parenthèse est de moi.
[3] Montmollin (de) Y. (1984), L’intelligence de la tâche, Eléments d’ergonomie cognitive, Berne, Peter Lang.
[4] Marzouki M., 2009, entretien avec Geisser V., Dictateurs en sursis, Paris, Editions de l’Atelier.
[5] Bélisle R., Boutinet J.-P. (2009), dir., Demandes de reconnaissance et validation d’acquis de l’expérience, Québec, Presse universitaire Laval, p. 2
[6] J’use ici de « in » privatif à dessein, il s’agit en effet de questions ressenties comme non-posées, des in-posées et implicitement imposées.
[7] J’abuse ici du verbe « devoir » et mon texte devient dès lors très « prescriptif » mais pouvait-il en être autrement ?
[8] Voir l’article de A. Veilhan en bibliographie.
[9] Cherqui-Houot I., Actes de validation à l’université : un modèle entre le savoir, la personne et le collectif in Bélisle Rachel., Boutinet J.-P. (2009), dir., Demandes de reconnaissance et validation d’acquis de l’expérience, Québec, Presse universitaire Laval, p. 87.