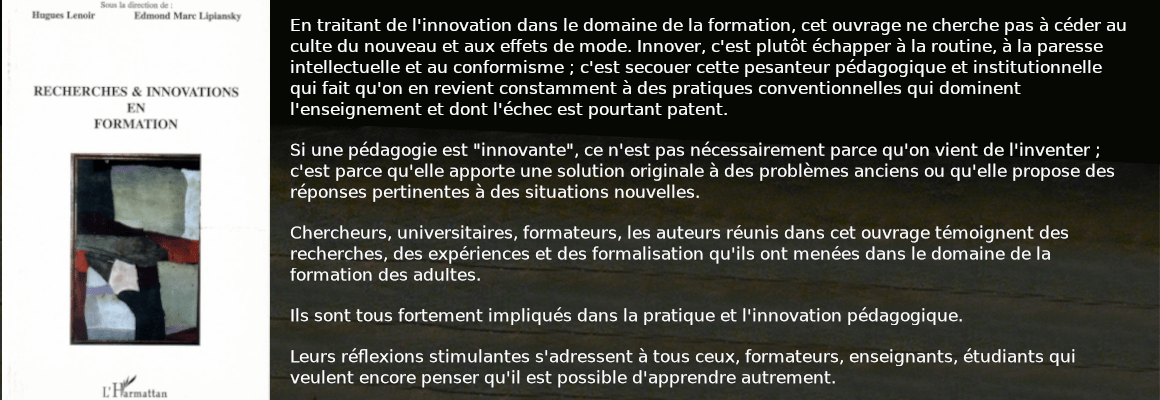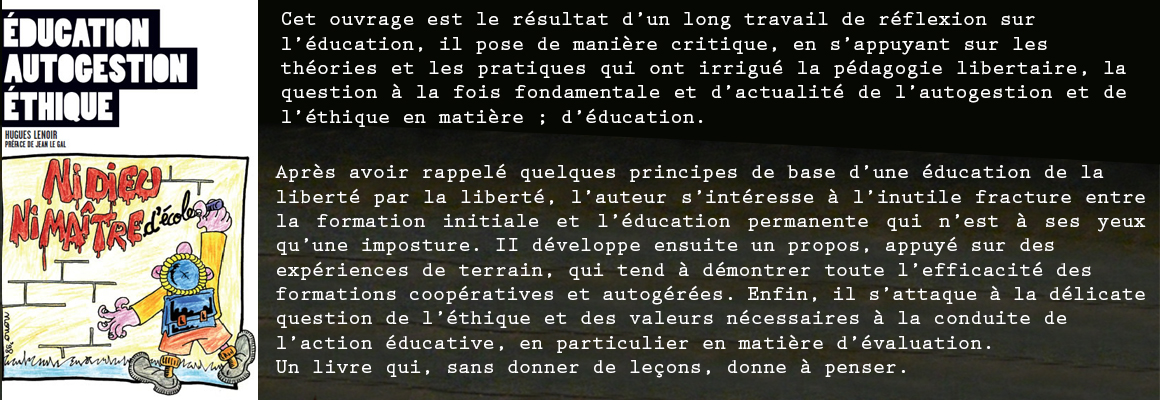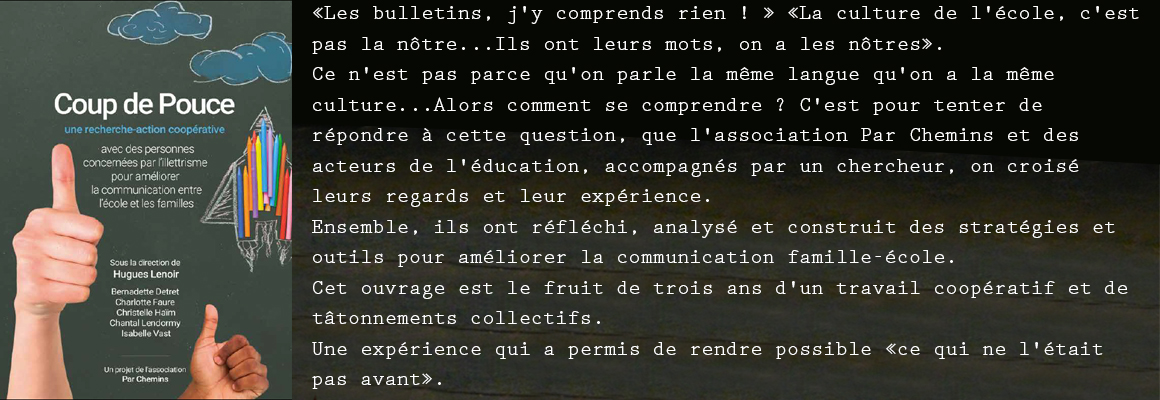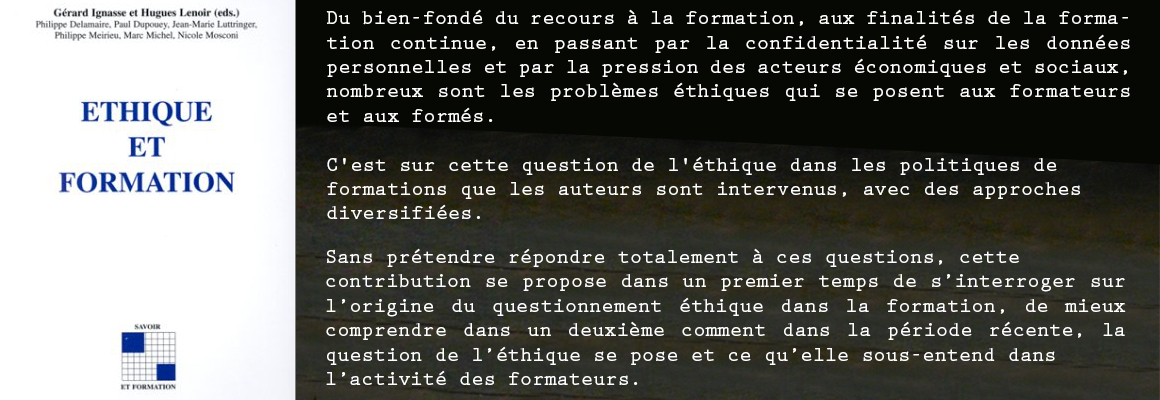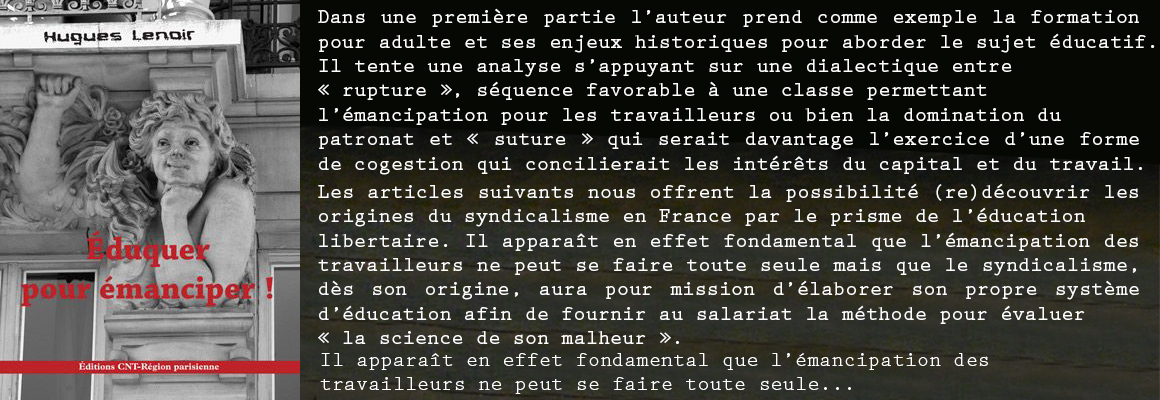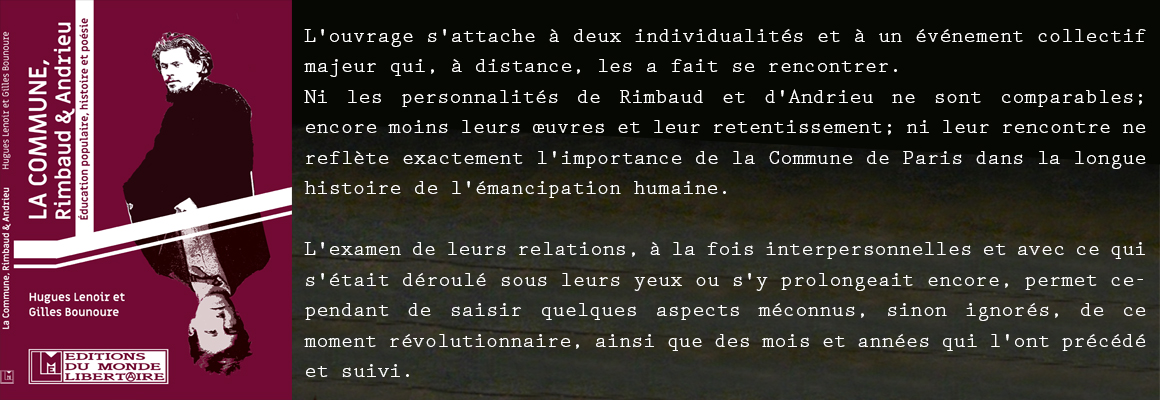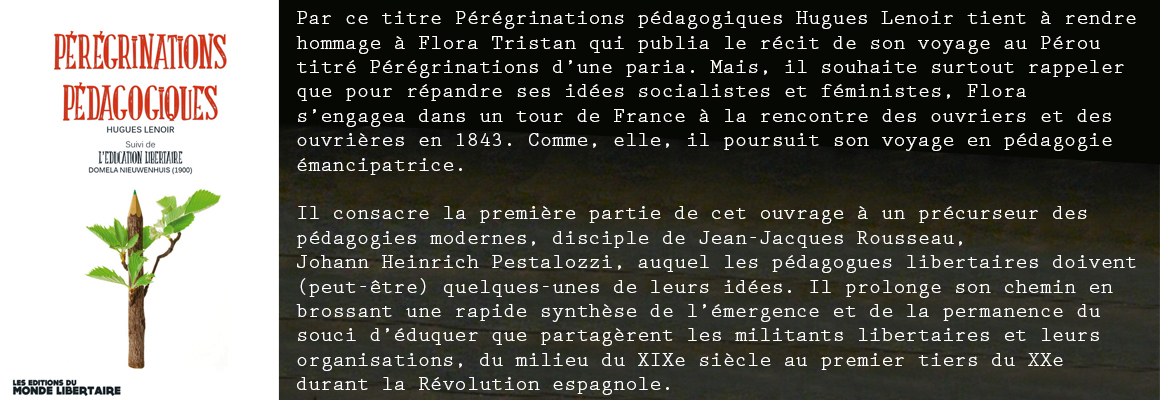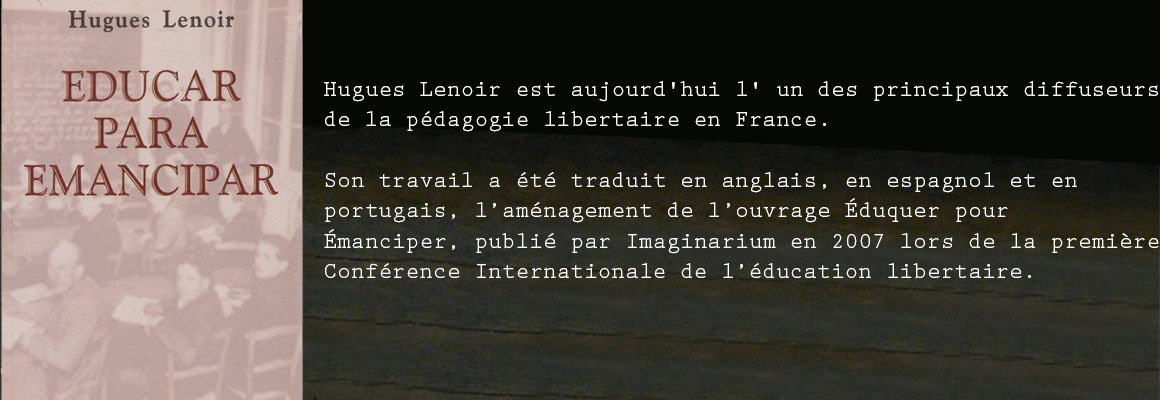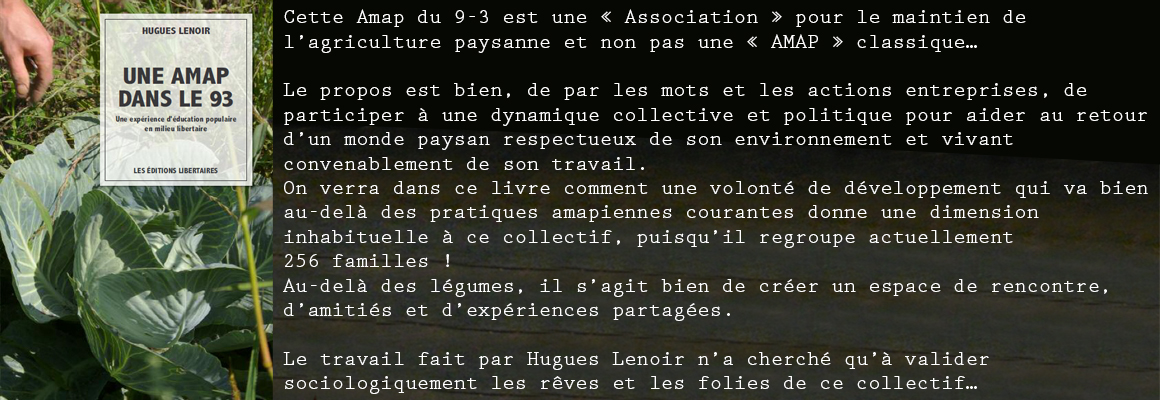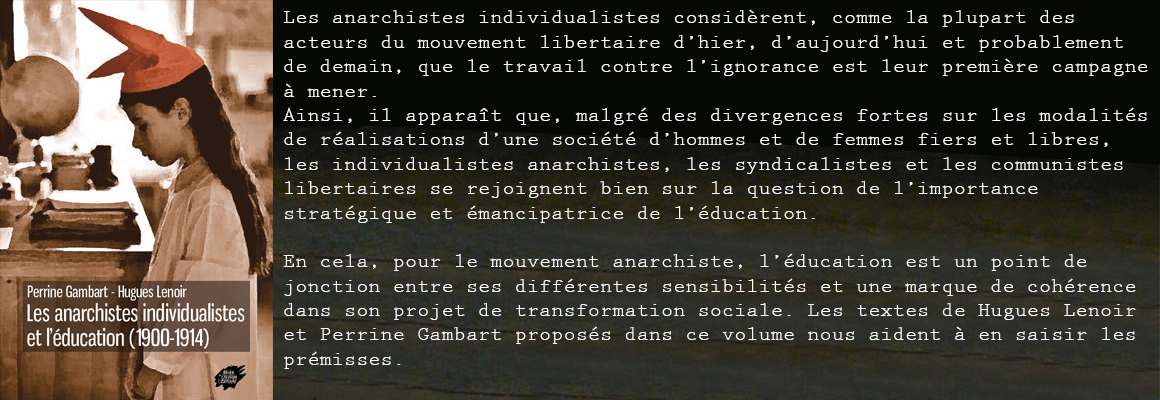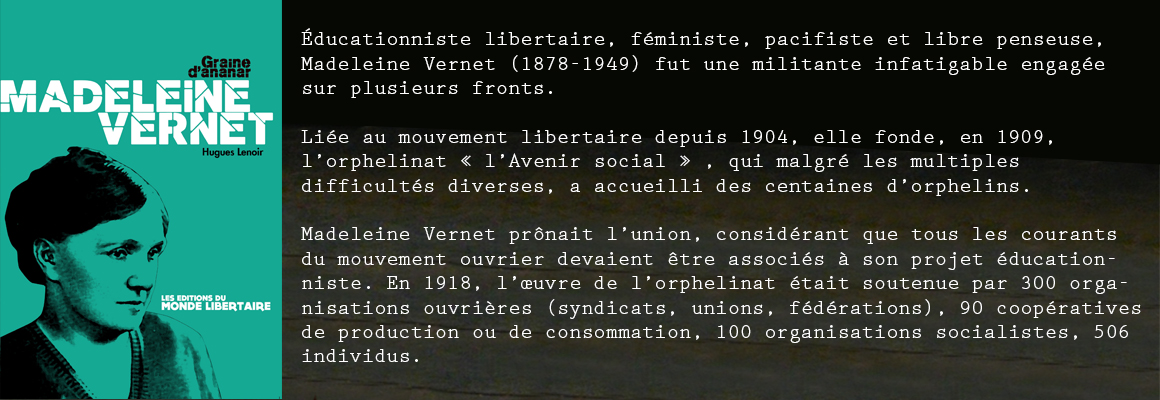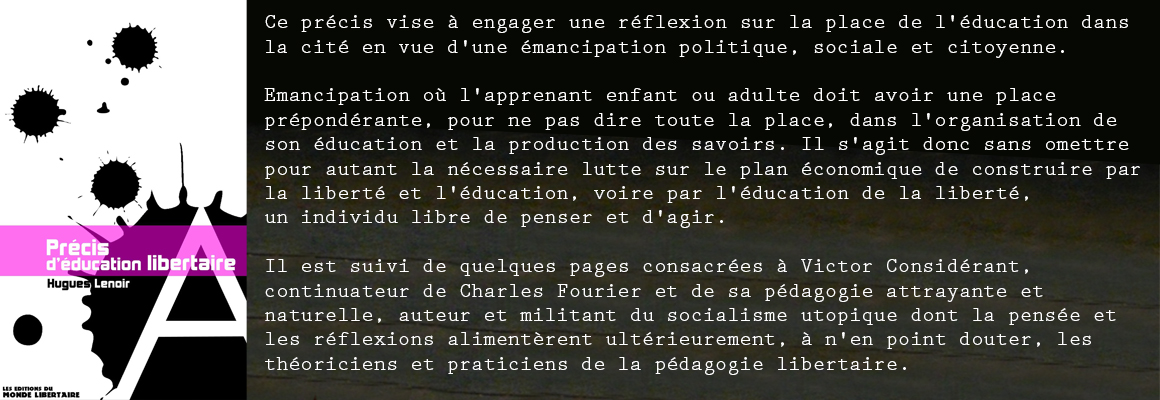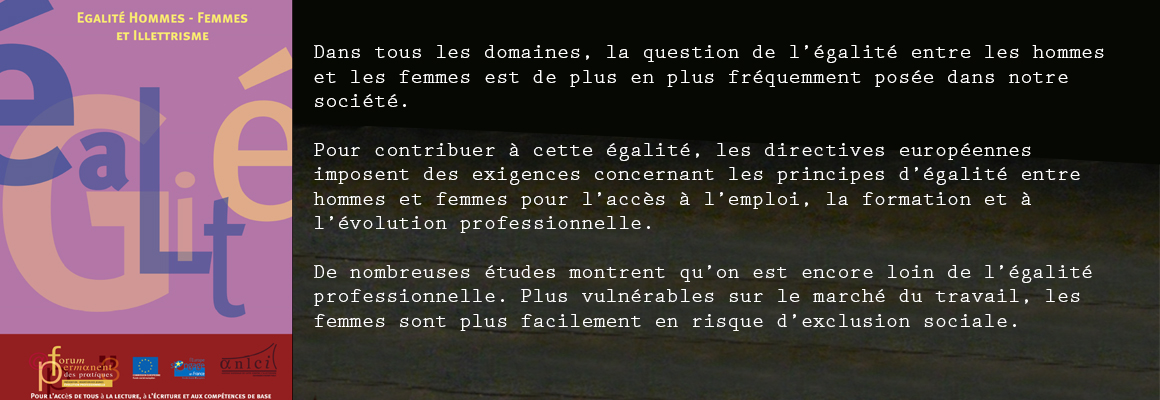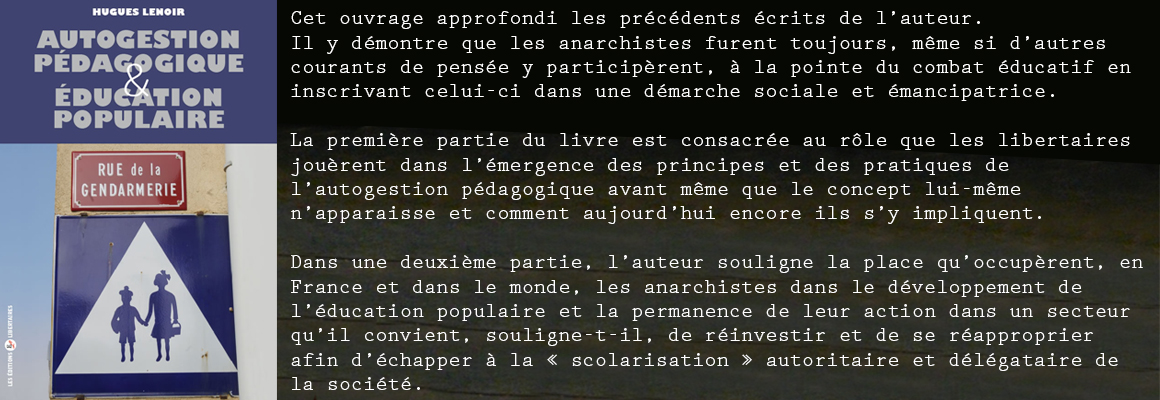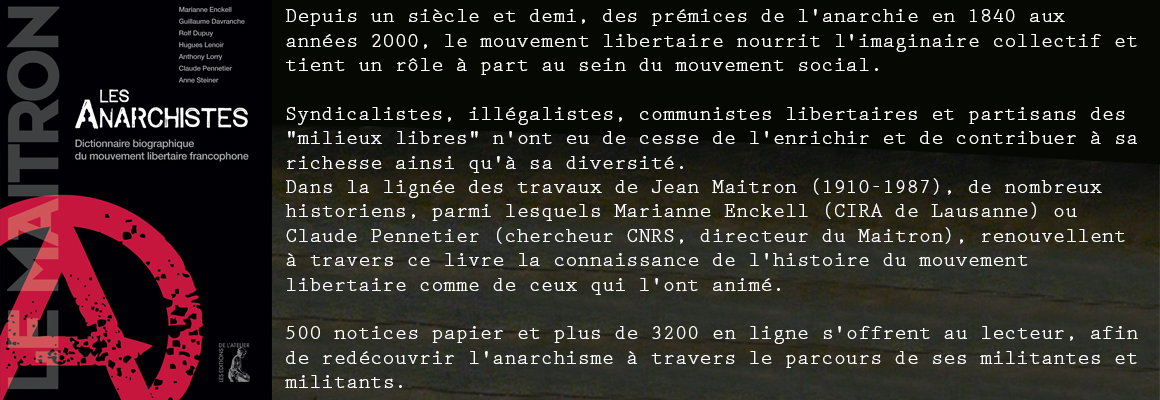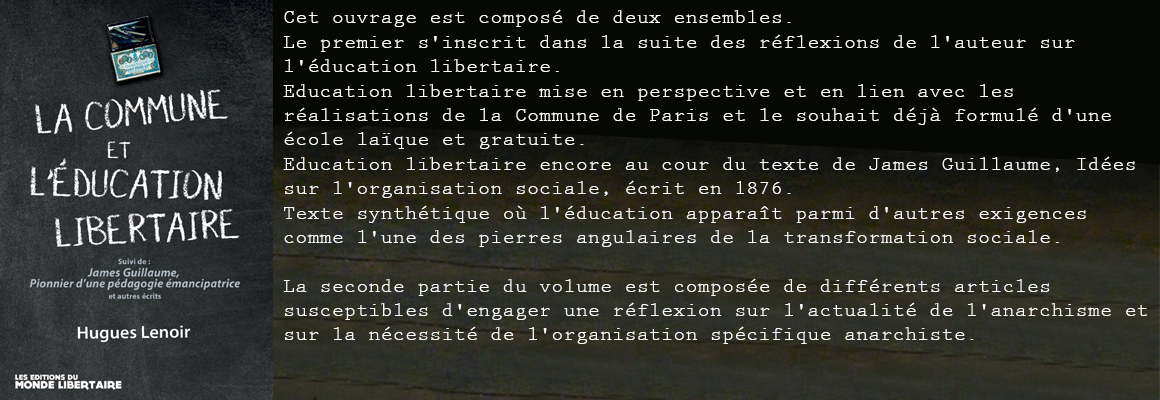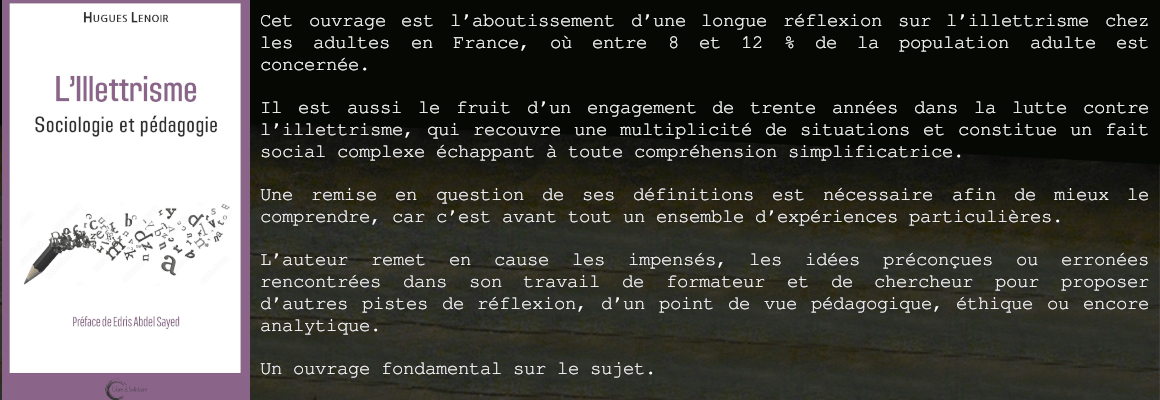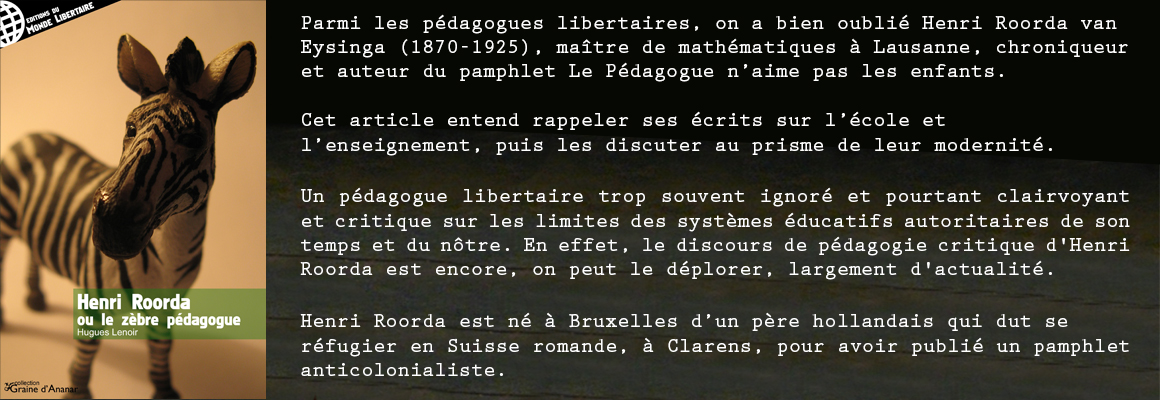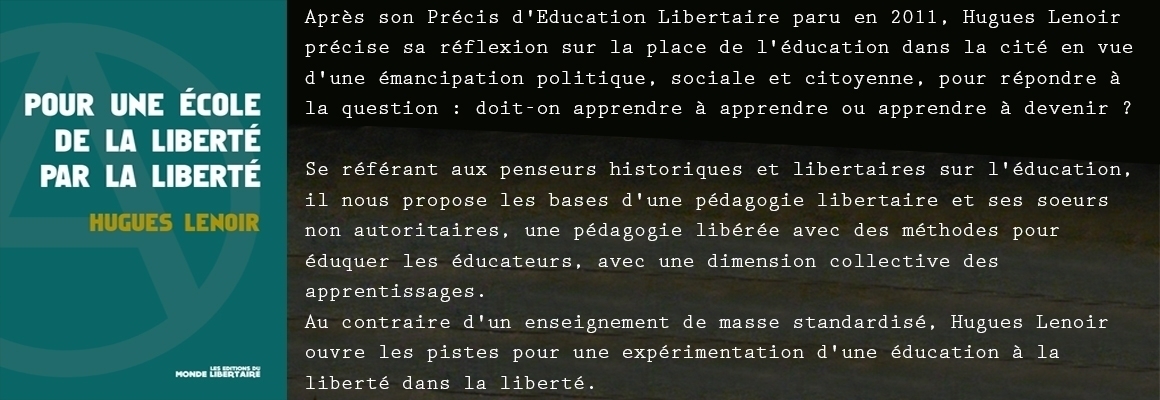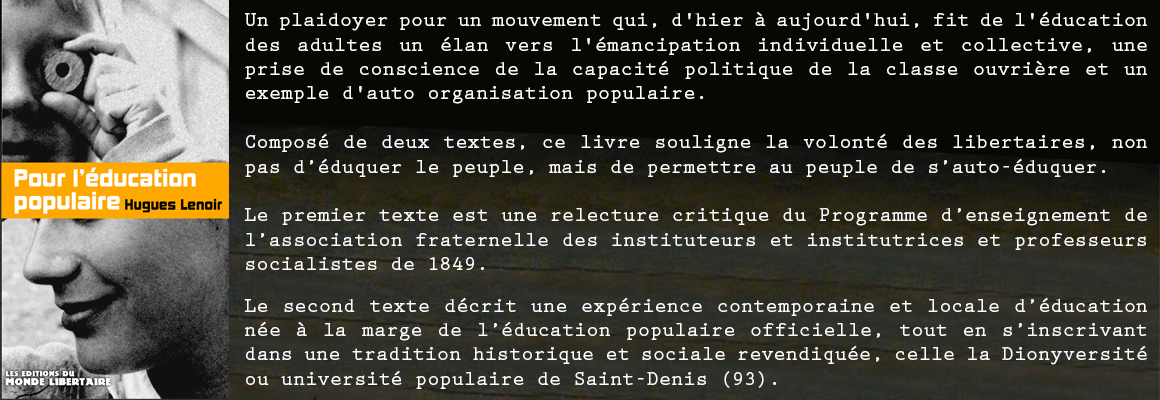Formation initiale et formation continue :
L’imposture de la dichotomie.
à Louise Michel
(Institutrice)
Des dichotomies inopportunes
Je crois qu’il serait bon et surtout productif d’en finir avec la rupture artificielle et entretenue entre formation initiale et formation continue. Pas seulement pour s’inscrire béatement dans la tradition encyclopédiste et dix-huitiémiste de Condorcet qui redonna pour un temps une dignité au travail avant que la division et la parcellisation fordiste ne la nie à nouveau.
Pas non plus, pour s’inscrire sans regard critique dans l’esprit de ce marquis progressiste (celui-ci n’était pas divin) qui considérait que l’Éducation ne devait pas s’arrêter au sortir de l’école mais durer tout au long de la vie à la fois pour développer et entretenir ses connaissances que pour éduquer sa qualité citoyenne, c’est-à-dire sa capacité à participer à la gestion des affaires sociétaires.
Encore moins pour légitimer le Livre blanc (1995) d’Édith Cresson, alors Commissaire européenne, et sa proposition de “société cognitive” et d’une nécessaire et indispensable long life learning entièrement conçue, malgré un habillage humaniste de bon ton, au service du libéralisme et de la dérégulation internationale du travail. Long life learning qui pense l’éducation initiale et continue dans le cadre d’un continuum et non plus comme deux temps distincts d’éducation, l’éducation initiale d’avant le travail et la formation continue de pendant le travail. Continuum éducatif souhaité aujourd’hui par quelques-uns et qui s’organiserait autour de la flexibilité du travail, de la précarité et de l’exigence toujours plus forte pour le “producteur” d’auto-entretenir et de plus en plus souvent à ses frais (notion perverse de co-investissement) sa force de travail dans le nouvel habit de la compétence qui exige moins aujourd’hui d’entretenir une force physique que les neurones exigibles dans le cadre des nouveaux procès requis dans cette “société cognitive” annoncée.
Formation professionnelle continue, troisième temps d’une valse, composée par les puissants où il conviendra, surtout de ne pas chanter l’Internationale, mais de danser et éventuellement d’apprendre entre des périodes travaillées mais pour une part sur le temps libéré (?) et des périodes chômées, voire aujourd’hui lors des moments de forte précarité et de temps très partiels où il s’agira de “s’entretenir la compétence” afin d’éviter l’obsolescence de sa qualification vite synonyme pour les moins qualifiés d’exclusion sociale, la relégation à Cayenne ou en Nouvelle Calédonie n’étant plus d’actualité.
Une construction sociale bien utile
Cette dichotomie formation initiale et continue est construite historiquement sur une logique de séparation de la sphère du savoir de la sphère du faire, au moins pour ce qui relève de l’enseignement général. Dichotomie à mon sens inopportune pour bien des raisons, parce qu’elle contribue à faire accepter l’idée de deux mondes antagoniques (l’école et l’atelier) d’abord, ensuite parce qu’elle dissocie l’activité (le travail) de l’apprentissage et que par conséquent cette dichotomie participe de l’idée (heureusement battue en brèche par la validation des acquis de l’expérience) que seule l’école et l’éducation formelle permettent d’apprendre et que le travail – même s’il faut convenir qu’il est trop souvent aliénant et déqualifiant – n’est pas un lieu de production de savoirs : les savoirs de l’expérience.
Face à cette rupture artificielle et illégitime, le continuum est donc bien nécessaire entre l’activité (travail) et l’apprentissage, non pas seulement pour faire plaisir à l’OCDE (Organisation de Coopération et de développement Economique) et à l’Union Européenne mais pour relancer la dynamique entre les lieux, entre l’école et “l’atelier”, pour redonner du sens au savoir. Savoir comme moyen non seulement de penser le réel mais aussi de pouvoir agir sur lui. Il ne s’agit pas à mon avis de penser une société sans école mais de réintégrer l’école dans la société et dans ce qui lui permet de vivre et de se développer, c’est-à-dire l’activité sociale et le travail[1]. En ce sens, le projet fouriériste mériterait d’être réinterroger. Il se proposait en effet d’associer passionnément : éducation et plaisir/pulsion, éducation et action, éducation et activités sociétales. Pédagogie associative, pédagogie papillonne et pédagogie de la découverte où l’apprenant au cœur de ses apprentissages pourrait, de choix en choix et d’expérience en expérience, œuvrer à la fois à sa construction identitaire et à la construction de la société.
Au-delà de ce refus de dichotomiser le réel social, il me semble qu’une continuité d’une autre sorte est à organiser, à revendiquer : celle de la pédagogie. Le combat pédagogique est au cœur de la question sociale. En effet, quels que soient les lieux, les temps des apprentissages et les publics (adultes ou non), il convient de s’interroger sur la finalité pédagogique, l’outillage et la méthode n’en sont que le moyen. Ainsi, il existe des pédagogies actives, participatives, coopératives… qui, lorsqu’elles sont reliées à des valeurs, et non pas construites à des fins utilitaristes et court-termistes de l’action pour l’action, participent d’un projet social émancipateur. D’autres, au contraire, plus expositives, plus magistrales en bref transmissives à orientation normative, comme l’écrivait Marcel Lesnes, qui visent à installer des sociétés autoritaires ou à reproduire le système de domination des élites sociales en place. Il conviendrait donc de penser ce continuum entre pédagogie et modes d’organisation sociale, de redonner de la cohérence et du sens aux pratiques pédagogiques. De plus en plus la formation des adultes, elle-même, longtemps irriguée par un projet de transformation et/ou de promotion sociale, de deuxième chance, innervée de pédagogie rogerienne se voit investie de plus en plus par des pratiques infantilisantes et pseudo-magistrales (règne du transparent et du vidéo projecteur) où la parole et l’action des apprenants sont soumises au discours “technologisé” et “autorisé” du formateur.
A qui sert la dichotomie ?
A qui sert cette séparation des pouvoirs, du pouvoir, en bref à qui profite le crime pédagogique tant du point de vue de la nuisible différentiation entre formation initiale et continue que de celui des pratiques éducatives. L’école a toujours été pensée en rupture : rupture de milieu (la famille), de lieux entre éducation et activité sociale (dont le travail), rupture de temps (rythme scolaire et année civile)… Cette logique de la rupture a plusieurs origines (je n’en évoquerai que deux) et a connu plusieurs époques.
Une première avait pour but de protéger dans l’esprit des “républicains” l’apprenant (surtout quand il est jeune donc fragile et conformable telle une pâte molle) non seulement, des néfastes influences familiales et des mauvais bergers cléricaux mais aussi (et surtout ?) des représentants les plus conscients de la classe dangereuse. D’où des écoles carcérales (la grille est une caractéristique pédagogique de l’architecture scolaire), coupées du monde et refermées sur elle-même, tel un cocon protecteur. Espace intérieur, physiquement conçu comme une succession de cellules (au sens propre et figuré) où le maître règne en despote pas toujours éclairé : la classe. Espace doté d’une extension sous haute surveillance, d’une aire de “jeux” à condition qu’ils soient autorisés. Espace clos, avec ses propres rythmes et ses propres rites (cloche, calendrier scolaire, horaires, distributions des récompenses et des châtiments) ses propres lois et ses propres tribunaux (règlement intérieur, conseil de discipline), son propre système de pouvoir (maître, directeur), ses modes de distinctions (classement, filières)… En bref, un monde à part où il s’agissait, en vase clos et surtout en principe, de construire des citoyens actifs mais pas trop, responsables mais délégataires, acteur de second rôle du devenir commun. En réalité, un espace de dressage social où les maîtres complices ou victimes devaient sans cesse avoir en têtes “quelles sont les idées, les sentiments qu’il faut imprimer à l’enfant pour le mettre en harmonie avec le milieu dans lequel il doit vivre”[2]. Il s’agissait dans cette optique, malheureusement toujours présente, davantage de conformer que de former ! Projet inacceptable aux yeux de certains, mêmes si ceux-là connaissaient et espéraient dans le pouvoir émancipateur du savoir[3].
Ainsi, Pierre Joseph Proudhon, conscient avant bien d’autres des enjeux de l’éducation, voyait déjà se profiler dans le projet éducatif des dominants, en recherche d’une main d’œuvre plus adaptée aux exigences du temps, une machine à produire des individus dressés “pour la servitude, au mieux des intérêts et de la sécurité des classes supérieures[4]“. Ce qui conduit Proudhon, après Charles Fourier d’ailleurs, à préconiser une éducation intégrale qui associe dialectiquement : développement de la main et de l’esprit dans le cadre d’un espace non strictement pédagogique, l’atelier pour l’un, le phalanstère pour l’autre. Education conçue en lien direct avec l’activité de travail et le développement de capacités réelles d’acteur social autonome. Le même souci animera plus tard les militants syndicalistes révolutionnaires des Bourses du Travail[5] qui tenteront sans relâche d’élever le niveau culturel du producteur, au sein des Bourses, dans la même recherche d’équilibre tout en soulignant le risque d’une école au service de l’industrie qui viserait “à faire de l’enfant un manœuvre, un accessoire de la machine, au lieu d’en faire un collaborateur intelligent“[6], un producteur auto-suffisant. Réflexion anticipatrice qui laisse à penser que l’éducation, comme le reste, ne se délègue pas et qu’une structure qui ne se propose que de conformer ne peut émanciper. Il s’agissait en fait pour la République[7], derrière le voile de la laïcité, d’isoler le futur citoyen à la fois de l’Eglise et du Travail, pour mieux le préparer à accepter cette République “une et indivisible” et à lui faire accepter sa fonction d’acteur docile, partageant les valeurs d’un système qu’il l’avait construit et qu’il servirait, si besoin jusqu’au sacrifice de sa vie comme la boucherie guerrière de 1914-1918 le démontra.
Une deuxième cause de rupture s’inscrit, elle, dans le cadre de l’affrontement du Capital et du Travail, mais relève d’une toute autre logique. L’école doit être close, séparée du monde réel, là encore pour protéger l’enfant des influences néfastes de l’industrie mais cette fois, la cause est acquise, l’école est républicaine et la Commune oubliée. Pour les autoritaires étatistes, elle participera à l’émancipation du travail mais dans un cadre strictement défini. Les hussards de la République ne sont-ils pas acquis depuis longtemps au progrès social ? Emancipation pensée centralement dans l’intérêt du prolétariat et mise en œuvre par une phalange disciplinée d’instituteurs. Autre manière de conformer, cette même cire molle en dépit de ses aspirations, mais cette fois au service d’un grand dessein social où l’individu doit se soumettre et disparaître face aux volontés collectives. Les déterminismes socio-économiques ne se discutent pas et le socialisme est une science !
C’est cette logique, d’après guerre (la seconde) qui préside encore à cet enfermement de l’école sur elle-même et à la légitimation par certains de cette fermeture aux influences extérieures et à la non-inscription de l’éducation dans la société. Protéger l’enfant de la seule logique productive, parfait, mais à condition d’échapper à la logique reproductive d’un système honni. Et ce ne fut pas toujours le cas, l’école et l’éducation participant largement au maintien du système ou pour le moins d’un système autoritaire. Il s’agissait de contrôler l’école pour donner une chance au prolétaire de devenir un maillon conscient de l’avenir et du rôle historique de sa classe mais toujours dans un esprit de surdétermination pour ne pas écrire de subordination. Esprit de subordination qui ne déplaît pas toujours aux puissants capables de délégués, car si le risque de former des “révolutionnaires” existe (politique des risques marginaux), cette école aux mains des “rouges” prépare fort bien au travail et à l’obéissance. Elle est l’outil parfait où le prolétaire de l’éducation participe (souvent inconsciemment et en toute bonne foi) à l’aliénation des futurs prolétaires de l’industrie. Que demande le patronat, sinon un outil efficace et protecteur de ses intérêts, que demander de plus qu’un outil contre productif en matière d’émancipation aux mains mêmes de ceux qui s’en réclament. L’école de la République est une machine de guerre contre le socialisme et la liberté, où les rôles et les clefs du pouvoir sont des mieux répartis dans le cadre d’un compromis historique qui ressemble, si ce n’est à une compromission, à un renoncement. Cette conception de l’éducation coupée du monde est une erreur historique, d’aucuns comptaient y préparer le prolétaire discipliné et progressiste, ils ne fabriquaient le plus souvent que des “accessoires de la machine”. Si le prêtre, l’armée et la famille sont des écoles de la soumission, l’Ecole – elle-même construite sur un savoir éclaté et disciplinaire – préparait (d’ailleurs à quoi prépare-t-elle aujourd’hui ?) au travail usinier et aux tâches parcellisées des administrations, rarement à l’émancipation de la Classe, car une structure organisée autour et sur la contrainte ne prépare qu’à accepter la contrainte. L’école, si on admet cette clé de lecture, – même si elle n’a pas que cette seule fonction – est un petit laboratoire de la soumission, comme l’usine ou le bureau, elle est un espace clôt (portail, grille) enserrer dans des temps et des rythmes spécifiques (cloche, sirène), soumis à un droit original (code du travail et règlement intérieur…), à un système de classement et de sanctions locales (récompenses, primes, discipline…), à des rites particuliers (distribution des prix, médailles du travail…), soumise à une hiérarchie forte – malgré l’illusion de la liberté dans la classe – (inspecteur, contremaître…), le tout préparant au respect des autorités légitimes (instituteur, père, adjudant, patron, mari…). En bref, un tout petit monde qui initie à la vraie vie, celle où l’inégalité et l’abus de pouvoir sont la règle. Espace social doublement contrôlé qui à mon sens explique le caractère définitivement marginal des “pédagogies nouvelles”.
Pour une nouvelle association de l’éducation et de l’activité
La séparation des espaces et des temps sert les tenants du pouvoir ou ses aspirants. On ne peut concevoir une société libre qui se construit dans un environnement contraignant et dont les fins sont contradictoires avec les finalités recherchées. A société et à entreprises auto-organisées, éducation et pédagogie autogestionnaires. Il s’agit donc pour que chacun, chacune, puissent prendre part aux décisions et à l’action que les structures éducatives les y préparent. Si on veut travailler autrement, il faut apprendre et penser autrement. En d’autres termes, pour autogérer demain les organisations de travail, il faut apprendre collectivement (apprenants, personnels éducatifs, parents) à autogérer les espaces d’éducation en les réengageant clairement dans une logique locale et interprofessionnelle. Il conviendrait de réinventer, en quelque sorte une forme nouvelle et adaptée à l’époque de Bourses du travail où l’école serait en débat.
Ici s’inscrivent les projets innovants dont on débat aujourd’hui, et ici s’inscrit aussi, sauf à conserver un caractère marginal-toléré, leurs échecs relatifs. Car s’ils sont des réussites ponctuelles et très localisées et pour des collectifs d’enfants très réduits, leurs capacités de transformations sociales, sont obérées par ceux-là mêmes qui les autorisent. La volonté de rapprocher “travail et éducation” se pense dans les mêmes limites et le même champ de contraintes mais il conviendrait néanmoins d’y œuvrer car en ré-associant, à l’occasion de ces innovations, les deux termes et les deux formes d’activité (apprentissage et action), non seulement, ces projets s’inscriraient dans l’esprit des “pédagogies nouvelles” mais ils participeraient d’une toute autre recomposition sociale que celle que le MEDEF insuffle et propose. Ils rapprocheraient les deux termes d’une pseudo contradiction entre éducation et production. Contrairement aux idées reçues, le travail peut nourrir l’apprentissage et la pensée et l’apprentissage peut permettre de mieux maîtriser l’action. La pédagogie en alternance, qui ne nuit en rien aux capacités d’abstraction et aux opérations hypothético-déductives, dans un espace et des dispositifs pédagogiques socialement et syndicalement contrôlés, en est une préfiguration intéressante. Une telle ambition ne peut s’appuyer que sur une pédagogie de rupture, autogestionnaire et anti-autoritaire. En ce sens comme l’écrivait, il y a déjà quelques temps déjà Jacques Ardoino, “il n’y a pas de pédagogie sans projet” ! Osons donc notre pédagogie, afin de réaffirmer et d’éclairer notre projet sociétal, celle d’une société sans Etat, celle de l’association du Travail et de l’Apprentissage.
En bref, si on veut se réapproprier le travail, il nous faut d’abord nous réapproprier l’Education et tenter l’association des deux termes, avec passion, à l’instar de Charles Fourier.
Hugues LENOIR
[1] Il ne s’agit pas pour moi de faire l’apologie du travail aliéné mais de le considérer comme une activité et un moment socialement utiles à la production des biens et des services nécessaires au bien-être individuel et collectif ce qui permettra, d’ailleurs, d’en réduire la durée et les nuisances.
[2] Durkheim E., in L’Éducation, sa nature, son rôle, Éducation et Sociologie, Paris, PUF, 1968, pp. 48-49.
[3] Sur cette question voir Hugues Lenoir, Contradictions sociales et formation, Actualité de la formation permanente, n° 199, mars-avril 1999.
[4] Proudhon P.-J., De la capacité politique des classes ouvrières, Paris, Les Editions du Monde libertaire, 1977, T. 2, p.237.
[5] Sur cette question voir Hugues Lenoir, A l’origine du syndicalisme : l’éducation ou éduquer pour émanciper in Syndicalisme et Formation, Paris, L’Harmattan, 1999.
[6] Pelloutier F., Histoire des Bourses du Travail, Paris, Gordon et Breach, 1971, p.190.
[7] Rappelons que l’égalité et la gratuité républicaine en matière d’éducation est une mystification. L’enseignement secondaire ne fut accessible (gratuit) aux classes populaires qu’à partir des années 1930. Quant à l’égalité de nombreux travaux de la sociologie de l’éducation l’ont depuis longtemps rangée au rayon des accessoires de propagande.