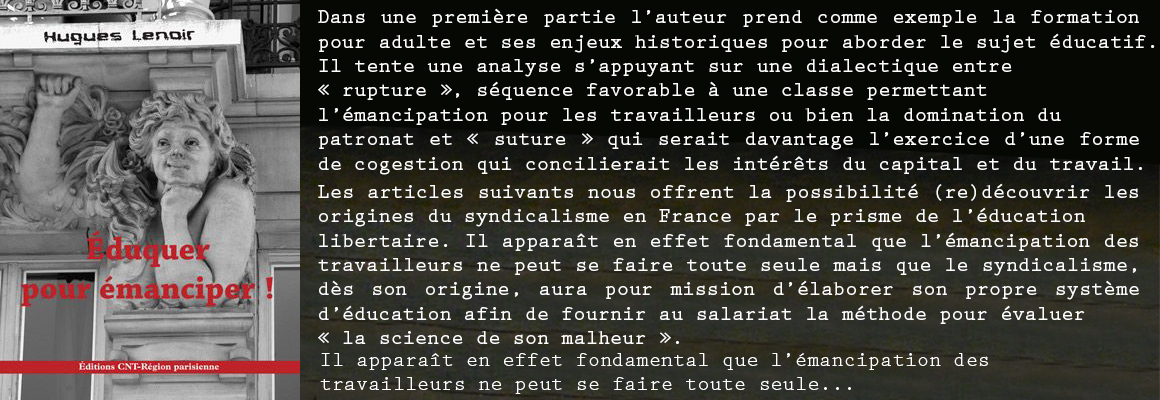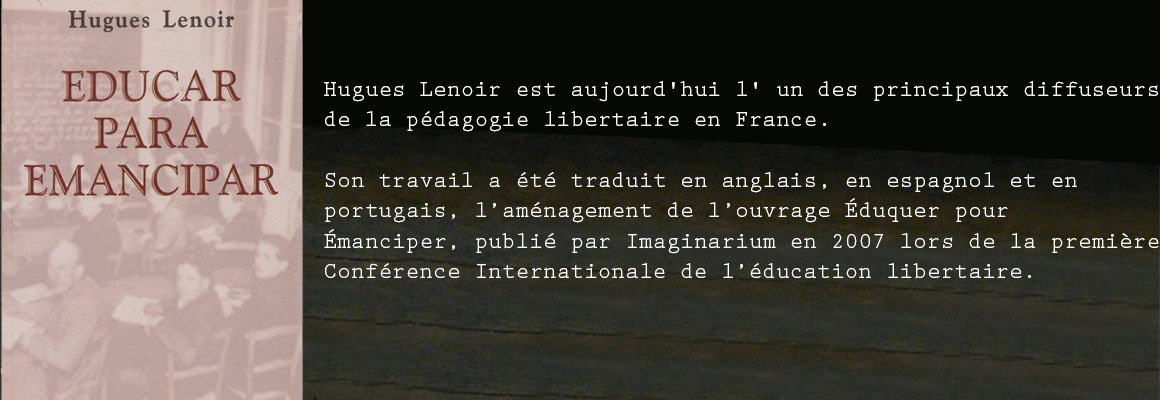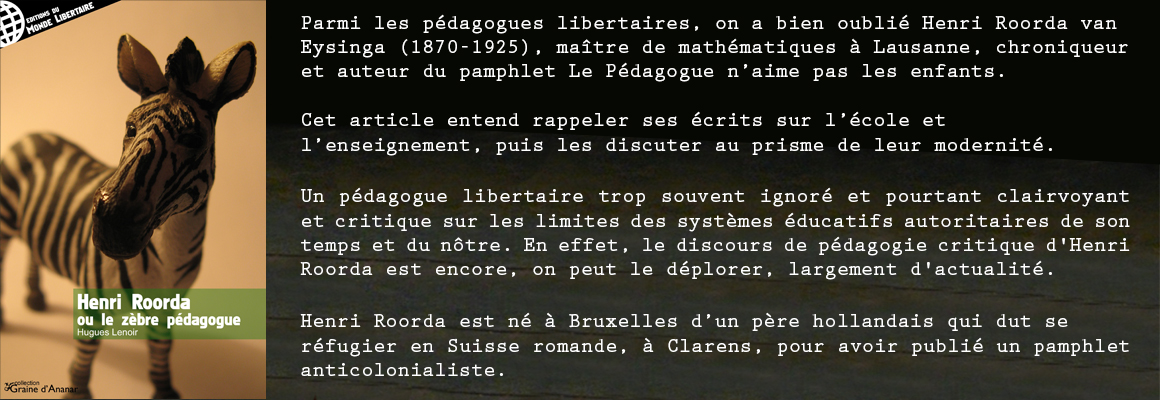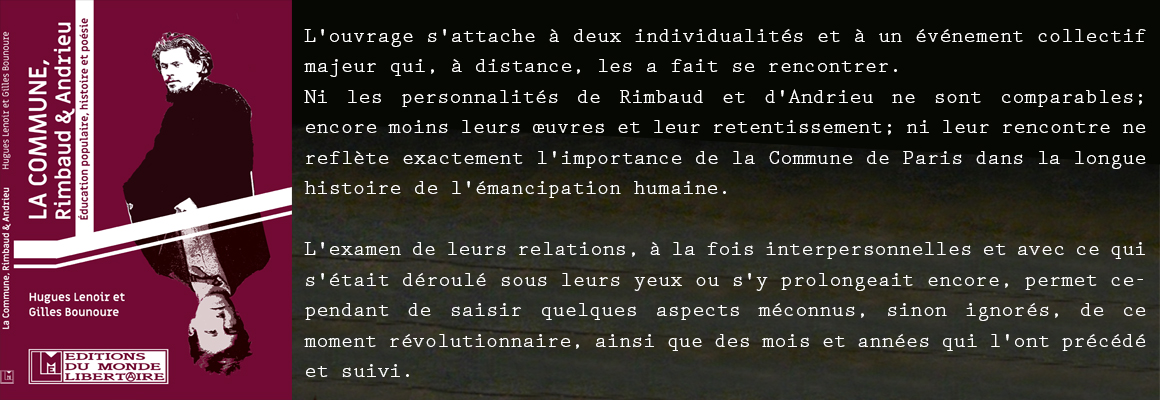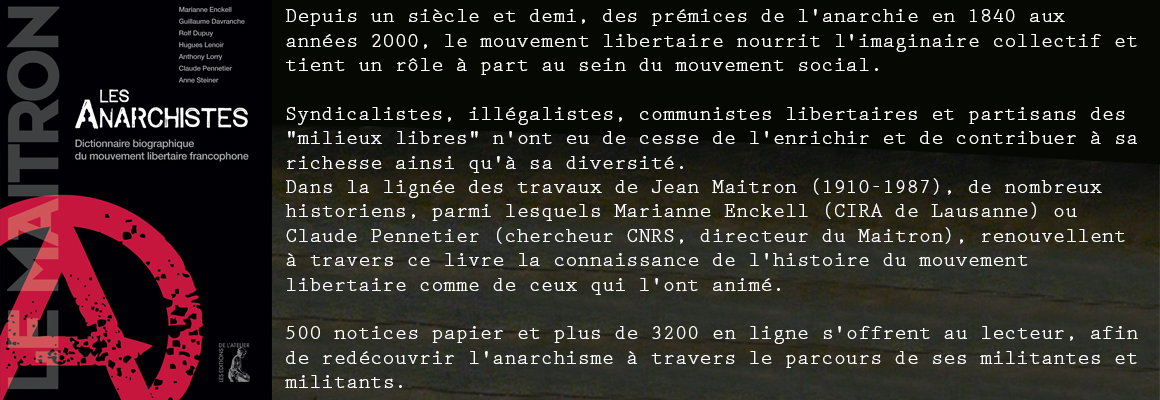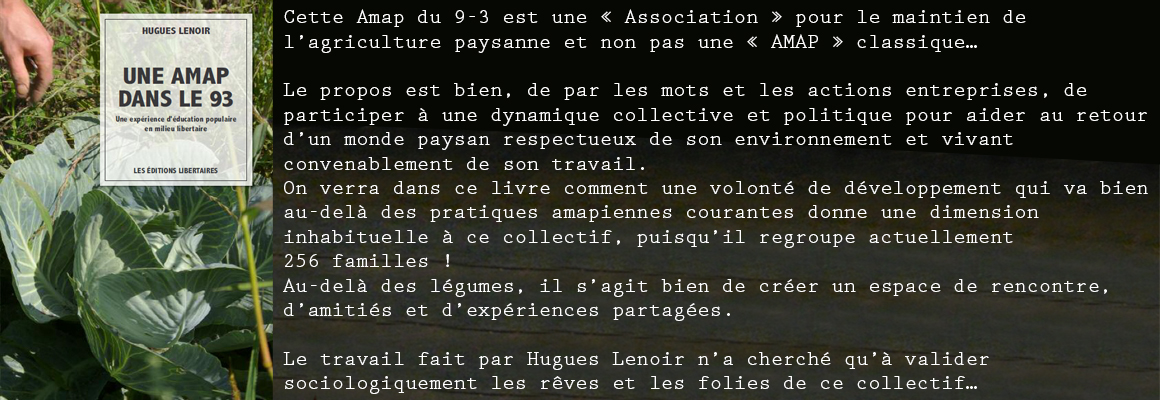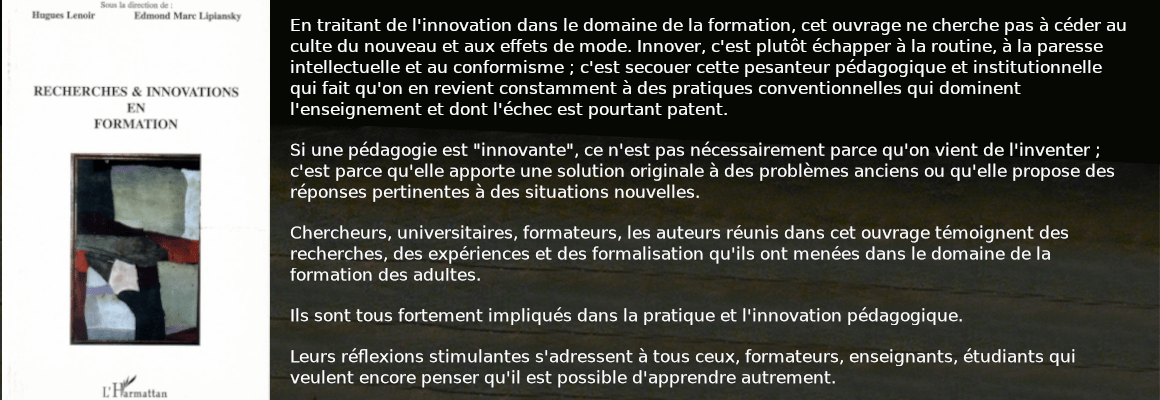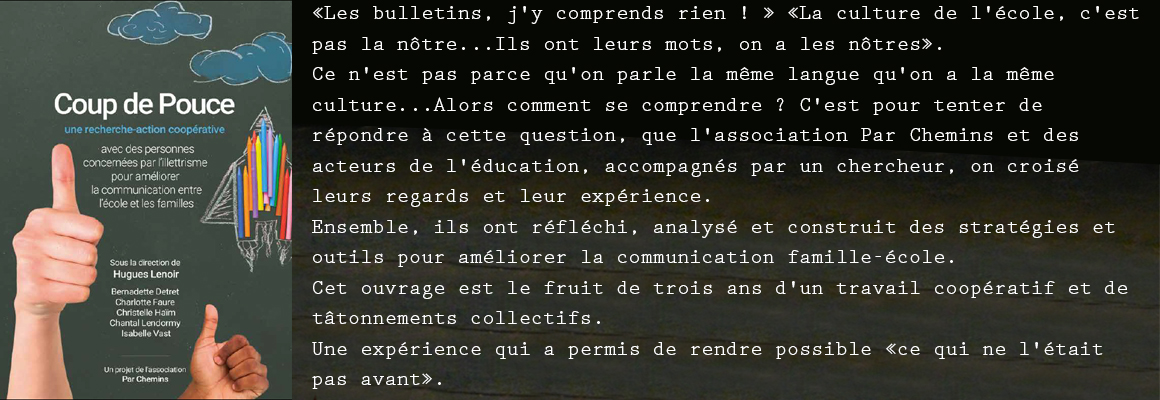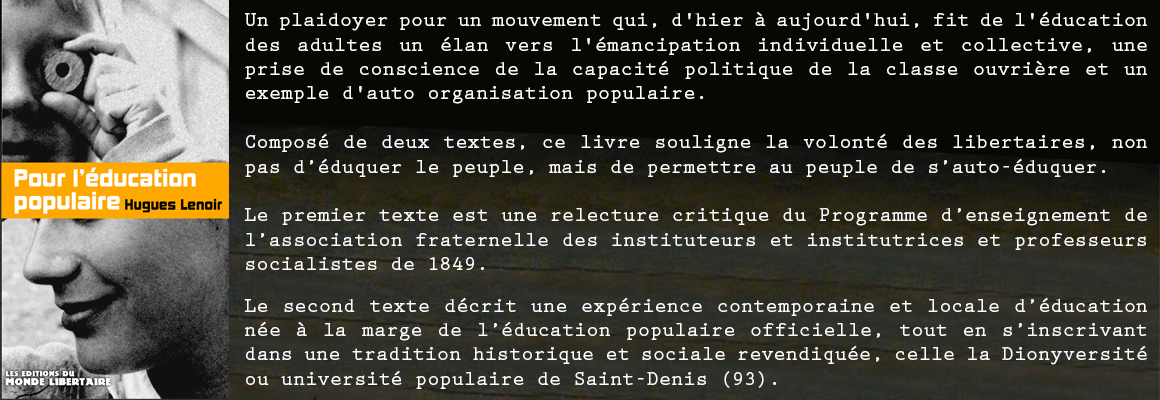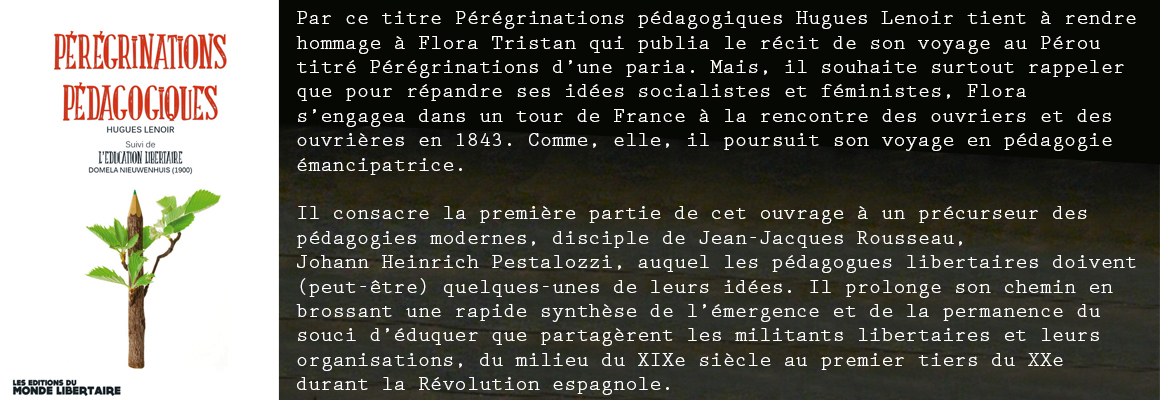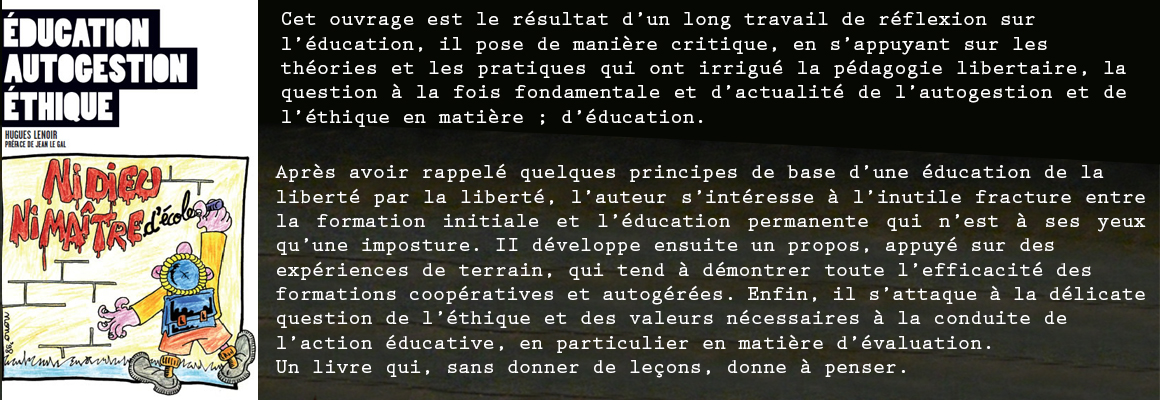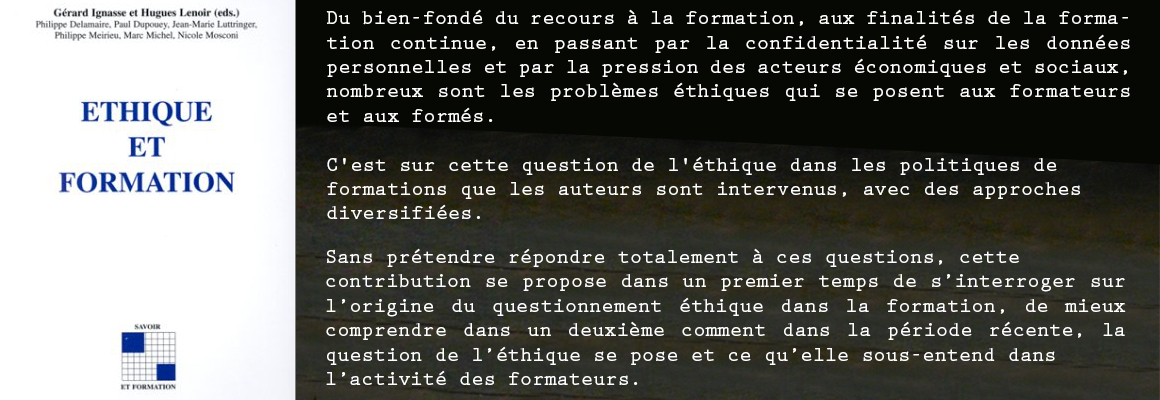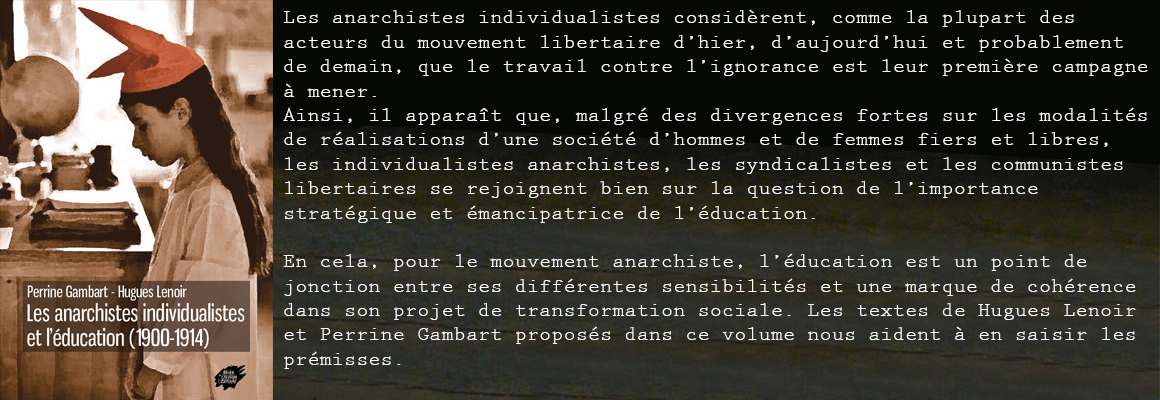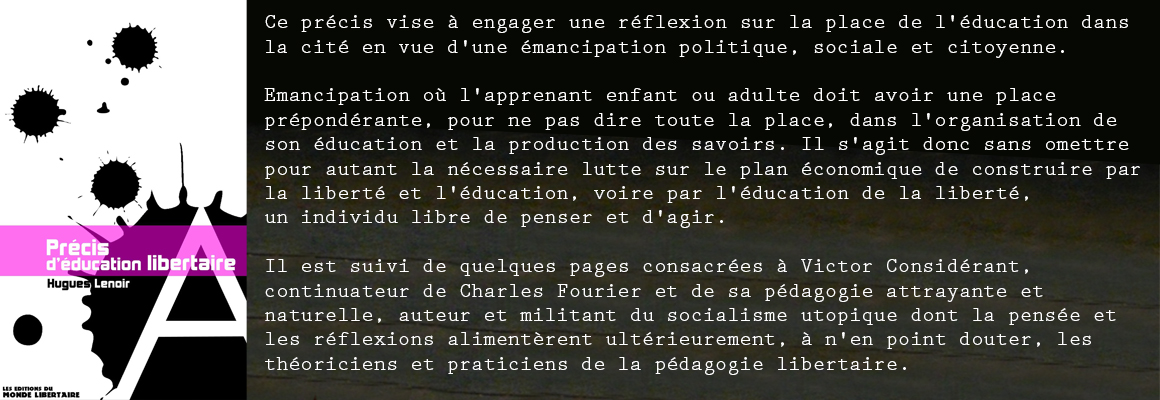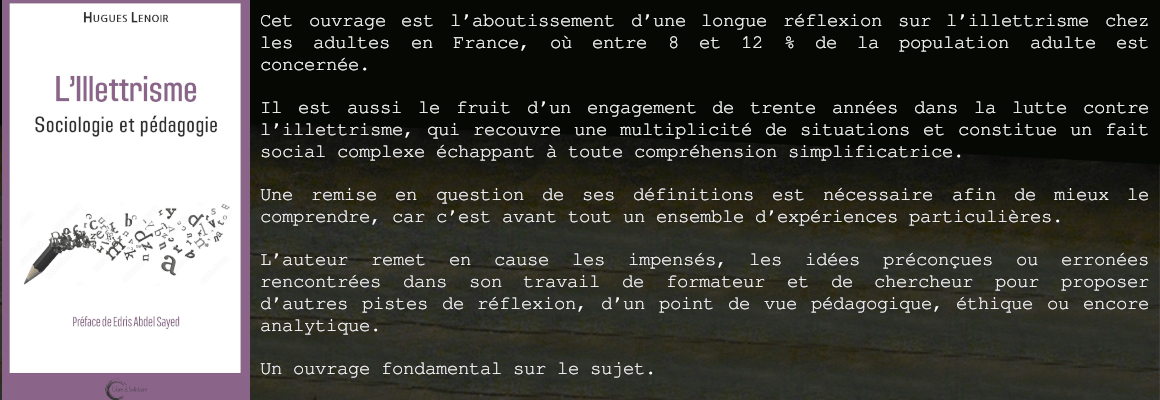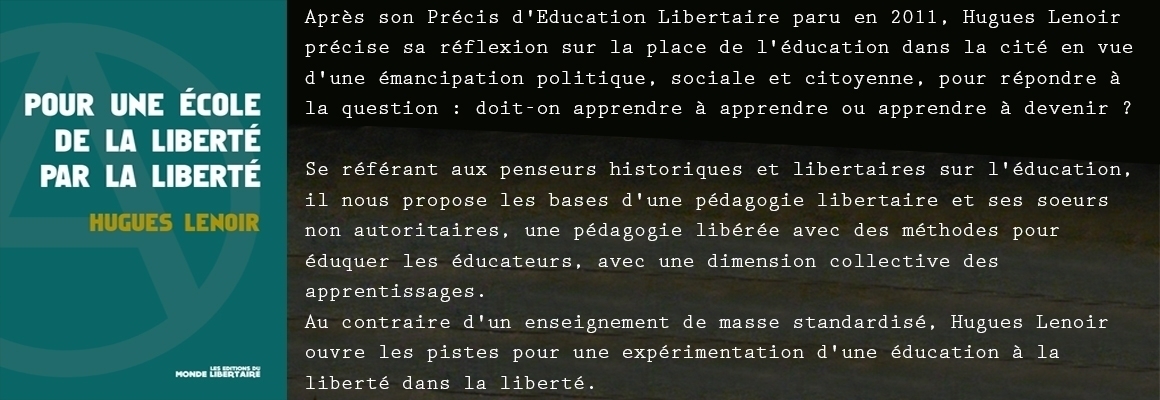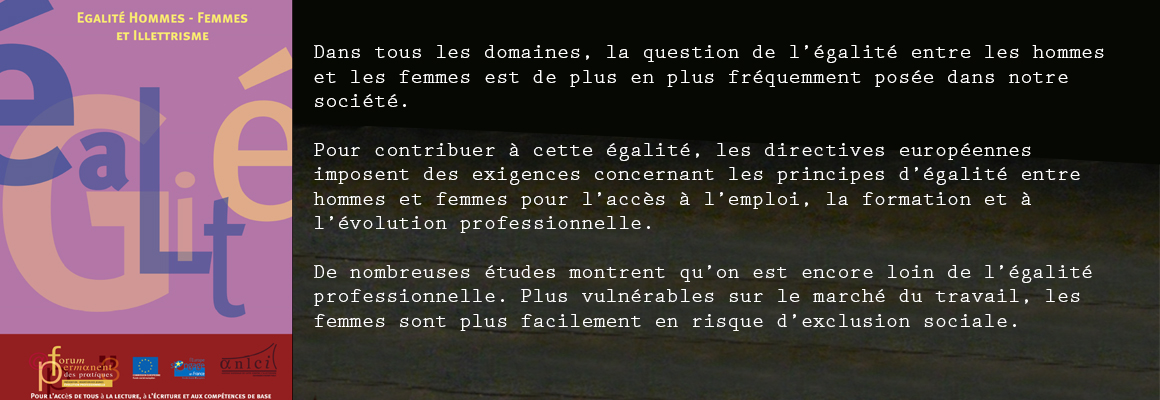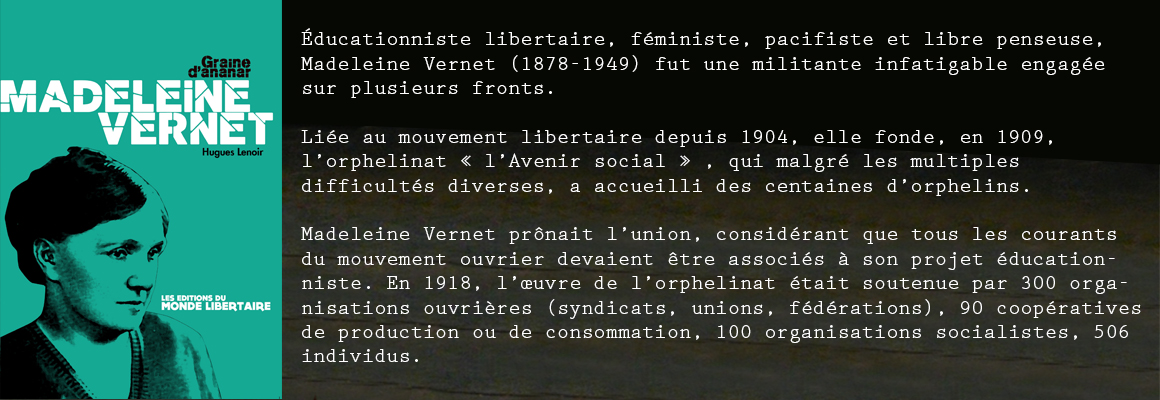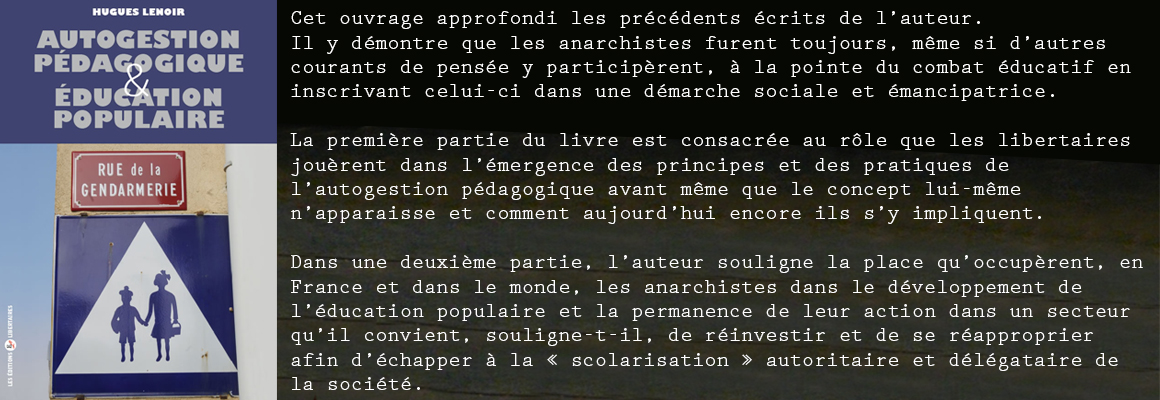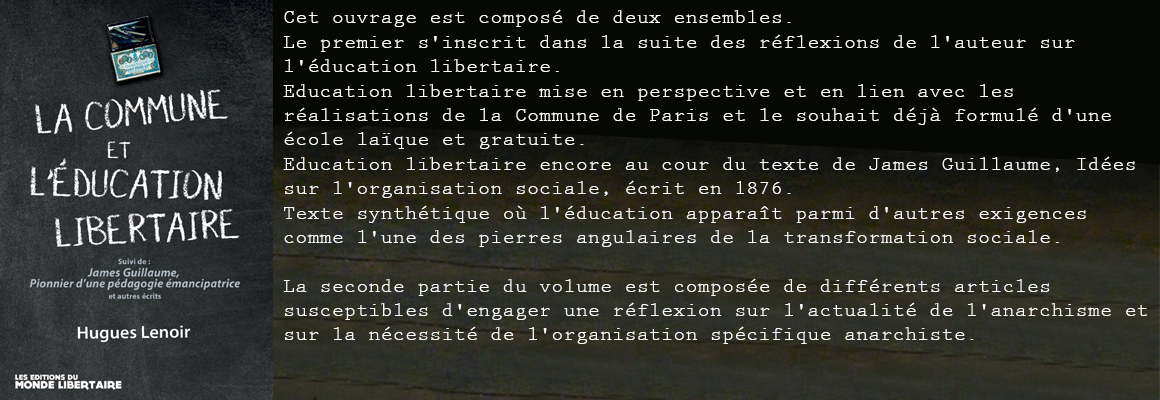VAP-ISERES-2
2001
Considérations sur l’expérience
et sa valeur sociale
“Sous-estimez le savoir de l’expérience est,
à la fois, une erreur scientifique et
l’expression d’une idéologie élitiste”.
Paolo Freire[1]
Réflexion sur l’expérience
La question de la place de l’apprentissage dans l’expérience, c’est-à-dire des savoirs construits dans et par l’action est fort ancienne et remonterait jusqu’au philosophe Leibniz qui considérait que les savoirs des professionnels seraient du même ordre de grandeur, voire supérieur, à celui contenu dans les livres (Prot B., 2000, p. 127). Dans la littérature pédagogique contemporaine, il convient aussi de signaler Le praticien réflexif dont le sous-titre A la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel (Schön D.A.,1983[2]-1994) renvoie clairement à la production de savoir en situation de travail tout comme le numéro de la revue Education permanente Apprendre par l’expérience (1989) et L’acte d’apprendre (Aumont B., Mesnier P.-M., 1992) qui démontraient l’importance et la place des apprentissages acquis dans et par l’expérience. Ainsi, les savoirs tacites (Schön, 1994, p. 18) ou savoirs de l’expérience (CUCES, 1996) sont depuis quelques années une problématique de recherche en sciences humaines largement soutenue et relancée par la nécessité de leur émergence, de leur formalisation auxquelles sont liées leur reconnaissance individuelle et collective et leur certification. Recherche en sciences humaines dont l’intérêt soudain et la convergence – que je ferai apparaître – posent question ? En effet, comment expliquer cet engouement pour des savoirs jusque-là ignorer ou que seul “le bon sens” collectif osait invoquer et reconnaître ? Pourquoi, avec l’aide des sciences humaines, légitimer et conférer à ces savoirs “bruts”[3] de nouvelles dimensions et une valeur sociale ? Quel humanisme et/ou quel système d’intérêts implicites éclairent cette mise en lumière des savoirs de l’expérience ? En d’autres termes, quelles fonctions idéologiques, les différents acteurs souhaitent-ils voir jouer à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) ?
La question de la validation de l’expérience et des savoirs acquis de l’activité, y compris l’activité syndicale, à laquelle je participe depuis quelques années, m’a permis d’engager une première réflexion sur la notion d’expérience et sur celle de sa valeur sociale. Ce sont aux résultats de cette recherche que sera consacrée cette contribution. J’exclurai néanmoins de mon propos, des savoirs de l’expérience ceux qui appartiennent en propre à l’individu et qui a priori ne relèvent pas de la reconnaissance. En d’autres termes, je n’aborderai pas les savoirs intimes, ceux de l’émotion, du ressenti… qui, certes, participent de la construction identitaire et de la richesse individuelle mais dont la valeur dépasse de loin la seule dimension sociale et la nature des savoirs qui s’y acquièrent la mise en équivalence. Ce serait les réduire à une dimension utilitariste qui ne leur convient pas, nous semble-t-il. Il convient donc, dès lors, de restreindre la validation de l’expérience à ses composantes objectivables – avec les difficultés les limites de l’exercice – et dans le même temps d’engager une réflexion éthique sur les implications individuelles et collectives d’une telle pratique. Ne pas s’interroger sur ce qui est “validable” et ce qui ne l’est pas, sur le comment, le pour quoi et le pour qui de cette validation pourrait in fine transformer une penser généreuse et peut-être libératrice – malgré ses limites et ses contradictions – en un outil totalitaire.
I Expérience et savoir
De l’expérience
Avant de définir l’expérience, rappelons qu’il ne s’agit plus pour nous comme le proposait John Dewey avec son Learning by doing ou Célestin Freinet dans le cadre du tâtonnement expérimental de faire acquérir des savoirs dans le cadre d’expériences ou de situations pédagogiquement organisées pour apprendre mais d’opérer un renversement dialectique – ou pour le moins d’une approche différente et complémentaire – où il n’est plus question d’utiliser l’expérience pour apprendre mais de dégager les savoirs issus d’expériences diffuses et multiples dont le but initial n’était pas l’apprentissage mais l’action. Au demeurant, les pratiques de Dewey et de Freinet reconnaissaient déjà à l’expérience et à l’agir des potentialités d’apprentissage préfigurant et validant certaines intuitions que les acteurs de la validation ré-appréhendent aujourd’hui en affirmant que de nombreuses expériences sont productrices de savoirs.
A ce sujet constatons que le Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation (1994) ne contient pas de définition du mot expérience pas même au sens où nous venons de l’évoquer, pas plus d’ailleurs qu’il ne définit le concept de tâtonnement expérimental. Son article “savoir” signé de Jacky Beillerot convient toutefois que le savoir, “pour un sujet, est acquis, construit et élaboré par l’étude ou l’expérience“[4]. L’expérience est donc bien productrice de connaissance et d’enrichissement du sujet, c’est d’ailleurs ce qu’affirmait déjà André Lalande dans son Vocabulaire technique et critique de la philosophie (1956, 7e édition) en la considérant comme “un phénomène élargissant ou enrichissant la pensée”, comme “l’ensemble des modifications avantageuses qu’apporte l’exercice à nos facultés, des acquisitions que fait l’esprit par cet exercice, et, d’une façon générale, de tous les progrès mentaux résultant de la vie”. On le voit pour le philosophe, l’exercice de toute nature développe le sujet, favorise des acquisitions intellectuelles et même affirme-t-il “fournit des connaissances” (Lalande A., 1956, pp. 321-322). Même acception dans le vocabulaire courant tant dans le Robert (1972[5]) pour lequel l’expérience est “le fait d’éprouver quelque chose, considéré comme un élargissement ou un enrichissement de la connaissance, du savoir, des aptitudes” ou dans un sens voisin comme “l’ensemble des acquisitions de l’esprit résultant de l’exercice de nos facultés au contact de la réalité de la vie” (Robert, 1972) que dans le Petit Larousse (2000) qui la définit comme “une connaissance acquise par la pratique jointe à une réflexion ou accompagnée d’une observation” ce qui confère à l’expérience pour devenir savoir une dimension nouvelle, celle de la formalisation sur laquelle nous reviendrons et que soulignent de nombreux auteurs (Vincens J., 2001, Barbier J.-M., 1996…)
Ainsi depuis fort longtemps, 1840 aux dires de Jean Vincens, il est avéré que l’expérience ou plutôt les expériences créent du savoir. La nouveauté du questionnement récent n’est donc pas là. Elle est dans la compréhension des conditions de productions de cette connaissance, dans les processus permettant sa “conscientisation” et sa formalisation par l’individu à des fins de reconnaissance et de validations sociales.
Si l’on s’accorde à dire que l’expérience est à la fois un processus – de transformation de soi, des ses représentations, de ses savoirs – et un état résultant de ce processus, il apparaît fort difficile d’en donner une définition aujourd’hui satisfaisante en lien avec les procédures de validations et les savoirs qu’elle recèle. Elle apparaît le plus souvent comme enfouie, intuitive, non-explicite voire non consciente – au moins tant qu’elle n’a pas été distanciée et verbalisée – et les savoirs, qui la constituent, sont qualifiés d’hétérogènes pour ne pas dire d’hétéroclites et, pour le moins, interdisciplinaires et empiriques donc suspects aux yeux des détenteurs du “savoir savant”. En bref, la notion d’expérience est souvent définie, soit de manière sommaire ce qui en réduit la portée et la valeur (Vincens J., 2001, p. 21), soit par défaut et/ou dans des acceptions variées et de fait polysémique (Grasser B., Rosse J., 2000, p. 5). Un travail de clarification s’impose donc. Quant aux savoirs constitutifs de l’expérience, il relève de la dimension cognitive, de savoir-faire acquis en situation professionnelle ou non et de savoirs de socialisation. Le tout enchevêtré, entremêlé, mobilisable dans et pour l’action mais difficile à énoncer et à distinguer d’autant que ses savoirs nombreux et multiformes résument non seulement les acquis de trajectoires professionnelles et de savoirs accumulés dans la sphère privée mais qu’ils sont associés, intégrés au savoir – quelquefois résiduels – de la trajectoire scolaire (Terssac (de) G., 1996, p. 237) voire même entretenant avec cette dernière tantôt des rapports de complémentarité, tantôt des rapports de substitution (Grasser B., Rosse J., 2000, p. 9) quand ce ne sont pas des rapports de concurrence ou de négation. L’expérience est par nature complexe et singulière et ne peut sans doute pas se modéliser, ce qui renvoie à une nécessaire “attitude compréhensive[6]” et à une intelligence des procédures de validations afin de prendre en compte toutes les dimensions individuelles et tous les territoires d’expériences. Il s’agira alors de reconnaître[7] et de prendre en compte tous les savoirs, qu’ils appartiennent à la sphère du travail, du loisir, de la famille, du voisinage, de la vie associative ou syndicale… qui ont ou qui auraient produit des transformations et des acquisitions sur les individus (Pain A., 1983, p. 130). Autant de dimensions et de richesses potentielles de l’expérience qui rendent son appréhension, son analyse et sa valorisation sociale à la fois difficilement transmissible pour le sujet et difficilement visible pour le corps social.
L’autre difficulté, pour le chercheur et les acteurs de la validation, consiste – et là un travail d’élucidation s’impose – à tenter d’unifier, à défaut de distinguer, puis de définir les concepts périphériques, synonymes ou complémentaires de la notion d’expérience. Parle-t-on et tente-t-on de cerner les mêmes réalités lorsque l’on évoque l’expérience, les savoirs d’expérience – qui serait le résultat, la quintessence de cette dernière – les connaissances résultant de l’éducation expérientielle (Gelpi)[8], les savoirs informels (Pain) les savoirs d’action (Barbier) étendus à toute activité, les savoirs ou les connaissances tacites (Schön, Foray, Polany) voire les effets de l’outdoor education (Kerjean) ? En l’absence de ce travail d’élucidation, il nous apparaît opportun d’établir une relative synonymie entre les termes. En effet, une extrême subtilité terminologique, la multiplication des sous-catégories ne rendraient que plus opaque une approche déjà complexe.
Une meilleure compréhension de ce qu’est et de ce que produit l’expérience et une clarification de la terminologie sont indispensables tant pour la valeur “scientifique” des démarches engagées, que pour la crédibilité sociale des méthodologies et des résultats, que pour assurer l’égalité de traitement des usagers – co-substantielle de la notion de service public – en matière de la validation de l’expérience. Ainsi, si de nombreux auteurs conviennent que “l’activité est de facto formatrice, constructrice de connaissance” (Grasser B., Rosse J., 2000, p. 6), un travail important de recherche est à engager, non seulement pour comprendre l’expérience et la valider, mais aussi afin de repérer les modes opératoires nécessaires à son expression et à sa formalisation. En effet, il semblerait que l’expérience “brute” n’est qu’une valeur sociale relative et/ou incertaine tant qu’elle n’est pas passé pas le philtre cognitif et constructif de l’analyse, de la mise en mot par la parole ou l’écriture (Barbier J.-M., 1996, p. 3 ; Thibault M.-C., 2001, p. 138). C’est au prix de cette (re)conceptualisation de l’expérience, d’un travail de formalisation réflexive des savoirs incorporés – sans doute fort implicante pour le sujet – que, semble-t-il, la validation prendra toute sa valeur individuelle et sociétale, c’est-à-dire une valeur non-discutable et qu’elle s’imposera, dans les modes de reconnaissance sociale et de “distinction” comme identique et égale aux autres modes de certification.
Des savoirs de l’expérience ?
L’expérience en général et le travail en particulier ont pour effet de modifier les individus, pas exclusivement et seulement dans leurs corps ou dans leurs modes de socialisation comme on a accepté longtemps de le croire mais aussi dans leurs capacités intellectuelles et cognitives. L’expérience produirait, on en convient aujourd’hui, des savoirs dont la nature et les formes sont encore en débat, mais il s’agit bien de savoir. Reste donc à les identifier ce qui pose de nombreuses questions. Néanmoins, soulignons que les sciences humaines assez généralement sont concernées par ce mouvement fortement dépendant du contexte socio-économique de la période, celui de montée en puissance de l’économie de la connaissance. En effet, les économistes et les économistes du travail (Foray, Vincens…), les sociologues (Barbier, Dubet…), les psychologues (Aubret, Clot, Pastré…), les ergonomes (Falzon, Teiger…), les formateurs (Beillerot, Gelpi, Pain…) tous conviennent, en adoptant des postures de recherche différentes et en produisant des analyses et des discours articulés à leur champ disciplinaire que l’expérience éduque et que des apprentissages importants, voire fondamentaux, peuvent s’y construire. Soulignons cependant, que depuis plusieurs années, certains chercheurs étaient bien conscients de cette réalité même si leurs propos n’étaient pas entendus. Soulignons, davantage encore, que les individus eux-mêmes et les “travailleurs” en particulier, depuis fort longtemps pour les travailleurs de la terre et depuis au moins un siècle pour les travailleurs industriels, savaient et déclaraient – de nombreux témoignages en attestent – que l’expérience était formatrice et que les savoirs d’action pouvaient dans une certaine mesure et dans certaines circonstances être utilisés dans des contextes différents. Les travailleurs et les syndicalistes depuis longtemps étaient conscients de la valeur de l’activité même si jusqu’à présent il ne s’agissait pas ou s’il n’était pas possible de la faire reconnaître.
La question alors se déplace radicalement tant sur le plan idéologique que scientifique. Elle n’est plus de savoir seulement si l’expérience produit de la connaissance mais de mieux appréhender le mode de production et la nature de ces savoirs et, surtout, de connaître l’espace et le statut qui leur seront accordés. Ainsi, les formes des savoirs de l’expérience et leur nature semblent délicates à cerner tant les expériences et les individus sont singuliers et irréductibles à des mécanismes d’apprentissages modélisables. En effet, “il y a plusieurs manière d’apprendre des situations” (Pastré P., 1999 a, p. 16.) et que quand bien même toute activité de travail (est) créatrice de connaissances spécifiques (…) les opérateurs au cours et aux faits du travail construisent des savoirs particuliers” (Falzon P., Teiger C., 1999, pp. 143 et 158) et s’enrichissent “de compétences insoupçonnées” (Clot Y. et Alii, 1999, p. 1) étroitement liés à ce qu’ils sont c’est-à-dire à leur histoire individuelle et sociale. Les processus de constitution de ces savoirs sont aujourd’hui largement ignorés et de nombreuses hypothèses sont au travail. Quant aux savoirs eux-mêmes, souvent incorporés, comme les définit Leplat, ils sont souvent confondus avec la compétence qui n’en n’est – avec d’autres éléments constitutifs – que leur manifestation. Ce qui apparaît certain, c’est d’abord que ce sont des savoirs souvent complexes, non-conscients, protéiformes, parcellaires et discontinus quelquefois, composites et relevant fréquemment d’une approche interdisciplinaire en lien avec la réalité de l’action, enfin qu’ils résistent au découpage académique. “Si le savoir élaboré ou mobilisé par l’expérience correspond rarement au savoir d’une discipline” (Courtois B., 2000, p. 41), il est un savoir et il interroge du même coup nos conceptions et notre rapport au savoir et les modes d’organisation et de reconnaissance sociales qui y sont liés. A ce jour, il apparaît, mais il convient d’être prudent, que les savoirs d’actions sont d’une autre nature et répondent à une autre logique que les savoirs académiques. Les connaissances en actes ne sont pas équivalentes aux connaissances académiques et “on ne saurait trouver “telles quelles” les connaissances théoriques dans l’exercice professionnel (Clot Y. et Alii, 1999, pp. 47 et 53) ou social car elles obéissent à des cohérences conceptuelles différentes, à des logiques de production et d’utilisation déterminées. Si ces connaissances ne sont pas strictement équivalentes, c’est qu’elles sont le résultat de procès différents, c’est pourquoi “la connaissance issue de l’expérience ne peut pas résider “dans” la connaissance théorique et inversement, si l’une ne peut pas être l’extension de l’autre, c’est parce qu’elles n’ont pas la même fonction sociale, elles ne répondent pas aux mêmes organisations formelles (…). En un mot, elles ne sont pas nées dans les mêmes structures symboliques” (Prot B., 2001, p. 136). Ce qui apparaît alors important dès lors ce n’est plus l’équivalence des connaissances, qui à nouveau relancerait le jeu inutile et coûteux socialement de la hiérarchisation, mais les effets et les usages sociaux de leur mobilisation. Ainsi, s’il apparaît bien que les concepts quotidiens et les concepts scientifiques sont deux sources d’intelligibilité qui peuvent se rejoindre mais jamais s’identifier (Clot Y. et Alii, 1999, p. 48), nous affirmons que l’important, c’est que ces deux modes d’acquisitions permettent d’arriver au même résultat en termes de capacité d’agir, d’efficacité (et de pensée), même si cette équivalence résulte de combinaisons différentes d’éléments (Vincens J., 20001, p. 23).
Cependant, si l’opinion d’une expérience formatrice semble fondée, nous ne sommes pas tous égaux face à l’expérience ce qui en matière de justice et d’égalité sociale pose de nouvelles questions, surtout en ce qui concerne la valorisation des expériences de travail. Il y aurait donc expérience et expérience. Celle conduite dans des environnements professionnels ou sociaux riches qui faciliterait l’accès aux savoirs et celle proposée par des environnements pauvres – le travail taylorien en serait l’exemple type – qui serait neutre, sans effet du point de vue des apprentissages, voire même dans des circonstances particulières dés-apprenante, dé-qualifiante et dis-qualifiante. Il est donc important d’être conscient que le travail n’est pas toujours formateur en soi, au moins du point de vue professionnel (Clot Y. et Alii, 1999, p. 38) et que la production de sens et de savoir ne dépend pas du couple emploi-individu mais découle très largement de la qualité des situations de travail (Vincens J., 2001, p. 23), certaines étant contre-productives ou gênant l’apprentissage (Falzon P., Teiger C., 1999, p.160). Constat, qui nous semble-t-il peut être étendu aux situations et aux expériences de vie quant à leur potentialité comme espace et comme opportunité de production de savoir. Un autre élément nécessaire à la production de savoirs par l’expérience au travail, mais à notre sens applicable aux situations sociales, serait celui de l’apparition d’incident, de mise en difficultés, d’occasion d’initiative ou de modification des procédures routinières, voire d’espace de liberté. Ces situations critiques et non planifiables favoriseraient des recherches de solutions, des expérimentations et des réflexions qui aux termes du processus permettraient des apprentissages (Foray D[9], 2000, p. 40).
L’expérience et le travail des mots
Si l’expérience, pour peu que quelques conditions minimales soient réunies, est potentiellement riche d’apprentissages, ces derniers ne seraient que des savoirs bruts qui ne prendraient sens et valeur qu’après, non seulement avoir accédé à la conscience de leur détenteur, mais aussi et surtout après avoir été travaillés et formalisés. La mise en mots de l’expérience permettant à la fois la prise de conscience et la mise en forme des connaissances et pour peu qu’un accompagnement habile soit conduit, le travail sur l’expérience par la formalisation augmenterait la qualité et la transférabilité des savoirs d’action, favoriserait une réelle conceptualisation. La mise en parole apparaît alors comme un moyen de transcender l’expérience, de convertir des savoirs bruts en connaissances reconnues. L’expérience et les savoirs bruts qu’elle produit et recèle ne prendraient alors leur pleine valeur sociale qu’après cette indispensable et nouvelle expérience de formalisation – elle-même productrice d’apprentissage – et organisée à des fins de validations et de reconnaissance.
Ce nécessaire travail cognitif par la mise en mots de l’expérience, est encore une fois, largement partagé par ceux qui travaillent sur ces questions. Il est pour beaucoup la condition essentielle de la transmutation de l’expérience en connaissance et dès lors une condition sine qua non de sa validation et de sa reconnaissance sociale et/ou académique.
Il est donc essentiel dans une première étape de faire surgir à la conscience du sujet que l’expérience n’est pas qu’action ou sensation mais qu’elle contient aussi de la connaissance. Il s’agit donc d’engager un travail d’explicitation précédent un travail d’élaboration (Vermersch P., 1989, pp. 124-125, Barkatoolah A., 1989, pp. 50-52) car les individus seuls “peuvent éprouver des difficultés à dégager de l’expérience singulière vécue un savoir général” (Falzon P., Teiger C., 1999, p. 158). Au-delà, de la transformation du faire ou du sentir en apprentissage, la formulation et la formalisation de l’expérience démultiplient les savoirs expérientiels et quelquefois favorise de nouveaux apprentissages. En effet, l’activité langagière et “le fait de transformer en récit permet d’aboutir à un progrès considérable dans la compréhension et dans la conceptualisation”. L’analyse après coup de l’expérience a pour conséquence et comme effet de produire de l’intelligibilité (Pastré P., 1999 a, pp. 17 et 25). Dès lors le travail d’accompagnement n’est plus un travail de recueil ou “d’accouchement (consistant à la mise à plat des connaissances déjà là à l’état latent) mais un travail de conception débouchant, avec le sujet, sur un développement des connaissances” proximales[10] (Clot Y. et Alii, 1999, p. 35). C’est semble-t-il au prix de la formalisation et de l’écriture que non seulement l’expérience peut devenir connaissances[11], donc être validée et certifiée, mais aussi, et c’est socialement important, transférable à d’autres situations et transmissible à d’autres personnes (Jobert G., Revuz C., 1989, p. 14). Ce constat partagé, par des équipes de chercheurs en Sciences humaines de champs disciplinaires différents et complémentaires, fait apparaître qu’une médiation est nécessaire pour que les savoirs bruts accèdent à la conscience, s’affinent et se renforcent par un travail de formalisation faciliter par la mise en mot. Néanmoins, si les savoirs de l’expérience par ce moyen se transforment, prennent-ils un caractère tout à fait académique et n’impliquent-ils pas de repenser les modalités classiques de l’évaluation afin de les mesurer avec des méthodologies appropriées ?
II Expérience et valeur sociale
Expérience et évaluation
Au-delà de la dimension irréductiblement individuelle de l’expérience et de la difficulté à se raconter pour se reconnaître et se faire reconnaître (Lainé A et Alii, 1991), les processus de validation de l’expérience impliquent de repenser les modes et les faire en matière d’évaluation. En effet, en présence de savoirs non standardisés, non scolarisés, il convient de saisir l’intelligence de l’expérience et d’en extraire ce qui permet à l’individu de nommer les savoirs et de les remettre dans l’ordre nécessaire à la validation. Autant dire que cela implique que face à une expérience singulière et aux savoirs hétérogènes, l’accompagnement doit être strictement individualisé afin de permettre l’émergence des savoirs enfouis, ce qui n’empêche pas, à terme, de penser à construire collectivement des outils renouvelés d’évaluation. La mise en forme par le discours des savoirs expérientiels est à notre avis une manifestation pionnière dans cette direction. Pratique essentielle, en ce que par elle et avec elle, le sujet est directement impliqué dans le travail d’évaluation-construction et non plus en position d’extériorité comme dans bien des dispositifs d’évaluation. La validation des acquis nécessite une implication forte du sujet afin que le travail d’élaboration et non de simple extraction, repéré par l’équipe de Yves Clot (1999), puisse se faire. Dès lors, l’accompagnement n’a plus pour seul enjeu la mesure mais il englobe celui, combien plus important, de la construction de savoir et dont les dispositifs devront tenir compte. Une telle conception modifie radicalement le travail de l’évaluation et la posture de l’évaluateur qui dans une certaine mesure devient intenable car, dans ce contexte, la prise en compte et la reconnaissance des acquis, comme l’écrit Jean Ardoino, “suppose une intelligence de l’évaluation, à travers laquelle le référent, le modèle, ne sont pas préexistants à l’opération d’estimation ou d’appréciation mais s’élaborent, se construisent, littéralement, en même temps que s’effectue l’opération”[12]. Ainsi, le travail de validation appartient-il davantage à une pratique de co-évaluation qu’à une classique pratique sommative dont les outils apparaissent inappropriés à évaluer des savoirs d’action. Constat qui ne sera pas sans interroger les acteurs de la certification et les procédures qu’ils mobilisent. Mais comment pourrait-il en être autrement dans la mesure où les savoirs expérientiels sont le produit de l’agir d’un sujet et non d’un processus cognitif maîtrisé intégrant à leur construction des indicateurs “standards” de mesure ? Les savoirs de l’expérience répondant à d’autres logiques de construction doivent pouvoir être appréhender avec d’autres outils répondant à leur spécificité et en conformité avec leur origine. Nous sommes ici face à deux logiques différentes, l’évaluation doit être cohérente avec celles-ci. En effet, ” par la validation des acquis, la certification joue le rôle d’un révélateur qui donne une visibilité et une reconnaissance aux savoirs d’action. C’est toute la logique du diplôme qui est inversée. En effet, dans le processus “classique”, le diplôme délivré après examen subi au terme d’une formation, atteste que son détenteur possède les savoirs et les savoir-faire requis pour exercer telle ou telle profession. On reconnaît ainsi à celui qui le possède une capacité d’action que l’expérience viendra enrichir, compléter, améliorer. Autrement dit le diplôme a une valeur prédictive des capacités d’action du futur salarié. Le processus mis en œuvre dans la validation des acquis est exactement inverse. Le diplôme se déduit de l’expérience par la capacité à faire et à décrire ce que l’on fait. Dans cette configuration, il joue le rôle de révélateur de capacités d’actions (et des savoirs acquis) par l’expérience et déjà présents chez le salarié. Il ne prédit plus, il enregistre. Et c’est tout son rôle social qui en est affecté. Car derrière ce changement de perspective, se pose la question d’une mise en équivalence entre les acquis de l’expérience et les acquis de la formation. Et cela ne va pas de soi” (Brucy G., Ropé F., 2000, p. 189). Les savoirs d’action, de part leur mode de production, sont résistants (rebelles) aux pratiques classiques de l’évaluation, non seulement parce qu’ils sont singuliers mais aussi parce qu’ils n’ont été acquis à des fins d’évaluation. Il convient donc, pour leur conférer une valeur sociale équivalente à ceux acquis par les voies traditionnelles, de repenser et de modifier nos modes d’appréhension et de mesure de la connaissance. Un tel changement ne se fera pas sans un travail idéologique touchant à la fois le rôle et la place de l’évaluation autant que le statut du savoir et ses formes d’acquisition.
Dans l’attente d’une telle évolution, sachant de toute manière que l’évaluation restera pour une large part intuitive et aléatoire quel que soit l’outillage dont on se dotera, la proposition d’un “dispositif transactionnel” d’appréciation nous semble intéressante. Celui-ci, sans rechercher l’adéquation entre un “référentiel” et le contenu d’une activité sociale ou professionnelle – qui relève de l’impossible – repose sur le principe “d’une dérogation raisonnable” garantissant les intérêts individuels et collectifs en matière de validation (Bonami J.-F., 2000, p. 11). Cette proposition a le mérite de tenter de préserver la valeur sociale des certifications tout en garantissant aux individus, dans le respect de leur expérience singulière, une reconnaissance sociale réelle de leurs acquis sans tomber ni dans l’illusion d’une conformité entre savoirs d’action et savoirs académiques, ni dans celle d’une soumission absolue aux formes académique de la connaissance. La validation de l’expérience ne consiste donc pas à encoder en langage académique des savoirs d’actions ou de les travestir en savoir savant pour satisfaire les institutions et leurs “caciques” mais de reconnaître d’autres formes de connaissances et de production de ces dernières ayant même valeur et même reconnaissance. Il ne s’agit donc pas d’une recherche d’adéquation ou de traduction (toujours traîtresse) mais d’une autre conception de l’apprendre et de la mesure de ses manifestations.
Reconnaître les savoirs et les réinvestir
La problématique de la reconnaissance et de la validation des savoirs de l’expérience ne se limite pas à leur nécessaire certification. Son incidence sociale est beaucoup plus importante de part les effets individuels et sociaux qu’elle produit[13]. Ainsi le travail de la parole, la mise en mots permettent non seulement d’énoncer les savoirs, de les conceptualiser, voire de les approfondir pour les re-co-naître mais aussi, après la prise de conscience de leur existence et de leur valeur, de les réutiliser dans d’autres contextes. Ainsi, cette activité intellectuelle intense permet de donner sens au savoir, de l’intégrer et de le réinvestir (Landry F., 1989, p. 17). De plus, au-delà de la réflexion sur l’apprentissage que ce travail autorise, il permet de passer le cap de l’action “sans conscience” à celle de l’expérience reproductible et adaptable dans un ou plusieurs contextes du fait “des modifications des schèmes mentaux et de pensées” qui facilitent un réinvestissement des résultats dans des situations nouvelles (Barkatoolah A.,1989, p. 52). Ainsi, les savoirs d’expériences validés, non seulement produisent de l’intelligibilité sur soi et son action mais ils apparaissent aussi comme le ressort de nouvelles acquisitions et la possibilité de nouveaux transferts. D’abord parce que le travail en acte a été mis à distance, mis en forme objective (Pastré P. 1999 b, pp 406-407), ensuite du fait des transformations opérer dans le sujet et dans l’image de soi reconquise, les bénéficiaires du travail de validation ayant “développé une confiance dans la portée et la pertinence des savoirs d’expérience et appris à ne plus ignorer ces derniers et à les réinvestir dans les apprentissages futurs” (Saint-Pierre C., 1998, p. 184) et les actions à venir.
Reste à la société tout entière, à ses acteurs et aux institutions dans lesquelles ils agissent à s’interroger sur la valeur heuristique de la validation des acquis, sur la portée des connaissances mises à jour et produites et sur leur capacité à mettre en place des dispositifs et des mobilités permettant de réutiliser ses acquis dans des situations nouvelles. Ce qui implique, sans doute, un autre mode de gestion des personnes et une remise en cause fondamentale des systèmes hiérarchiques et de positionnements sociaux toujours résistants. A cet égard, l’exemple des “diplômés” issus de la promotion sociale est très instructif, leurs diplômes acquis tardivement et par d’autres voies que la formation initiale n’eurent que fort rarement une valeur socialement identique à ceux obtenus par des voies plus classiques. Il importe donc de rester vigilant et de faire en sorte que, quel que soit le parcours et la mode d’évaluation, tous les titres et diplômes aient strictement la même reconnaissance. Simple question d’égalité et de crédibilité.
Nous ne saurions, face à de tels enjeux et de tels équilibres, limiter notre réflexion aux seuls individus. En effet, si nous sommes bien conscient que les savoirs de l’expérience “sont éminemment propres à chacun et dépendent du terrain cognitif et affectif, émotionnel dans lequel ils s’inscrivent (Forestier D. 1999, p. 75), ils ne sont pas réduits à cette seule dimension. Ils sont pour une part non négligeable, nous l’avons évoqué, le résultat d’un environnement favorable. En cela, ils comportent une dimension collective qu’il ne faut pas négliger. Ainsi, les savoirs d’action, même s’ils sont des savoirs individuels, ils sont aussi des savoirs collectifs que la logique de validation devrait mettre à jour et reconnaître aussi dans leur dimension collective. Ainsi, la production de savoir par l’action serait le résultat d’un travail individuel et collectif, inscrit dans un environnement social et/ou professionnel, dont la plus value et les retombées appartiendraient individuellement et collectivement à ces acteurs tout en bénéficiant à la société tout entière. Une telle perspective ouvre des voies nouvelles aux évolutions sociales à venir, à la condition toutefois que la société s’en saisisse et ne renonce pas à ces apports potentiels du fait de frilosité instituée et de pré-carré à préserver.
Pour ne pas conclure
La validation des savoirs d’expérience redonne à l’action et au faire, longtemps péjorés, une place et une valeur sociale équivalente, souvent complémentaire mais non concurrente, à celle des savoirs académiques. Cela va donc dans le sens de ce que François Dubet écrivait, il y a quelques années, lorsqu’il affirmait que “l’expérience n’existe vraiment – et a fortiori les savoirs qui y sont associés – aux yeux de l’individu, que dans la mesure ou elle est reconnue par d’autres, éventuellement partagée et confirmée par d’autres” (Dubet F., 1994, p. 101). Mais que signifie cette convergence d’intérêt des sciences humaines pour l’expérience et sa valeur sociale ? Quel sens donner à ce soudain engouement pour les savoirs d’action et leur valorisation ? Qu’est-ce qui a changé en quelques années pour qu’un décret passé inaperçu lors de sa publication[14] et des pratiques jusqu’alors marginales deviennent un enjeu majeur de Modernisation sociale ? Comment est-on passé en quelques années d’un constat pessimiste mais alors objectif : “nous avons tous des savoirs enfouis (…). Et toute la société fonctionne de telle sorte qu’ (on) ne les découvrent pas” (Schwartz B., 1996, p. 79) à une quasi-unanimité quant à la valeur et la qualité de l’expérience et à la nécessaire validation de celle-ci ? Qu’est-ce qui légitime ou pour le moins explique ce changement radical de paradigme ? Est-ce le résultat d’une évolution sociologique qui (enfin) aboutit à la reconnaissance des individus et de leur action et/ou des savoirs et de la culture ouvrière chère à Michel Verret ? Est-ce le résultat d’une modification philosophique et idéologique du rapport de la société au savoir, d’une pression sociale revendicatrice ou n’est-ce que l’anticipation de nouvelles exigences liées à l’économie de la connaissance comme la promotion sociale et la Loi de 1959 ou celle de 1971 sur l’Education permanente le furent en leurs temps ?
Ce qui apparaît dans ce mouvement, même si aujourd’hui on parle de valider les expériences de nature différente et de restauration narcissique pour le sujet – c’est que le réinvestissement de celles-ci – se fera en premier lieu dans la sphère du travail, de la production et de la concurrence internationale. La fin du travail ne fut donc qu’un mythe provisoire, ou plutôt une illusion, et la validation des acquis et de leur transfert montrent bien en quoi le travail est encore la valeur centrale et l’axe organisationnel des sociétés occidentales. Les enjeux de la validation des savoirs s’inscrivent, à notre sens, dans une refonte planétaire de l’économie ou le savoir fera la richesse des nations et légitimera, mais avec des habits neufs, le système de domination et de partage du travail entre le Nord et le Sud.
Ainsi quels que soient la générosité et l’humanisme sous-jacents de la validation des acquis de l’expérience pour les individus pour laquelle nous militons, il convient aussi de la resituer et de tenter de la comprendre dans un environnement plus macro. D’abord en s’interrogeant sur ses effets sociaux en matière de certification. En effet, ne risque-t-on pas à terme par cette inflation de titres de toute origine une dérégulation des reconnaissances prétexte facile à une dérégulation des qualifications et des rémunérations ? Une telle inflation, voire une telle “babélisation”, des systèmes de certification (Liétard B., 1999, p. 467) n’entraîneront-elles pas, tant au niveau hexagonal qu’européen, une confusion utile à certains intérêts ? Il est évident que la validation des acquis dépasse de loin les seuls intérêts individuels et revêt une dimension stratégique pour l’Union européenne, elle est “d’un point de vue économique (…) bénéfique pour l’accroissement de la flexibilité et de la compétitivité du marché du travail”[15] et indispensable à une économie fondée sur la connaissance où “les déterminants du succès des entreprises et des économies nationales sont plus que jamais dépendants des capacités à produire et à utiliser la connaissance” (Foray D., 2000, p. 4). Tout concourt donc à la mobilisation de tous les savoirs et la dimension humaniste de la validation pourrait, dès lors rapidement, laisser la place à des valeurs plus libérales ou simplement servir d’appâts.
Dans ce contexte, une évolution socialement utile pourrait se retourner contre les individus. Il convient donc d’être vigilant et de donner aux individus et aux organisations des garanties sociales de reconnaissance et de transférabilité. Aux dispensateurs de formation – où la qualité est à la mode – de convaincre qu’ils ne battent pas de la fausse monnaie et aux acteurs sociaux de garantir que les titres obtenus par validation des acquis de l’expérience ne sont pas des assignats.
S’il est opportun de rester lucide sur les enjeux de la validation de l’expérience, elle n’en demeure pas moins une vraie chance pour les individus mais à deux conditions. La première c’est que les individus aient les moyens réels de l’exercice du droit à validation et la seconde c’est qu’elle ne devienne pas une obligation. En d’autres termes, que la liberté d’user ou de ne pas user de ce droit soit respecter et que la pression sociale ne fasse pas naître des formes de validation obligatoire, comme autrefois, il y eut un service du travail obligatoire (STO).
Au-delà, si les conditions sont réunies et si les effets pervers sont évités, la validation des acquis est non seulement une possibilité de mieux se connaître et de mieux se faire reconnaître, mais elle est aussi une occasion de conscientisation interrogeant la dialectique du savoir et des pouvoirs. Elle contient donc en elle-même, une dimension libératrice et subversive, que nous ne saurions nier, et qui peut être sera suffisante pour en maintenir la valeur et éviter des dérives non maîtrisées.
Hugues LENOIR
CEP-CRIEP
Bibliographie[16]
Apprendre par l’expérience (1989), Education permanente, n° 100-101.
Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation (1994), Paris, Nathan.
Aubret J., Gilbert P. (1994), Reconnaissance et validation des acquis, Paris, PUF.
Aubret J. (2001), L’évaluation et la valeur formatrice de l’expérience (entretien), Pratiques de formation, analyses, n° 41-42, juin 2001.
Aumont B., Mesnier P.-M. (1992), L’acte d’apprendre, Paris, PUF.
Barkatoolah A. (1989), L’apprentissage expérientiel : une approche transversale, Education permanente, n° 100-101.
Bonami J.-F. (2000), Valider les acquis professionnels, Paris, Editions d’Organisation.
Brucy Guy, Ropé Françoise (2000), Suffit-il de scolariser ? Paris, Editions de l’Atelier.
Clot Y., Ballouard C., Werthe C. (1999), La validation des acquis professionnels : nature des connaissances et développement, Ministère de l’Education nationale, de la recherche et de la technologie, CPC Documents n° 99/4.
Courtois B. (2000), L’expérience formatrice : entre auto et écoformation, Education permanente n° 145.
Barbier J.-M. (1996), dir., Savoirs théoriques et savoirs d’action, Paris, PUF.
Dubet François (1994), sociologie de l’expérience, Paris, seuil.
Falzon P., Teiger C. (1999), Ergonomie et formation in Carré P., Caspar P. (1999), Traité des sciences et des techniques de la Formation, Paris, Dunod.
Farzad M., Paivandi S. (2000), Reconnaissance et Validation des acquis en formation, Paris, Anthropos.
Forestier D. (1999), La validation des acquis professionnels, Educations, n° 18-19.
Foray D. (2000), L’économie de la connaissance, Paris, La Découverte.
Gelpi E. (1989), Quelques propos politiques sur l’éducation expérientielle, Education permanente, n° 100-101.
Grasser B., Rosse J. (2000), L’expérience professionnelle, son acquisition et ses liens à la formation, Formation-emploi, n° 71, juillet-septembre.
Jobert G., Revuz C. (1989), Ecrite, l’expérience est un capital in AFPA, La formation des formateurs, l’expérience AFPA, Education permanente, n° spécial.
Kerjean A. (1989), Apprendre par l’expérience : la formation expérientielle pour adultes et le développement des aptitudes sociales et cognitives in Education Permanente, AFPA, La formation des formateurs, l’expérience de l’AFPA.
Kirsch E., Savoyant A. (1999), Evaluer les acquis professionnels, entre normes de certification et singularité des parcours professionnels, Bref, n° 159, déc., CEREQ.
Lalande A. (1956), Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF,
(7e édition).
Landry F., (1989), L’apprentissage expérientiel : une notion et des pratiques à déchiffrer, Education permanente, n° 100-101, 1989.
Lainé A., Avezou J., Bachelard D. (1991), Reconnaître les acquis. Démarche d’exploration personnalisée, in Histoire de vie et reconnaissance des acquis (dir : Pineau G., Liétard B., Chaput M.).
Liétard B. (1999), La reconnaissance des acquis, un nouvel espace de formation, in Carré P., Caspar P., dir., Traité des sciences et des techniques de la Formation, Paris, Dunod.
Lenoir H. (2001), Significations et usages sociaux de la validation des acquis professionnels dans les itinéraires de formation in Formation, Emploi et Précarité Lenoir H. et J.-L. Marais, dir., Paris, L’Harmattan.
Pain A. (1983), Education informelle : un territoire à explorer, Education permanente, n° 69.
Pastré Pierre (1999,a), comprendre après coup grâce à la simulation, Education Permanente EDF/GDF, n° 139.
Pastré P. (1999,b), Ingénierie didactique professionnelle in Carré P., Caspar P. (1999), Traité des sciences et des techniques de la Formation, Paris, Dunod.
Prot B. (2001), sur quelques conditions sociales du développement de la conscience dans les activités de travail, Education Permanente n° 146.
Schön D.A. (1994), Le praticien réflexif, à la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Montréal, Editions Logiques.
Schwartz B. (1996) , Le changement est affaire de volonté politique, Education permanente, n° 129.
Saint-Pierre C. (1998), Du pouvoir, du savoir, des infirmières et du perfectionnement in Solar C., Pédagogie et Equité, Montréal, Editions Logiques.
Terssac (de) G. (1996), Savoirs, compétences et travail in Barbier J.-M. (1996).
Thibault M.-C. (2001), VAP et donc savoirs ! Pratiques de formations, analyses, n° 41-42, juin.
Vincens J. (2001), Définir l’expérience professionnelle, Travail et emploi, n° 85, janvier.
Vermersch P. (1989), Expliciter l’expérience, Education permanente, n° 100-101.
Document vidéo
CUCES (1996) : La validation des acquis dans l’enseignement supérieur, les savoirs de l’expérience, Nancy, CUCES-Université.
[1] Freire P. (1992), Pédagogia da esperança, Sao Paolo, Paz y Terra, p. 85 in Pédagogues contemporains (dir. Houssaye J. (1996), Paris, Colin, cité par Noava A. Paolo Freire, p. 46.
[2] 1994 pour la traduction française.
[3] Savoir brut au sens d’art brut, c’est-à-dire sans lien avec l’académisme, sans prétention à l’universel, sans lien avec la marchandise et sa valeur.
[4] Souligné par nous.
[5] Pour se référer à un passé récent.
[6] Au sens de la sociologie compréhensive
[7] Dans tous les sens du terme.
[8] Les références explicites de ses positions sont celles en particulier mais pas exclusivement citées en bibliographie.
[9] D. Foray fonde son propos sur un ensemble des travaux récents en particulier nord-américains.
[10] L’équipe de Yves Clot se réfère explicitement des travaux de Vigotski
[11] Affirmation qui donne à penser quant aux procédures et aux effets de la validation par simple observation comme le propose le système NVQs anglais ou l’AFPA. Nous partageons sur ce point l’analyse de Kirsch E. et Savoyant A. pour lesquels : “L’observation ne permet d’identifier facilement les connaissances théoriques mobilisées par le candidat, car les savoirs ne sont pas toujours directement lisibles dans l’action” in Evaluer les acquis professionnels, entre normes de certification et singularité des parcours professionnels, Bref, n° 159, déc. 1999, CEREQ, p. 4.
[12] Cité par Farzad M., Paivandi, 2000, pp. 71-72
[13] A ce sujet se reporter à Lenoir H (2001), Significations et usages sociaux de la validation des acquis professionnels dans les itinéraires de formation in Formation, Emploi et Précarité (dir. : Lenoir H. et J.-L. Marais), Paris, L’Harmattan.
[14] Allusion au décret du 23 août 1985 sur la validation des acquis dans l’enseignement supérieur.
[15] Déclaration de Frits Bolkestein, commissaire européen du marché intérieur, Inffo Flash, n° 572, août 2001.
[16] Cette bibliographie ne contient que les ouvrages consultés pour réaliser ce texte.