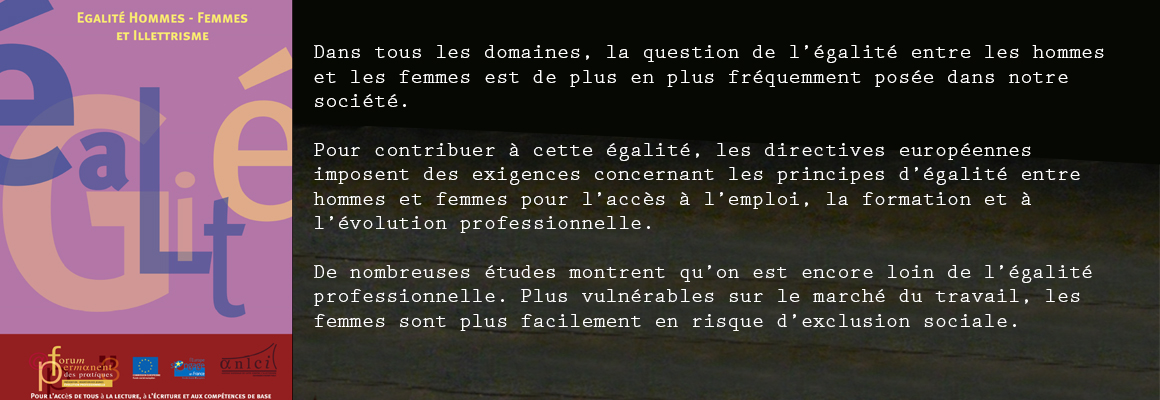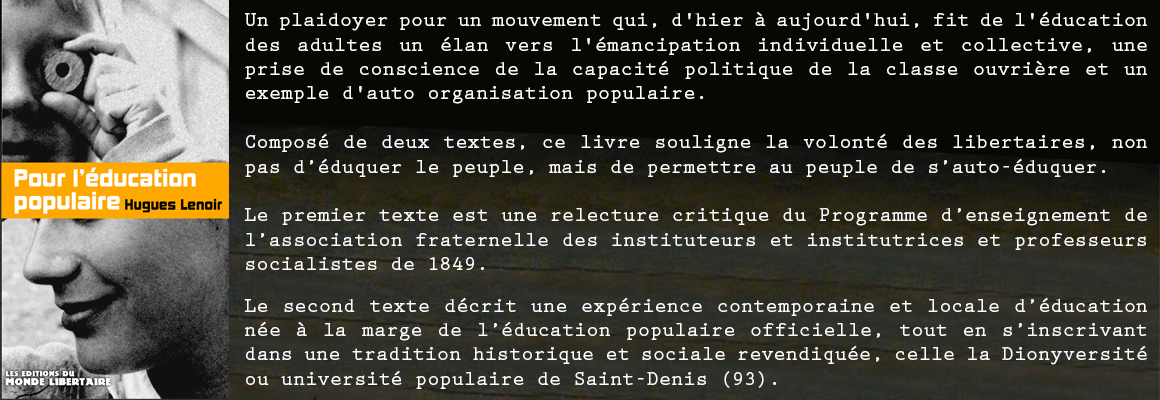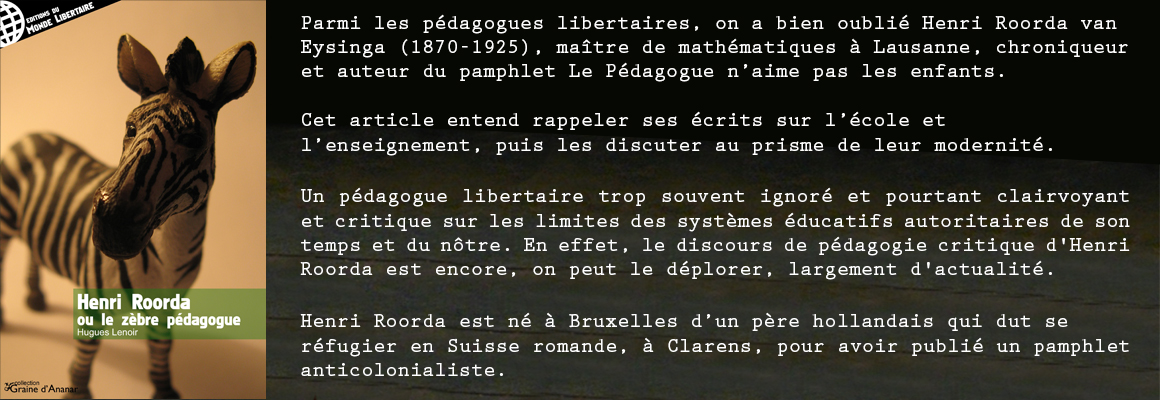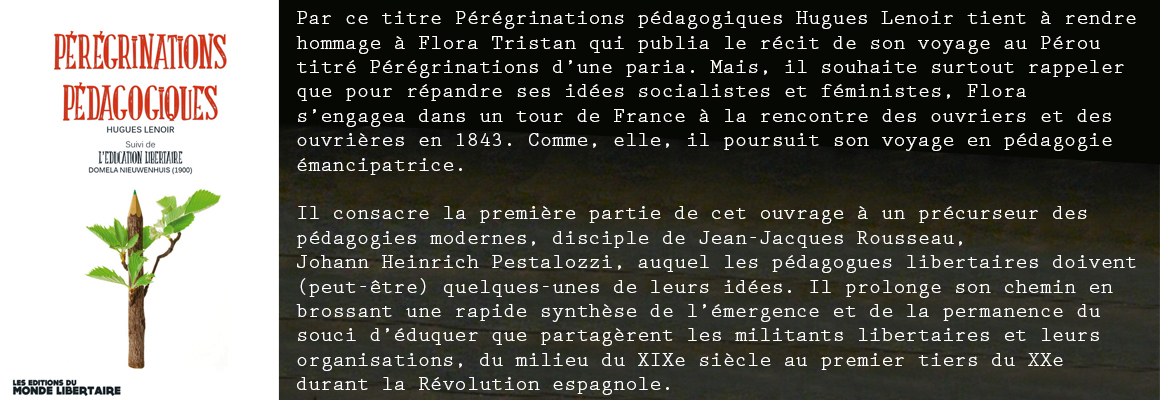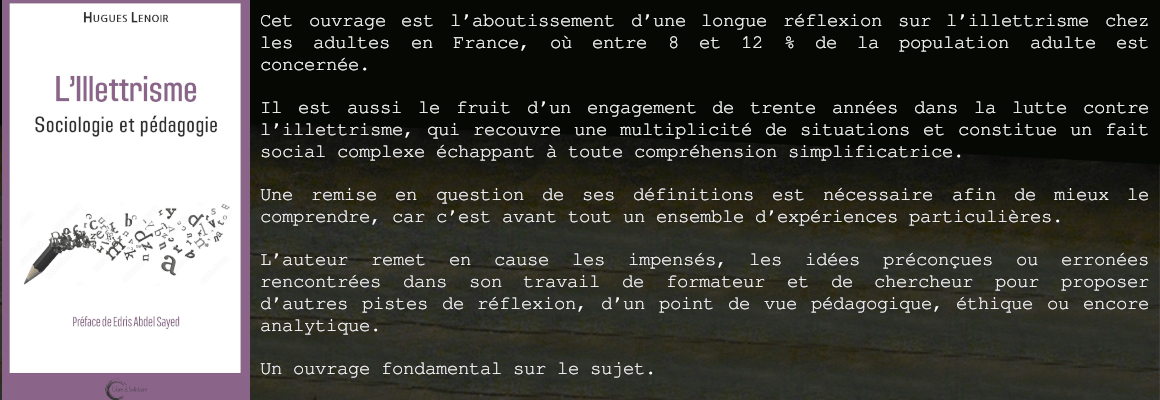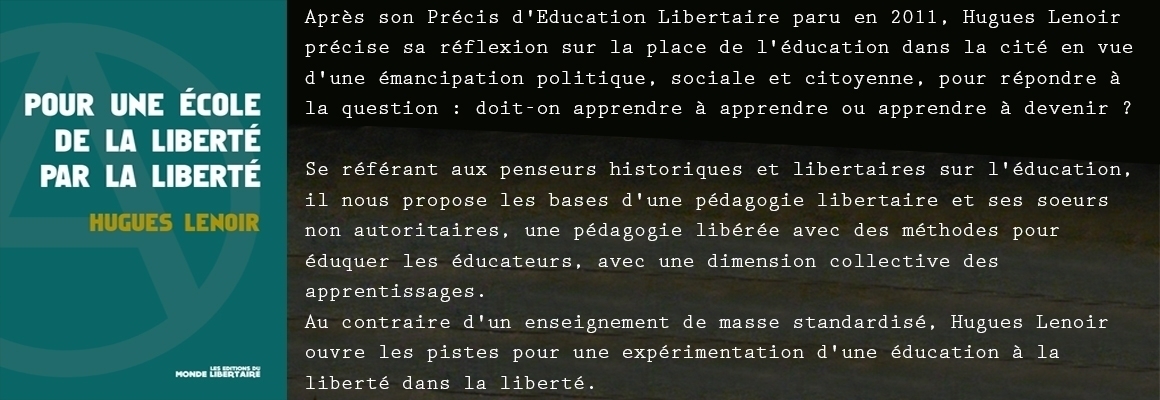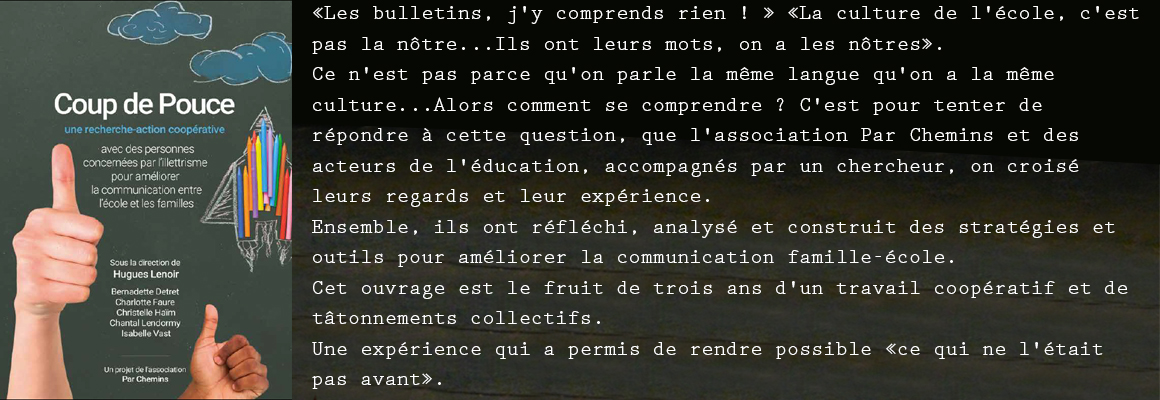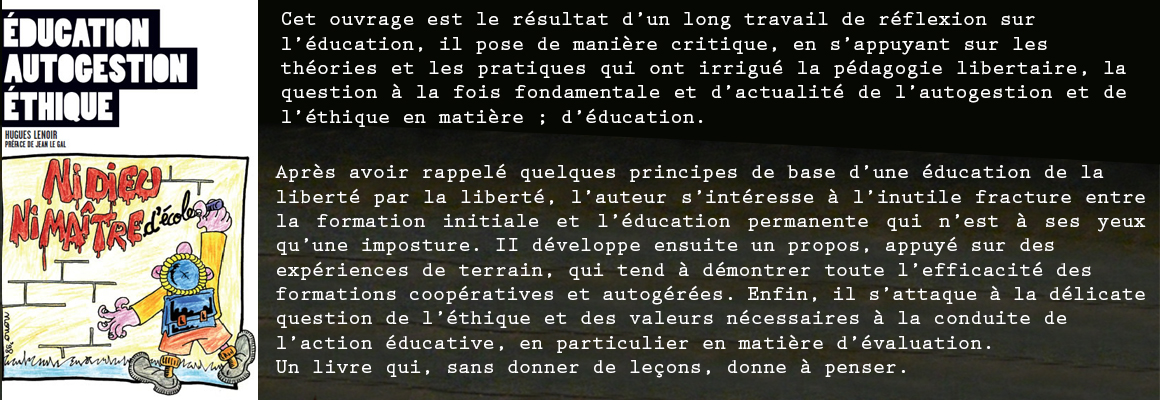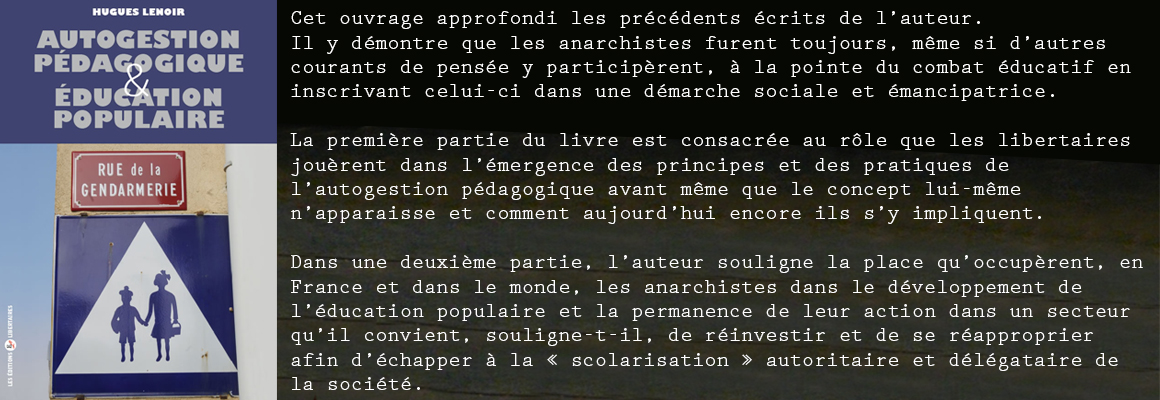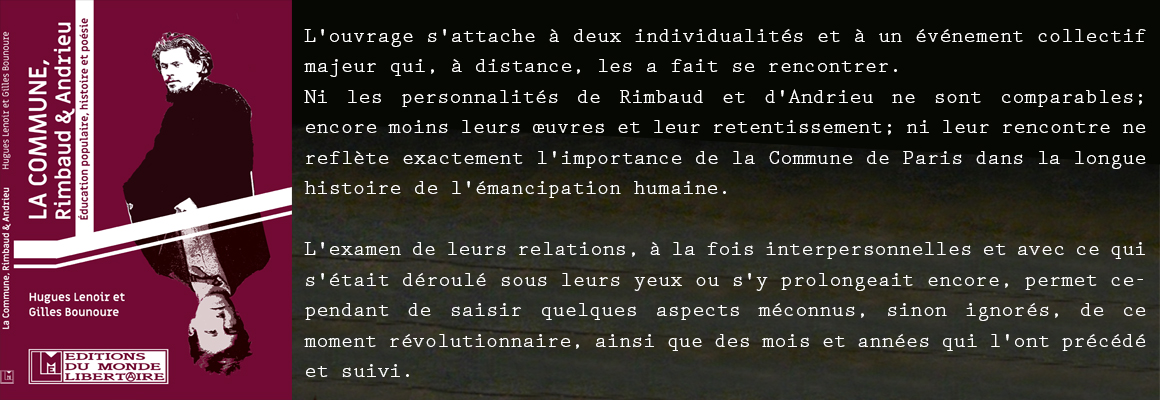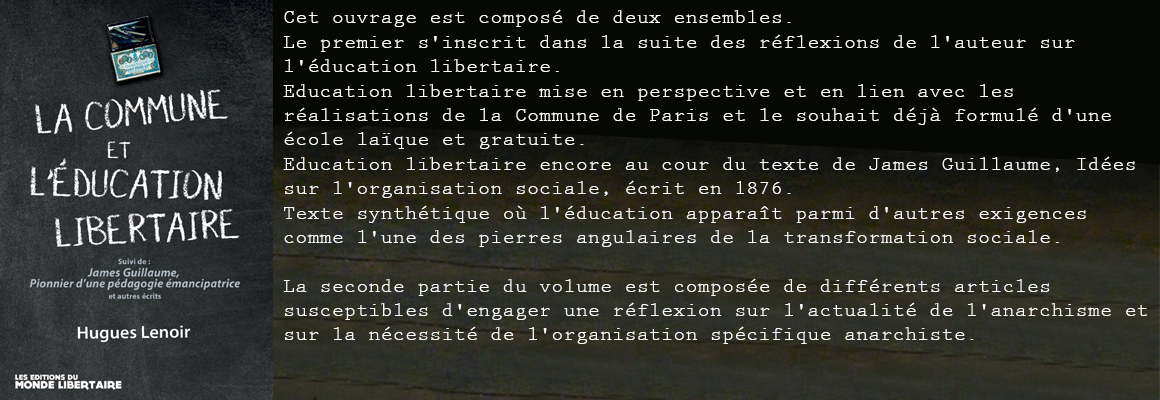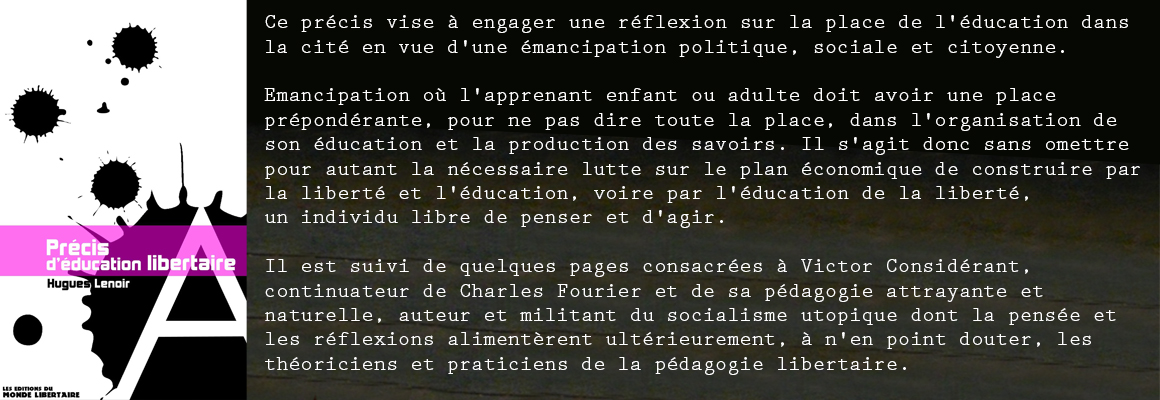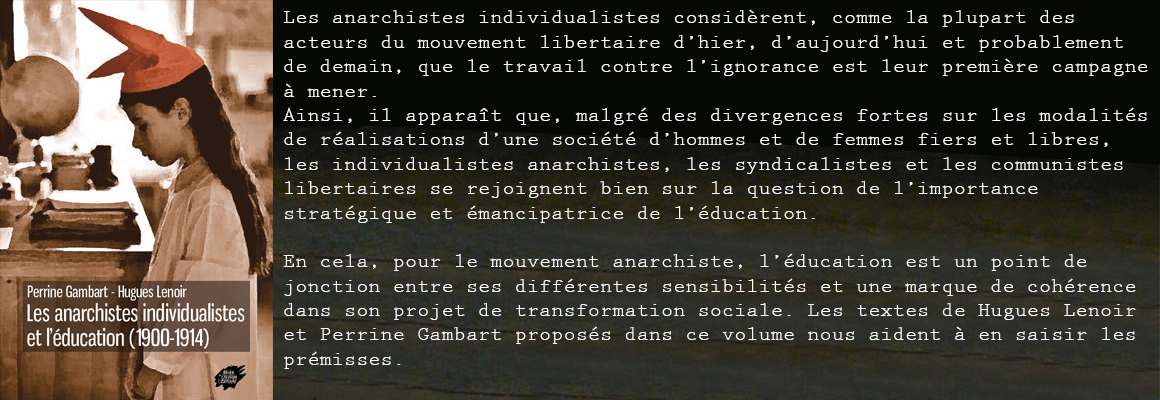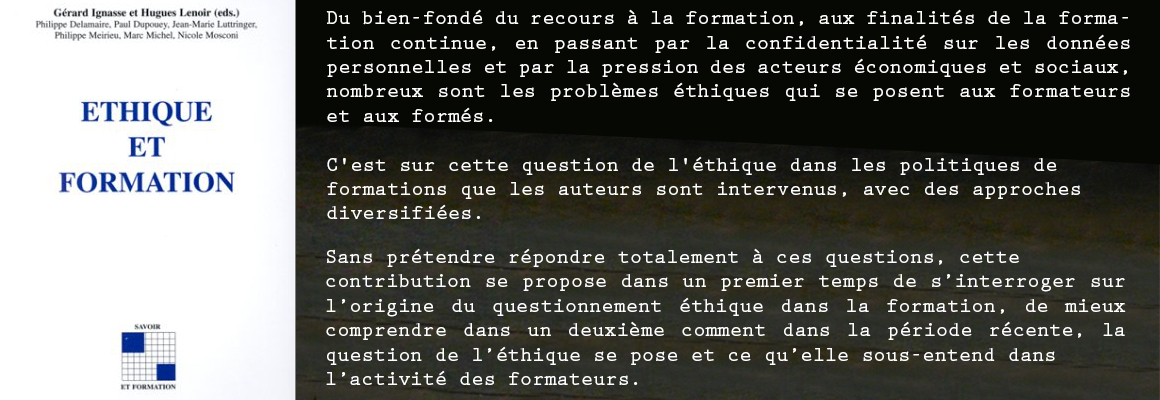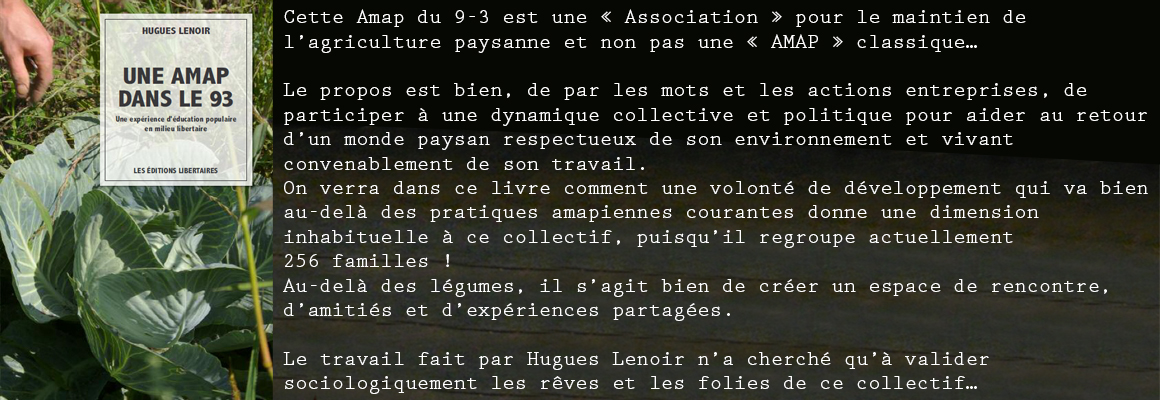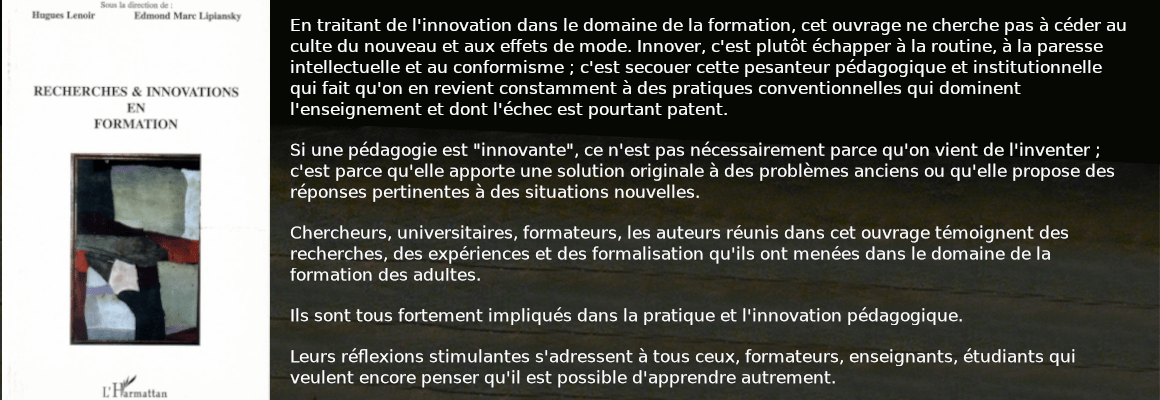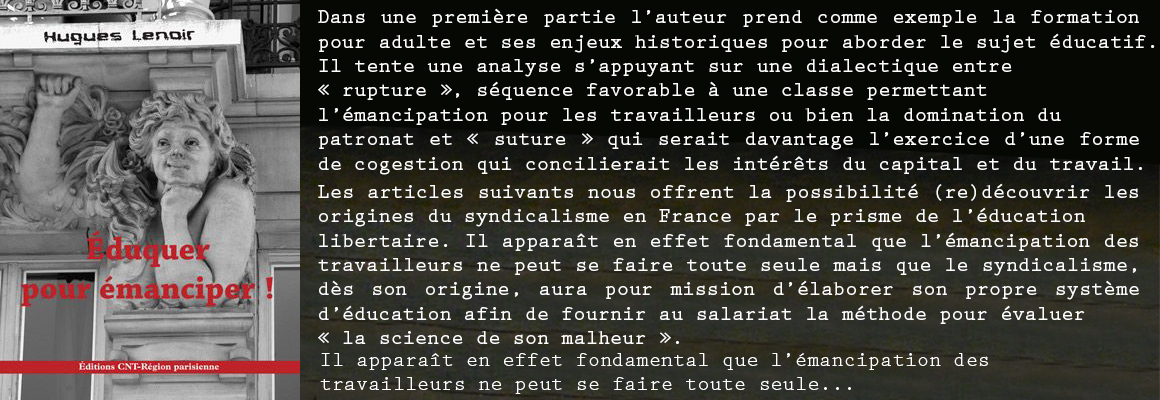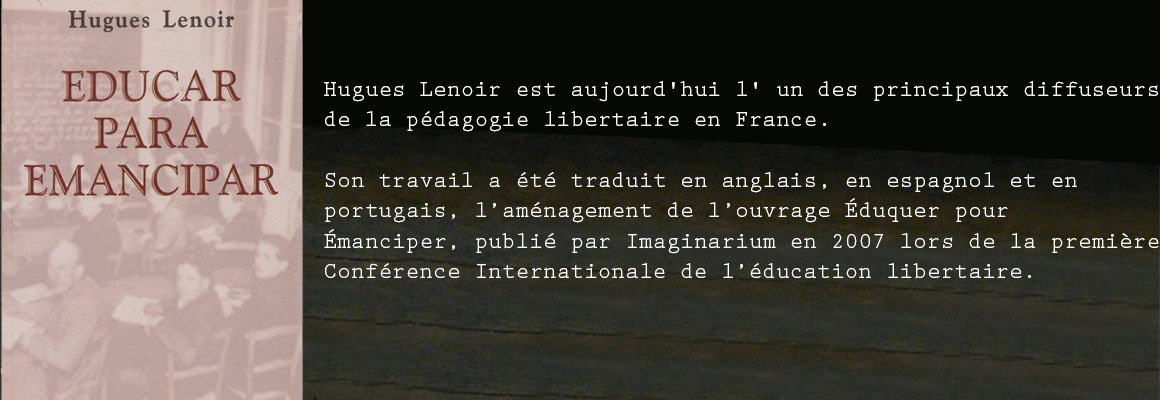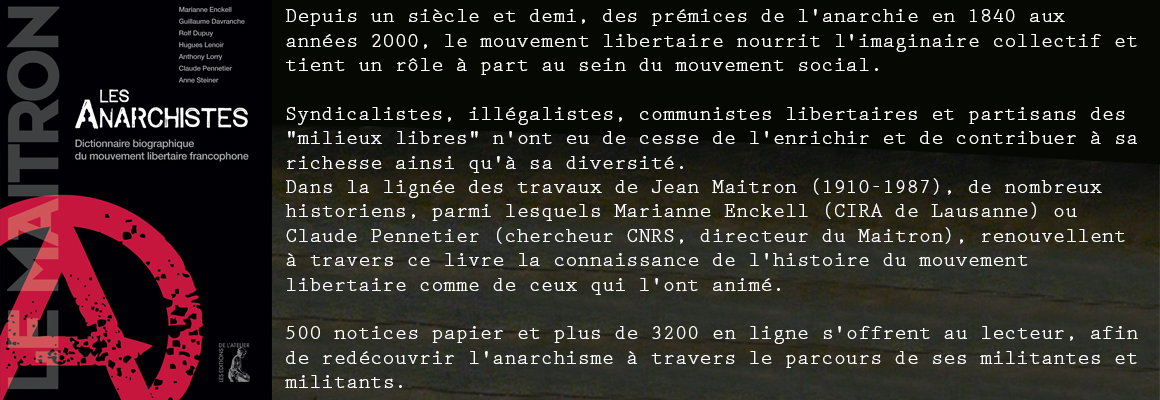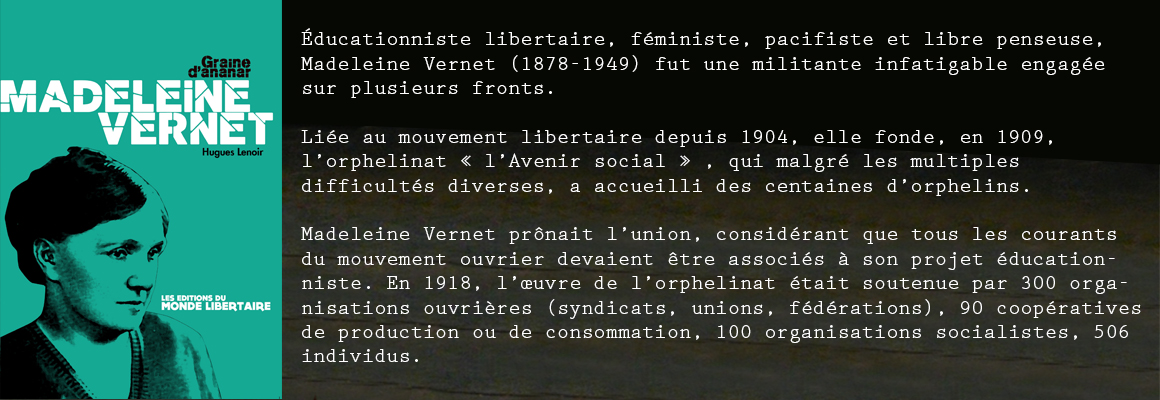A L’ORIGINE DU SYNDICALISME : L’EDUCATION
OU
EDUQUER POUR EMANCIPER[1]
“La mission révolutionnaire du prolétariat éclairé
est de poursuivre plus méthodiquement,
plus obstinément que jamais, l’oeuvre d’éducation
morale,administrative et technique pour rendre viable
une société d’hommes fiers et libres”.
Fernand Pelloutier (1er mai 1895)
L’éducation et la formation sont-elles des composantes associées au syndicalisme dès son origine ou n’apparaissent-elles que tardivement dans la panoplie d’outils, voire de revendications, des militants et des animateurs du syndicalisme ? Quelle place et quel rôle leur sont-ils dévolus ? Sont-elles ou non indissociables du syndicalisme révolutionnaire, et plus tard de l’anarcho-syndicalisme, dont nous traiterons presque exclusivement ici ?
L’éducation et la formation sont-elles ou non un point nodal de l’action syndicale ou seulement une préoccupation incidente née au hasard de l’action sociale ? En d’autres termes, l’éducation et la formation sont-elles une valeur fondatrice du syndicalisme ou une simple option nécessaire ? C’est à ces questions que nous essaierons de répondre.
Peu de choses ont été écrites, même si les allusions sont nombreuses, sur la place de l’éducation des adultes dans les pratiques et les conceptions du syndicalisme d’action directe comme le nomme Jacques Juillard. Ainsi, pour tenter de répondre à l’interrogation formulée plus haut, nous avons procédé à la lecture et au croisement à plusieurs niveaux, des textes des précurseurs du syndicalisme révolutionnaire, avec ceux des fondateurs et des animateurs de la première heure des Bourses du Travail et de la C.G.T., et ceux des historiens et des analystes de mouvement ouvrier, autant ceux d’aujourd’hui que ceux des années 1910-1930. Enfin, pour asseoir notre opinion, nous avons consulté les textes des organisations et des militants qui, dans les années 1930 et au-delà, sont considérés comme les héritiers de ce syndicalisme des origines.
Avant d’aller plus loin, il nous apparaît opportun de préciser quelques éléments. D’abord nous traiterons de la formation en général comme d’un outil (parmi d’autres) d’émancipation sociale, et non pas strictement de la formation professionnelle continue telle que nous l’entendons aujourd’hui. La distinction entre formation permanente et/ou formation professionnelle n’est pas fondée lorsqu’on s’intéresse à cette période, pas plus qu’il n’est facile de distinguer toujours éducation initiale et formation continue. Nous n’aborderons pas non plus les formations spécifiques en direction des militants dont la préoccupation n’apparaît en tant que telle que plus tardivement, lorsque, pour une part, le syndicalisme aura pris d’autres orientations. Quant à nous, nous avons choisi d’employer ici indistinctement éducation ou formation.
Il convient de préciser encore que dans les textes militants du début du siècle, il est la plupart du temps possible de séparer l’éducation de la propagande, mais quelquefois la confusion existe car aux yeux de certains, la propagande est aussi éducation. Ainsi pour Marc Pierrot, militant syndicaliste et libertaire, les deux notions s’associent et se conjuguent si intimement qu”il emploie à dessein les termes de “propagande éducatrice”[2].
De nombreux écrits évoquent aussi la nécessité d’une éducation morale de l’ouvrier, mais cette éducation n’a rien à voir avec une quelconque tentative de moralisation et d’uniformisation de la conscience prolétaire. Cette éducation s’inscrit tout entière dans la logique du texte de Fernand Pelloutier cité en exergue et participe à la réalisation “d’une société d’hommes fiers et libres”. En effet, au-delà d’une éducation syndicaliste stricto sensu et quelquefois formelle dont nous allons traiter, il faut comprendre cette “éducation morale” comme une forme de socialisation révolutionnaire produite par l’activité et la fraternité syndicalistes, car, aux yeux de quelques-uns, “c’est surtout dans les syndicats que se fait l’éducation morale des ouvriers : dignité individuelle, sympathie et solidarité”[3].
Nous procèderons en trois temps. Dans un premier, consacré aux “précurseurs”, nous évoquerons Pierre-Joseph Proudhon, en particulier De la capacité politique des classes ouvrières, et les résolutions issues des premiers congrès de l’Association Internationale des Travailleurs (A.I.T.). Un deuxième temps sera consacré à Fernand Pelloutier, aux Bourses du Travail et aux textes les plus significatifs produits par les militants syndicalistes révolutionnaires. Enfin, dans un troisième, nous examinerons si les “héritiers” de ce courant, plus précisément Pierre Besnard et la C.G.T.-S.R[4]., s’inscrivent ou non dans cet esprit d’éducationnisme révolutionnaire.
LES PRÉCURSEURS
L’apport de Pierre-Joseph Proudhon
Sans ignorer Flora Tristan qui, déjà, avait foi en la classe ouvrière et dans le pouvoir de l’éducation et qui écrivait à propos d’ouvriers lyonnais, qu’elle avait constaté chez tous un “grand esprit de justice (et que) si ces hommes étaient instruits, développés intellectuellement, ils seraient bien supérieurs à ce qu’on rencontre communément parmi les bourgeois”[5]. Sans ignorer non plus Charles Fourier, auquel Pierre-Joseph Proudhon emprunta le concept d’éducation intégrale dont se réclamèrent longtemps les militants syndicalistes, nous privilégierons l’auteur de De la capacité politique des classes ouvrières, tant cet ouvrage nous apparaît anticipateur de ce qui se constituera ultérieurement sous le terme de syndicalisme et dans lequel l’auteur se propose d’oeuvrer dans le sens de “l’émancipation intellectuelle du peuple”[6]. Puis, nous aborderons, les débats de la Première Internationale (A.I.T.) qui souvent firent de l’éducation une question de congrès.
L’éducation fut pour Proudhon un constant souci et l’éducation du peuple par le peuple, la Démopédie[7], une exigence permanente. Sa conception de l’éducation est à la fois large et étroitement articulée avec le travail. Il préconise en effet, l’égalité entre la formation intellectuelle et la formation professionnelle qu’il nomme “polytechnie de l’apprentissage”[8]. Elle est, au-delà, un outil de réalisation de l’individu et un levier d’émancipation sociale. Pour lui, “l’organisation de l’enseignement est tout à la fois la condition de l’égalité et la sanction du progrès”[9]. Mais pour cela, l’école doit s’émanciper à son tour du joug étatique ou religieux qui ne vise, par l’instruction élémentaire, qu’à enfermer la jeunesse et le futur producteur “dans l’étroitesse de ses fonctions parcellaires”[10] car sans garantie et sans contrôle des associations ouvrières “l’enfant envoyé aux écoles ne sera toujours qu’un jeune serf dressé pour la servitude, au mieux des intérêts et de la sécurité des classes supérieures” : or, ajoute Proudhon, “nous voulons des travailleurs civilisés et libres”[11].
Dans cet ouvrage, l’auteur consacre le chapitre VII de la troisième partie à l’instruction publique. Il y précise sa conception de l’éducation qui, plus tard, sera reprise par les animateurs des Bourses du Travail et les syndicalistes révolutionnaires. Pour lui, ” l’enseignement dans une société justicière, mutualiste et libre”[12] doit tendre “à faire de chaque élève un ouvrier complet[13]” chez lequel “il s’agit de développer par une éducation intégrale, comme disait Fourier, le plus grand nombre d’aptitudes et de créer la plus grande capacité possible[14]“. “On comprend ici, ajoute-t-il, que les associations ouvrières sont appelées à jouer un rôle important. (…), elles deviennent à la fois foyers de productions et foyers d’enseignement”[15]. De plus, cette “instruction de l’homme doit-être (…) tellement conçue et combinée qu’elle dure à peu près toute la vie. Cela est vrai de tous les sujets, et des classes ouvrières encore plus que des savants de profession. Le progrès dans l’instruction (…) est de toutes les conditions et de tous les âges : c’est la première garantie de notre dignité et de notre félicité”[16].
Pour Proudhon, point de salut et point de socialisme sans éducation. Pour lui, le lien entre ces deux concepts est une exigence absolue et un gage de réussite pour l’avenir. C’est pourquoi, il incitera fortement les associations ouvrières, en gestation dans les années 1850, à s’emparer de la question de la formation. Edouard Dolléans, dans son Histoire du mouvement ouvrier note à propos de La Capacité politique des classes ouvrières, dédiée rappelons-le à quelques ouvriers de Paris et de Rouen : “parmi tant d’autres points de rencontres entre Proudhon et les ouvriers (…), il en est un, essentiel : la conception commune qu’ils ont de l’éducation et du travail. Lorsqu’au point culminant de sa vie, Proudhon affirme sa confiance dans le devenir et la capacité de la classe ouvrière, il garde vis-à-vis de celle-ci les exigences d’un moraliste dont la philosophie sociale a pour centre la réforme de l’homme. Il demande à la classe ouvrière de prouver par ses vertus, sa capacité. Les luttes sociales ne peuvent se mener qu’avec ténacité, courage, stoïcisme. Il réclame de l’élite ouvrière des vertus héroïques. Un enseignement, à la fois professionnel et humaniste, doit favoriser cette formation. Pour Proudhon, l’atelier et l’école font un tout : ils se complètent, et leur enseignement se rejoint pour former l’homme, le travailleur (…). L’union de l’atelier et de l’école permettra de restituer au travail sa signification et sa joie. L’alliance intime de l’enseignement humaniste et scientifique et l’apprentissage industriel est, aux yeux des ouvriers parisiens, la condition même de l’émancipation sociale”[17]. Cette alliance intime entre éducation, émancipation sociale et travail préconisée par le père de l’autogestion inspirera les générations militantes ultérieures et guidera le syndicalisme naissant. En d’autres termes, pour Pierre-Joseph Proudhon “le plan de l’instruction ouvrière consiste (…) à conduire l’homme par la tête et par la main, à la philosophie du travail qui est le triomphe de la liberté”[18]. C’est cette conception commune, soulignée par Edouard Dolléans, entre Proudhon et les ouvriers qui explique en grande partie, d’une part “la forte empreinte[19]” des anarchistes dans le syndicalisme révolutionnaire et d’autre part la place que l’éducation intégrale occupera dans la stratégie syndicaliste. Proudhon avait de fait conçu, c’est pourquoi le “parti de travail”[20] s’en empara, “un système d’éducation adéquat aux producteurs dans une société où le producteur serait souverain”[21].
La référence à l’Association Internationale des Travailleurs (A.I.T.)
L’éducation apparaît comme une question centrale et récurrente dans les débats de la Première Internationale dont se réclameront le mouvement des Bourses du Travail et plus tard la C.G.T.
En effet, dès le second congrès de l’A.I.T. à Lausanne en 1867 sera évoquée la nécessité d’un enseignement intégral inspiré de Proudhon. Le congrès émettra d’ailleurs “une résolution en faveur de l’organisation de l’école-atelier, et d’un enseignement scientifique, professionnel et productif”[22]. En effet, aux yeux des internationaux, en particulier parisiens, “l’instruction et l’éducation sont (…) une des conditions de leur émancipation et comme l’affirme, l’un d’entre eux, Heligon : “l’absence d’instruction met le travailleur sous la dépendance de ceux qui la possèdent”[23].
Au congrès de Bruxelles en 1868, la question de l’éducation est de nouveau inscrite à l’ordre du jour ; son point quatre a pour thème : L’enseignement. James Guillaume rappelle dans ses souvenirs la motion adoptée alors et inspirée du texte de Lausanne : “le congrès invite les différentes sections à établir des cours publics suivant un programme d’enseignement scientifique, professionnel et productif, c’est-à-dire (un) enseignement intégral, pour remédier autant que possible à l’insuffisance de l’instruction que les ouvriers reçoivent actuellement”[24]. Il s’agit par la formation de produire un individu libre, autonome, complet et revendicatif qu’on ne saurait enfermer dans un quelconque carcan éducatif à caractère limité et “ouvriériste”. Comme le souligne Emile Aubry, lithographe, influencé par les idées de Proudhon : “c’est une erreur des plus funestes de penser que la culture des belles lettres et des sciences, que l’étude rend inhabile, impropre aux travaux manuels ; c’est tout le contraire qui doit avoir lieu. Il suffit de faire la juste part de l’un et de l’autre. Tantôt la plume, tantôt l’outil à la main, voilà l’homme fort, l’homme de l’avenir”[25].
En 1869, un an plus tard au congrès de Bâle, l’éducation intégrale est encore inscrite au débat et fait l’objet d’une motion. Le congrès recommande en effet “à toutes les sections des groupes d’organiser dans leur sein des séances de discussion où sera abordée l’étude de tous les sujets se rattachant aux sciences, aux arts, aux métiers[26]“. Incitation qui n’est pas sans préfigurer déjà les futures universités populaires qui verront le jour à la fin du XIXème siècle.
Les débats tendus entre les partisans du socialisme libertaire réunis autour de Michel Bakounine et ceux du socialisme autoritaire réunis autour de Karl Marx feront passer au second plan, puis occulteront les discussions sur l’éducation, sans pourtant les faire totalement disparaître. Mais le signal est donné, le syndicalisme et les Bourses du Travail s’empareront de la question de la formation et en feront l’une de leurs missions et de leurs priorités.
La Commune
Quant à l’éphémère Commune de Paris, que nous ne pouvions pas ne pas évoquer ici, nous savons le rôle qu’y jouèrent les proudhoniens et les internationaux, en particulier Eugène Varlin. Elle tenta durant ses 100 jours de mettre en pratique ce que les différents congrès de l’Association Internationale des Travailleurs avaient préconisé. Durant sa brève existence, la Commune mit en place “dans le domaine éducatif, sous l’impulsion d’Edouard Vaillant, une commission, où se retrouvaient Courbet, Vallès, Clément… (Elle) a tenté de promouvoir un enseignement intégral. Les journaux de la Commune y faisaient référence. (Il s’agissait, lisait-on) dans Le Père Duchêne de “former des hommes complets, c’est-à-dire capables de mettre en oeuvre toutes leurs facultés et de produire non seulement par le bras mais, aussi par l’intelligence”[27].
Dès la sanglante répression contre les communards passée, et malgré la loi du 14 mars 1872 qui punit l’affiliation à l’Internationale de peines diverses, des cercles ouvriers réapparaissent et inscrivent au centre de leurs préoccupations, mais aussi pour une part comme prétexte afin d’éviter sans doute les foudres de Monsieur Thiers, la question de l’éducation. Ainsi, “le 28 août 1872, vingt-trois associations ouvrières se hasardent à créer un cercle de l’Union Syndicale Ouvrière qui est dissout par le Préfet de police bien que ses statuts aient limité son activité à l’enseignement professionnel, au progrès moral et matériel des travailleurs”[28]. Dans le même esprit un premier congrès ouvrier “se tient à Paris du 2 au 10 octobre 1876 ; son président, Chabert prend l’engagement, à la séance d’ouverture, que le congrès restera purement ouvrier, économique et corporatif (…). La plus hardie de ses revendications est l’éducation nationale, professionnelle et gratuite à tous les degrés”[29].
L’éducation est l’un des éléments précurseurs et fondateurs, depuis longtemps en gestation dans la réflexion ouvrière, qui se retrouvera tout naturellement dans la pensée syndicaliste révolutionnaire car elle sera l’un des moteurs de la société future. Comme le remarque Jean-Daniel Reynaud : “les groupes corporatifs sont les cellules de la société fédéraliste prochaine”. Cette formule de Pelloutier montre le rôle majeur du syndicalisme : il est moins un instrument d’action et de défense que le germe et la préfuguration des modalités sociales d’organisation de l’avenir. Aussi n’est-il nullement paradoxal que ce mouvement violent et radical ait toujours retenu pour première tâche l’éducation : “l’éducation économique du prolétariat…, la culture de son esprit d’initiative…, son façonnement aux modalités d’un organisme socialiste”[30].
Nous retrouverons cette permanence et cette transversalité de la formation et de l’éducation chez ceux qui furent aux sources du syndicalisme, non pas comme simple outil tactique mais comme associé à une volonté émancipatrice sans compromis.
LES FONDATEURS
Sans ignorer les autres courants du syndicalisme du début du siècle, nous centrerons notre propos sur l’éducation et la formation, sur le discours de ceux qui animèrent sa composante essentielle, celle qui se revendique du syndicalisme révolutionnaire. Néanmoins, afin de confirmer nos analyses, nous évoquerons quelquefois certains acteurs-auteurs du courant réformiste et nous nous référerons aux écrits des historiens spécialistes du fait syndical dans cette première période.
Avant de nous intéresser à l’oeuvre conjointe de Fernand Pelloutier et des Bourses du Travail en matière d’éducation, il convient de rappeler ce que l’on entend par syndicalisme révolutionnaire. Dans les années 1880, lorsque le syndicalisme jette les bases de son organisation future “trois courants politiques à l’orientation distincte structurent le mouvement ouvrier jusqu’en 1914, l’histoire de la C.G.T. est très largement tributaire de leur existence et des luttes qui se déroulent entre eux”[31], à savoir les réformistes, les guesdistes et les anarchistes. De cette confrontation résultera l’alliance entre le courant réformiste et les révolutionnaires, concrétisée dans la Charte d’Amiens en 1906[32]. En effet, “fusionnant des apports allemanistes, blanquistes et anarchistes en réaction au guesdisme, le syndicalisme révolutionnaire s’est présenté progressivement comme la doctrine d’un syndicalisme indépendant. Sa doctrine a prétendu à l’universalité, ne proposant pas seulement une méthode d’action, mais une vision du monde qui s’appliquait à tous les domaines de la vie, le travail bien sûr, mais aussi l’éducation avec Albert Thierry, la culture avec Alfred Rossmer”[33].
Soulignons que le rôle assigné à la formation et à l’éducation par les militants du syndicalisme d’action directe est conforme au double objectif qu’il se propose d’atteindre, à savoir l’amélioration immédiate des conditions matérielles et morales de la classe ouvrière et l’émancipation totale, à terme, de celle-ci. Ainsi, la formation oeuvrera sur un double registre, comme tous les autres ressorts du syndicalisme révolutionnaire, celui des intérêts immédiats et futurs du prolétariat. Dans cette stratégie de transformation sociale radicale, l’éducation est une préoccupation majeure et un des leviers essentiels de la Révolution au même titre que la grève générale et l’antimilitarisme. L’éducation a dès lors une double mission, celle de développer, non seulement, la formation générale et professionnelle dont dépend pour une part le salaire, la reconnaissance de la qualification et la dignité au travail, mais aussi la formation du plus grand nombre afin de préparer chacun des acteurs aux tâches d’organisation, de production, de gestion et de distribution nécessaire à la bonne marche de la société fédéraliste à venir. Le syndicalisme révolutionnaire s’inscrit donc dans un large courant éducationniste qui fait de l’éducation, un moteur du progrès collectif.
Précisons encore que pour les syndicalistes révolutionnaires, l’éducation concerne l’ensemble du mouvement syndical et qu’il n’est aucunement question de distinguer pour eux la formation de la masse et la formation des militants, fussent-ils membres de la minorité active qui anime le jeune syndicalisme. Dans cette force octroyée en l’éducation chacun doit oeuvrer à sa propre éducation, en “amant passionné de la culture de soi-même”[34], et à l’éducation de tous, car l’éducation est un outil de prise de conscience et un garant afin de rendre “viable une société d’hommes fiers et libres”[35]. Ce n’est qu’ultérieurement, après la bolchévisation de la C.G.T. dans les années vingt, qu’une inflexion décisive est à noter et que l’accent portera plus sur la formation d’une avant-garde autosuffisante que sur celle de l’ensemble du collectif syndical. Il faudra d’ailleurs, même pour cette même avant-garde et malgré l’intervention de Ludovic Zoretti qui rappelle au congrès confédéral de 1925 les positions de Fernand Pelloutier, attendre 1932 pour que soit crée à Paris, l’Institut Supérieur Ouvrier (ISO)[36].
Fernand Pelloutier et les Bourses du Travail
Comment mieux définir la place de l’éducation dans la stratégie révolutionnaire du syndicalisme que cette phrase de Pelloutier : “instruire pour révolter”[37] ? Il va de soi que l’éducation ira au-delà de la prise de conscience et de la première manifestation de révolte. Elle sera, à la fois par les clés de compréhension du réel qu’elle offre, l’aiguillon permanent de la révolte, et par les capacités de pensée et d’action qu’elle octroie, l’un des outils privilégiés de la transformation sociale.
La place que la formation, manuelle et intellectuelle, professionnelle ou générale, occupe tant dans l’oeuvre de Fernand Pelloutier que dans l’activité des Bourses du Travail en apporte aisément la preuve. En cela, elle est aussi en lien direct avec la pédagogie intégrale héritée de Fourier et Proudhon et les préoccupations éducationnistes de la Première Internationale.
Ainsi, comme l’écrit Pelloutier lui-même, la préoccupation de l’éducation est ancienne dans le mouvement ouvrier et “ce n’est pas d’hier que l’organisation d’un enseignement professionnel hante les groupements corporatifs. Sans remonter au-delà de 1872, nous constatons que c’était le but fondateur du cercle de l’Union syndicale ouvrière et que tous les syndicats de l’époque avaient souscrit d’enthousiasme à ce projet. Si nous nous reportons aux débuts, dit le Rapport de la délégation des ouvriers marbriers de Paris à l’Exposition universelle de Lyon (1872), nous voyons que, dans le principe, une école centrale de dessin professionnel avait été jugée nécessaire par un groupe de travailleurs. D’autres cours, se rattachant aux connaissances utiles à toutes les professions, devaient, selon les ressources des cercles, y être adjoints par la suite”[38].
S’ils ne sont pas précurseurs, les militants des Bourses du Travail s’interrogent très tôt sur les enjeux de la formation. En effet, dès 1898, sont évoqués les dangers que la formation ferait courir aux intérêts du Travail en oeuvrant à la production d’une “pépinière de contremaîtres et de surveillants” mais rapidement, après observations, ils concluent au Congrès de Rennes en 1898 “que loin de nuire aux efforts faits par la classe ouvrière pour l’affranchissement collectif et simultané des travailleurs, l’enseignement professionnel créé par les Bourses produit matériellement et moralement des résultats heureux”[39]. Cette crainte dépassée, une dynamique éducative forte est lancée au sein du mouvement des Bourses et leur VIIIème congrès (Paris 1900) prit la décision qu’elles devraient “immédiatement faire le nécessaire pour créer des cours populaires où, sous forme de lecture, seront commentés les écrits de tous les penseurs qui honorent l’humanité”[40]. Ce même congrès invite donc les Bourses “à faire tous leurs efforts pour compléter l’enseignement technique par l’enseignement primaire (général) au sens ou l’enseignement professionnel apparaît comme réducteur et insuffisant, et par la même, comme “un danger pour la pleine émancipation de l’ouvrier[41]”
Au-delà de cet éclectisme, les syndicalistes révolutionnaires ne limitent pas leurs propos à la seule formation des adultes, l’éducation revêt trop d’enjeux de “reproduction” pour la laisser aux mains de la République ou des cléricaux. En 1910, la IVéme conférence des Bourses incite à la création “d’Ecoles syndicales et de Garderies d’enfants (…) permettant d’éduquer la jeunesse prolétarienne dans un but syndicaliste et antimilitariste”[42]. Il ne s’agit pas de conformer la jeunesse aux valeurs du syndicalisme, ceci irait à l’encontre du projet émancipateur des Bourses, mais de protéger la Classe d’une éducation exogène, et pour une part d’entre les militants – des divergences existent à ce sujet – de permettre au mouvement syndical de s’autonomiser par rapport à l’Ecole de Jules Ferry dont ils se défient. En effet, à la suite de Pierre-Joseph Proudhon, ils estiment que l’école participe de “la tendance dominante dans l’industrie moderne à faire de l’enfant un manoeuvre, un accessoire de la machine, au lieu d’en faire un collaborateur intelligent”[43]. Mais le projet d’une éducation autonome des syndicalistes révolutionnaires ne s’arrête pas là et, écrit Pelloutier, “le haut degré atteint par l’enseignement que donnent les Bourses du Travail nous a suggéré le désir de l’élever encore et (…) d’annexer à chaque Bourse une école tenant le milieu entre l’école primaire et la section d’enseignement “moderne” ou “spéciale” des collèges”[44].
Le projet éducatif des Bourses dépasse de loin le seul enseignement professionnel, il est une éducation intégrale, à tous les niveaux. Il participe d’un processus co-fondateur de l’homme et de la société futurs. Ainsi, les Bourses “remplissent deux fonctions essentielles. Tout d’abord, elles organisent le soutien aux salariés, s’efforcent de leur trouver du travail, de les aider à se qualifier sur le plan professionnel et à s’épanouir sur le plan culturel. Par ailleurs, elles jouent un rôle de résistance à la répression, d’aide aux grévistes et de propagande révolutionnaire”[45].
Ainsi les Bourses sont dès leur origine conçues comme de véritables lieux d’éducation ouvrière. Le fait éducatif n’est pas un fait marginal ou une réalisation de hasard. Il est inscrit dans l’organisation des Bourses au même titre que le placement, “le secours de chômage”, le “viaticum”. La moitié d’entre elles environ mirent en place un “service de l’enseignement qui comprend la bibliothèque et l’office de renseignement, le musée social, les cours professionnels, les cours d’enseignement général”[46].
Soulignons enfin que le souhait d’éducation ouvrière du syndicalisme révolutionnaire ne se confine pas au seul “enseignement professionnel, théorique et pratique (…mais) aux connaissances les plus diverses”[47] et que certaines Bourses organisent des bals, des concerts et des représentations théâtrales, ainsi que les premiers loisirs ouvriers[48]. Comme le remarque Noël Terrot, le rôle des Bourses ne se limite pas “à la formation individuelle des adultes, elles doivent fournir aussi à l’organisation ouvrière les moyens d’une analyse globale de la société dont elles doivent constituer, plus tard, l’organisation de base”[49]. Elles ont pour finalité et fonction de devenir des centres d’élaboration d’idées, des laboratoires révolutionnaires, “les universités de l’ouvrier”[50] au point qu’un observateur avisé, professeur d’économie politique de surcroît, déclarait en 1913 que : “les Bourses du Travail sont des institutions de la plus haute importance, des centres vivants et féconds de la pensée syndicale ; là s’élabore la prochaine révolution. C’est là, et non pas dans les assemblées du parti socialiste parlementaire, qu’il faut étudier le mouvement révolutionnaire”[51].
Quant à Fernand Pelloutier qui fut l’inspirateur du mouvement des Bourses du Travail, il lie en permanence l’action du syndicalisme et l’action éducatrice[52]. Il s’agit du binôme indissociable car il ne conçoit ni le syndicalisme, ni l’émancipation sans éducation. En d’autres termes, une révolution sociale sans culture individuelle et sociale serait, soit vouée à l’échec, soit livrée à la dictature de quelques “savants”. C’est pourquoi, “il a toujours insisté beaucoup sur la formation nécessaire aux militants, sur le rôle irremplaçable de l’éducation et refusé pour eux une culture de seconde zone”[53]. L’éducation fait partie comme la grève, selon le mot de Georges Yvetot de la “gymnastique révolutionnaire” car le projet syndicaliste “pour la défense des intérêts collectifs et le succès de la guerre sociale (se doit d’organiser) l’union des ouvriers de tous les métiers, s’exerçant la main dans les escarmouches quotidiennes, puisant la vigueur morale dans les trésors des connaissances humaines, menant de front l’exercice du muscle et la gymnastique du cerveau”[54]. Aux yeux de Pelloutier, l’éducation affûte l’ouvrier et le prépare à la lutte de classe. Il la considère comme un moyen privilégié d’émancipation sociale, non pas seulement dans une logique narcissique d’un culte de soi même mal compris, mais dans la logique d’un humanisme libertaire dans lequel il se reconnaît, et avec lui de nombreux autres syndicalistes d’action directe. Humanisme qui tend à développer l’individu dans toutes ses dimensions, professionnelle, artistique et gestionnaire de la société à construire. C’est en ce sens qu’il écrivait : “au reste en matière d’enseignement toute hardiesse est légitime. Les cours institués par les Bourses du Travail n’ont pas seulement pour effet de faire de “bons ouvriers” ; ils ont (…) pour avantage d’élever le coeur de ceux qui les suivent. “Car[55] ils se rendent compte combien sont difficiles les commencements de tout travail, combien sont importantes ces heures d’étude qui les aguerrissent en vue de la lutte de l’intelligence contre la matière brute ; l’homme qui sait ce qu’il vaut se respecte davantage… et à mesure qu’il prend conscience de sa valeur, il ennoblit le travail au lieu de l’avilir… Plus nous aurons de connaissance (…) sur tout ce qui rapporte aux manifestations de la vie sociale, plus nous aurons de force de résistance et d’attaque à opposer à nos oppresseurs… et je crois qu’en nous instruisant le plus possible, nous nous approcherons toujours de l’idéal vers lequel nous marchons et qui est l’affranchissement complet de l’individu”[56].
En d’autres termes, le projet éducationniste du syndicalisme révolutionnaire appartient à sa dynamique propre. L’éducation et la formation sont une pièce maîtresse et une cheville ouvrière indissociable du mouvement menant à l’émancipation. Ainsi, syndicalisme et éducation se conjuguent et se renforcent dans une dialectique de l’action tendue vers l’avenir et articulée sur les réalités présentes. Jacques Juillard avait de ce point de vue bien apprécié la nature du projet éducatif du syndicalisme d’action directe qui s’inscrit directement dans la continuité de l’Association Internationale des Travailleurs (A.I.T.) de 1864 et de sa devise : L’émancipation des travailleurs sera l’oeuvre des travailleurs eux-mêmes. Pour Juillard : “si la seule émancipation de la classe ouvrière est une auto-émancipation, à plus forte raison, l’éducation de la classe ouvrière ne peut-elle être qu’une auto-éducation”[57]. En bref, l’éducation comme le pouvoir ne se délègue pas.
Emile Pouget, Georges Yvetot, Léon Jouhaux[58] et les autres
Je ne pouvais pas évoquer la place de l’éducation et de la formation, comme l’une des composantes originelles du syndicalisme révolutionnaire, sans faire référence à quelques autres grandes figures qui lui permirent, durant un temps, d’organiser en son sein la plus majeure partie du prolétariat radical. En effet, ce souci éducatif n’est pas une position isolée, d’ailleurs, il perdurera longtemps encore après la mort de Fernand Pelloutier et la fusion entre les Bourses du Travail et la C.G.T. au Congrès de Montpellier en 1902. Tous les auteurs-acteurs confirment ou reprennent ce que Les Bourses et Pelloutier préconisaient déjà.
Emile Pouget, secrétaire général adjoint de la C.G.T. et talentueux animateur du Père peinard considère lui aussi que l’émancipation sociale du mouvement ouvrier est étroitement liée à sa formation. Pour lui, “la besogne du syndicat qui prime sur toutes les autres et qui lui donne son véritable caractère de combat social est une besogne de lutte de classe ; elle est de résistance et d’éducation”[59]. Point d’ambiguïté, la lutte de classe est aussi éducation. C’est pourquoi, outre la défense des intérêts immédiats du prolétariat, le syndicat “a le souci de ne pas négliger l’oeuvre éducatrice qui consiste à préparer la mentalité des travailleurs à une transformation sociale éliminant le patronat”[60].
Dans l’ouvrage de syndicalisme fiction qu’il rédige en 1909 avec un autre militant responsable de la C.G.T., Emile Pataud, Pouget consacre un chapitre entier à la place et au rôle de l’éducation dans la société post-révolutionnaire. La société qui y est décrite, est réorganisée, conformément au projet syndicaliste révolutionnaire – à partir des syndicats qui en deviennent les cellules de base – qui assigne à l’éducation de “faire des hommes ! Harmoniquement développés, – physiquement, intellectuellement, moralement, – et, par cela même, aptes à porter leur activité au maximum, dans la direction de leur choix”[61]. Dans cette société d’ailleurs l’éducation ne s’arrête pas au sortir de l’école ou de l’atelier en effet, “la meilleure des instructions (consiste) à donner à l’enfant des notions solides, exactes, et surtout à lui inculquer si fortement le goût du savoir que cette passion l’étreigne toute sa vie”[62].
Ainsi l’on retrouve comme une constante, dans le projet éducatif du syndicalisme, au-delà de l’exigence qualitative des savoirs, à la fois l’harmonie fouriériste, l’éducation intégrale et la trace de Condorcet.
Victor Méric, dans la défense critique qu’il fait de l’ouvrage d’anticipation sociale Comment nous ferons la Révolution rédigé par les deux militants de la C.G.T., s’associe aux auteurs et évoque le rôle accompagnateur de l’éducation, ainsi écrit-il : “certes avec le temps la Révolution sociale fera son oeuvre, l’éducation aidant”[63]. Chez Pouget et Pataud qui y consacrent un chapitre et pour Méric la formation prend une nouvelle dimension. Elle dépasse le rôle de simple levier de préparation de la transformation sociale pour devenir un outil permanent d’accompagnement du changement révolutionnaire.
Sans oser conclure que le souci éducationniste est partagé par tous les syndicalistes d’action directe, la lecture des nombreuses brochures qu’ils rédigèrent permet d’affirmer que la formation et l’éducation occupent une place centrale dans la stratégie révolutionnaire du syndicalisme. Pour en citer quelques-uns, Georges Yvetot s’inscrivant dans la trace de Fernand Pelloutier et de son souhait d’un individu fier et libre, écrit : “la transformation sociale n’étant que la somme des transformations individuelles, nous pouvons conclure que l’éducation individuelle et collective faite dans certains syndicats ouvriers y contribuera énormément”[64]. Paul Delesalle qui assumera lui aussi des responsabilités importantes à la C.G.T. considère que le syndicalisme se doit d’oeuvrer à “l’éducation morale des travailleurs”[65], qu’il faut entendre comme une élévation morale et culturelle des individus dans et par le syndicalisme. Comme le confirme un observateur de l’époque, Auguste Pawlowski : “le syndicalisme confédéral se regarde non seulement comme rénovateur, mais encore comme moralisateur et éducateur”[66].
Pour Léon Jouhaux lui-même – futur secrétaire général de la C.G.T., syndicaliste révolutionnaire dans sa première période – : “le rôle de coordination, d’éducation, de relèvement moral de la classe ouvrière, en même temps que de défense des intérêts généraux (…) est présentement la tâche de la CGT”[67] et “les Bourses du Travail (…) constituent les centres de raisonnement de l’activité confédérale”[68]. Si les liens entre éducation, organisation et émancipation sociale sont étroits et sans cesse réaffirmés, rien n’interdit, soulignons-le, au syndicalisme – qu’il ne faut pas confondre avec un moralisme – d’organiser des soirées récréatives voire des représentations théâtrales. Il se veut éclectique et ouvert à toutes activités culturelles. Les Bourses, souvent associées aux Universités Populaires, peuvent dès lors apparaître, toutes proportions gardées, comme une forme anticipatrice des maisons de la culture. Ainsi donc, “l’union locale organise des fêtes, des conférences dans le local commun, s’il trouve une grande salle, et installe les cours professionnels des différentes corporations”[69].
Mais le projet du syndicalisme en matière d’éducation, nous l’avons évoqué, ne se limite pas à la formation des seuls travailleurs. Léon Clément, militant moins connu, dans un texte sans doute inspiré de l’expérience d’école libertaire menée par Sébastien Faure, connue sous le nom de la Ruche, défend l’idée d’une école moderne dans chaque centre ouvrier sous le patronage des syndicats révolutionnaires[70]. Dans cette brochure, après avoir constaté qu’il y a de grandes difficultés à former les adultes après une journée épuisante de travail, l’auteur affirme que le syndicalisme est un lieu privilégié pour l’éducation initiale et professionnelle des enfants et des adolescents dans un esprit d’objectivité, dans le cadre d’une démarche rationaliste et, contre les prétentions catéchisantes de l’école de la République. Partant du principe que “l’individu le moins instruit (…) prend de plus en plus conscience que son émancipation est subordonnée à son développement moral et intellectuel”[71], “quel groupement mieux que le syndicat peut aider à cette besogne”[72] ? L’éducation est au coeur du projet syndicaliste révolutionnaire. Elle l’est à tel point qu’elle est sans doute l’une des origines des pédagogies actives qui se proposent de mettre l’apprenant au centre de ses apprentissages ou, en d’autres termes, comme le souligne Maurice Dommanget à propos d’un instituteur syndicaliste révolutionnaire, Albert Thierry, d’appliquer les principes du syndicalisme à l’éducation et en particulier celui de “l’action directe en pédagogie”[73]. Les liens qui unirent d’ailleurs, Sébastien Faure, Paul Robin, Francisco Ferrer et plus tard Célestin Freinet au syndicalisme et au mouvement ouvrier militent en ce sens.
La prégnance du courant éducationniste dans le syndicalisme révolutionnaire, souvent animé par des militants issus du mouvement anarchiste, ne se limite pas à ce dernier et se diffusa très largement dans la première C.G.T.. Le leader du courant dit réformiste de la Confédération, Auguste Keufer, n’est pas loin de partager le point de vue des militants évoqués plus haut, même s’il le nuance. En effet, le secrétaire général de la fédération des travailleurs du livre, – auteur d’une brochure intitulée L’éducation syndicale – s’il demeure critique quant à la capacité du syndicalisme à l’auto-suffisance en matière d’éducation, considère néanmoins – non pas par souci “d’éviter tout ce qui divise” qui était sa ligne de conduite – “que sur ce point spécial et précis, on peut dire qu’il y a accord complet” et qu’il convient de “refaire l’éducation de la masse aussi bien que celle des autres classes”[74] . Pour lui aussi, le syndicalisme a bien une mission “d’éducation professionnelle et sociale”[75] et “la vie syndicale doit stimuler l’étude, préparer le syndiqué au point de vue technique et philosophique, le familiariser avec toutes les questions qui concernent son métier et les autres corporations, ou comme citoyen préoccupé du problème social”[76]. Au demeurant et au-delà de ce propos général, les représentants des deux courants, comme le souligne Noël Terrot, “Keufer du syndicat du livre et Delesalle secrétaire adjoint de la C.G.T. traduisent bien dans leurs réponses l’attachement dominant des syndicalistes pour la formation effectuée sur le lieu de travail”[77]. A la fois parce que cela permet de transmettre en situation les savoirs de métiers aux travailleurs par les travailleurs eux-mêmes, mais aussi parce que cela facilite et rend possible le contrôle syndical, tant sur le contenu de la formation que sur les modes de socialisation à l’ouvrage.
Les Universités Populaires que nous avons déjà évoquées s’inscrivent, elles aussi dans cette dynamique et en complémentarité de l’activité syndicale. En effet, ces universités, largement influencées, à en croire Noël Terrot par les anarcho-syndicalistes, “cherchent à affranchir moralement (le travailleur) en le débarrassant de tous les dogmes et préjugés qui obscurcissent encore son cerveau”[78]. Ainsi, “le soutien à l’Université populaire témoigne d’une grande confiance dans la culture perçue comme un pouvoir pour ceux qui la détiennent et comme un outil d’émancipation. Oeuvre d’éducation, l’Université populaire ne pouvait que satisfaire les exigences qui courent dans tout le mouvement ouvrier (…). Les socialistes de toutes tendances – à l’exception des guesdistes – les syndicalistes des Bourses du Travail ou de la C.G.T., les anarchistes et les coopérateurs font de l’Université populaire une revendication ouvrière”[79].
Au-delà de l’éducation pour tous et par tous que se propose de réaliser le syndicalisme révolutionnaire se jouent deux conceptions du monde et de la société comme le montre Bernard Charlot et Madeleine Figeat. En effet “pour le patronat, écrivent-ils (et pour la République, serions-nous tenté de rajouter) l’ouvrier bien formé est l’ouvrier obéissant dont la compétence est exactement adaptée aux besoins de l’époque. Pour les syndicats ouvriers qui ouvrent des cours professionnels, l’ouvrier bien formé (dans une conception très proudhonienne) est celui qui, en contradiction avec le travail divisé et mécanisé de l’époque, domine un métier complet par son habilité manuelle et ses connaissances pratiques. Il y a là deux conceptions opposées de la formation qui n’expriment pas un simple désaccord pédagogique mais reflètent la lutte de classes au sein de la formation professionnelle”[80].
Pour conclure, ce chapitre consacré aux fondateurs et animateurs du syndicalisme d’action directe, il convient de souligner l’intérêt du projet syndicaliste. Comme le remarque justement Jacques Juillard “réduit à sa visée essentielle, (le syndicalisme) fut l’effort le plus systématique mené à l’intérieur du mouvement ouvrier français, et même européen, pour résister à la tentative d’intégration politique dont la classe ouvrière était l’objet de la part de la bourgeoisie républicaine et pour ériger (un) pouvoir autonome”[81]. La grève générale, levier ultime de l’émancipation sociale, arme absolue contre le capital et l’exploitation n’est que la phase ultime d’un long processus éducatif auto-contrôlé et auto-organisé par le prolétariat révolutionnaire. Elle n’est rien d’autre que l’aboutissement de l’éducation de tous et par tous, une mise en acte du projet syndicaliste préparé de longue date. Hubert Lagardelle avait, en son temps, bien compris la valeur éducative de grève générale qui doit être comprise comme un mythe mobilisateur, une utopie réaliste, où les nouveaux savoirs sociaux pourront être mis en oeuvre en vraie grandeur. En ce sens la grève générale révolutionnaire est à la fois l’examen final d’une longue éducation et la confrontation des savoirs ouvriers à la gestion du monde.
Lagardelle est en cela un analyste avisé, ce qui le conduit à dénoncer ceux qui font un procès d’intention au principe de la grève générale et à rappeler que, contrairement à des suppositions erronées, les syndicalistes dans le cadre d’un pragmatisme révolutionnaire qui les guide s’appuient sur des données et des actes concrets dont l’éducation est un des éléments. En cela, il rappelle que le projet syndicaliste ne relève ni d’un artefact ni d’une pensée magique à finalité édénique. Pour lui, “les syndicats savent bien que la grève générale est dans le lointain, qu’elle n’éclatera qu’à l’heure où la classe ouvrière, longuement éduquée, patiemment organisée, sera capable de la déclarer, et par cette idée symbolique perd tout son caractère utopique pour apparaître ce qu’elle est : l’idée la plus profondément réaliste que puisse concevoir le prolétariat militant. Et quelle valeur d’éducation, plus d’espoir en je ne sais quelle intervention extérieure au monde ouvrier, en je ne sais quelle providence qui viendrait tout à coup substituer son effort à l’effort même de la classe ouvrière ! Mais au contraire une foi exclusive en l’énergie seule des prolétariens (sic), en leur esprit de lutte, en leur action créatrice, si bien que la grève générale ne peut plus être conçue que comme la conclusion naturelle d’une longue série d’actes préparatoires, comme l’effort ultime d’une classe à la pleine possession d’elle-même, comme la généralisation de tout un ensemble d’institutions nouvelles et partiellement réalisées”[82]. Il s’agit bien là, de la scène finale du grand drame prolétarien, du point d’orgue de la gymnastique révolutionnaire. Mais il n’y a ici ni hasard, ni désordre, il n’y qu’accomplissement d’un processus éducatif qui ne vise qu’à redonner à chacun sa “plénitude d’humanité”[83].
LES HÉRITIERS
Après avoir évoqué la place et la mission que les précurseurs, puis les fondateurs du syndicalisme révolutionnaire assignaient à l’éducation et à la formation, voyons si, les héritiers des Bourses du Travail lui octroyèrent un rôle aussi déterminant dans l’oeuvre d’émancipation sociale.
Suite à la première guerre mondiale s’estompe le projet d’une éducation globale de la classe ouvrière. Il s’agit sans doute d’une conséquence de la domination léniniste sur le mouvement ouvrier où trop souvent éducation rime avec ré-éducation et orthopédie de la pensée. Au-delà, la volonté d’éduquer vise davantage à former l’avant-garde plutôt que la masse ouvrière. C’est, comme le souligne Noël Terrot, à “un besoin différent auquel répond dans les années vingt l’apparition de structures d’éducation ouvrière (…). Pour la CGT, il s’agit de mieux armer les militants syndicaux en les aidant à acquérir les méthodes et les connaissances qui leur sont nécessaires dans leur action quotidienne. A l’opposé des initiatives antérieures d’éducation ouvrière, ces formations sont totalement contrôlées par le syndicat (…) et s’adressent principalement à des futurs militants”[84]. Même dans cette optique, rappelons que l’Institut Supérieur Ouvrier (ISO) ne sera d’ailleurs crée par la C.G.T. à Paris qu’en 1932 et après les deux scissions successives de la CGT en 1921 et 1926.
Malgré la bolchévisation du syndicalisme, le courant révolutionnaire affaibli maintiendra ses positions sur l’éducation. Il réaffirme et adopte dans la Charte de Lyon au congrès constitutif de la C.G.T.- S.R. (syndicaliste révolutionnaire) qui se déroule les 1er et 2 novembre 1926 que “le syndicalisme dans la période pré-révolutionaire (…) sera menée à bien la besogne de documentation, d’éducation technique et professionnelle en vue de la réorganisation sociale, (et) sera réalisé dans les meilleures conditions l’apprentissage de classe à la gestion”[85]. Il s’agit donc bien encore de former l’ensemble de la Classe à la gestion et à l’organisation de la société future. Cette déclaration en matière de formation sera reprise in extenso en 1946 dans la Charte de Paris, lorsque fut créée, à la suite de la C.G.T.-S.R. autodissoute en 1939, la Confédération Nationale du Travail (C.N.T.)[86].
Pierre Besnard, animateur de la C.G.T.-S.R. réaffirme la filiation éducationniste et l’importance des enjeux pour les révolutionnaires de la formation, tant en matière de préparation que de réalisation d’un Monde nouveau[87]. Cette continuité de pensée est si forte et si constante que, dans son ouvrage majeur Les syndicats ouvriers et la Révolution sociale publié en 1930, Pierre Besnard écrit dans le chapitre qu’il consacre, dans la tradition, à l’éducation : “j’ai lu et relu les quelques pages que James Guillaume consacre à cette question. Je ne vois rien à y ajouter. Je me borne donc à les retranscrire. Ecrites en 1876, elles restent d’aujourd’hui”[88]. En cela, il s’inscrit sans ambiguïté dans la lignée de la Première Internationale (AIT), de Proudhon et de l’éducation intégrale. Pour Pierre Besnard et le courant anarcho-syndicaliste qu’il représente, l’éducation est une des clefs de voûte de l’édification révolutionnaire que les syndicalistes doivent considérer comme prioritaire. En effet, il affirme que par l’éducation “se trouvera résolu un des plus grands problèmes vitaux pour la révolution : celui qui consiste à former les générations qui auront la charge d’assurer la vie du nouveau régime social, de stabiliser au plus haut point la révolution, de rendre possible un nouveau bond en avant”[89].
Pour les syndicalistes révolutionnaires, écrit toujours Pierre Besnard, “le problème que nous avons à résoudre est donc, toujours et comme tous les autres, d’abord un problème d’éducation, de formation syndicaliste”[90] et d’ajouter “si le syndicat sait faire oeuvre de prospection et de formation, avec toute la patience, en même temps que toute la célérité que nous imposent les événements, il sera capable de faire face à sa tâche”[91].
Cette continuité de la pensée et du projet syndicaliste révolutionnaire et la contribution attendue de la formation et de l’éducation persiste au cours du temps et au travers des générations de militants. L’Espagne révolutionnaire, largement influencée par les anarcho-syndicaliste de la C.N.T., en sera ma dernière illustration. Le congrès de Saragosse réuni en mai 1936 et dont on connaît l’importance réaffirme, à quelques semaines des premières collectivisations, que “le problème de l’enseignement devra être abordé avec des procédés radicaux. En premier lieu, l’analphabétisme devra être combattu énergiquement. On restituera la culture à ceux qui en furent dépossédés (…). L’enseignement en tant que mission pédagogique visant à éduquer une humanité nouvelle, sera libre, scientifique et identique pour les deux sexes”[92].
ÉDUCATION ET RÉVOLUTION
Chez ses précurseurs comme chez ses héritiers en passant par ceux qui lui donnèrent forme, l’éducation apparaît comme un invariant du syndicalisme d’action directe. De Pierre-Joseph Proudhon à Fernand Pelloutier et à Pierre Besnard, l’éducation est un souci permanent tant sur le plan théorique que sur le plan des pratiques. En cela, ils s’inscrivent et inscrivent le syndicalisme dans la tradition éducationniste révolutionnaire.
Nous pensons avoir démontré, en effet, que l’éducation et la formation ont un statut d’outils indispensables, au même titre que la grève générale, à la réalisation d’une société juste et égalitaire tant sur le plan politique qu’économique pour laquelle oeuvre le syndicalisme révolutionnaire. Elles ne sont donc pas un hasard lié aux luttes et aux nécessités du moment mais un invariant indispensable au projet syndical. Cette traçabilité d’une nécessaire formation de masse, constante préoccupation durant un siècle (1848-1946) s’estompa ou prit d’autres formes dans les autres courants du syndicalisme. Néanmoins, il semble que pour les syndicalistes révolutionnaires l’accès à la culture, au sens le plus large et pour le plus grand nombre, soit une revendication politique de premier ordre qui le distingue de ceux qui ultérieurement favoriseront la formation des cadres et des dirigeants d’une classe ouvrière jugée à jamais incapable de s’autodiriger. Comme le soulignait déjà Marc Pierrot dans sa petite brochure militante intitulée Syndicalisme et révolution, “c’est à l’éducation de cette masse ouvrière encore hésitante que la confédération travaille sans relâche”[93] car comme beaucoup d’autres, avant et après eux, ils avaient bien compris l’enjeu éducatif, et, plus d’un aurait pu faire sienne la célèbre phrase d’Emmanuel Kant : “donnez-moi l’éducation, et je changerai la face de l’Europe avant un siècle”[94].
Au-delà et pour conclure sur un point d’actualité, notons que les syndicalistes révolutionnaires ne limitent pas l’acquisition des savoirs et des savoir-faire à la seule éducation formelle. L’expression “gymnastique révolutionnaire” utilisé par Yvetot pour désigner la grève, qui est une gymnastique de l’esprit et de l’action, en est une première approche. Ils auraient déjà eu, en quelque sorte, l’intuition de la valeur des savoirs d’action et de la place de la formation expérientielle dans la construction identitaire des individus et des organisations dont on parle aujourd’hui. Marc Pierrot, même s’il verse quelquefois dans une spontanéité éducative un peu idéaliste, témoigne très clairement de cette capacité formatrice de l’activité. “Leur révolte, écrit-il à propos des mineurs de la Rhur, a fait leur éducation complète”[95] et d’ajouter “l’action est en effet, le meilleur moyen d’éducation du prolétariat, elle fait l’éducation des sentiments et l’éducation des idées. Elle exalte le courage et le sentiment de dignité individuelle, elle réveille les énergies. Elle assure le développement moral et intellectuel des individus”[96]. En bref, elle en fait des “hommes fiers et libres”. Mais cette action éducative ne se déroule pas sans cadre de référence, elle s’exerce dans l’espace syndical qui apparaît dès lors comme le lieu privilégié de la socialisation révolutionnaire. Pierrot le confirme encore : “le syndicat est la véritable école où se fait l’éducation intellectuelle des travailleurs (…). Et c’est encore l’action, provoquée par le syndicat, qui est le principal facteur de cette éducation”[97]. Même s’il s’agit d’une foi encore naïve dans les vertus éducatives de l’action, il n’en demeure pas moins que cette dimension de la formation sur le “tas” des syndicalistes est encore largement vraie aujourd’hui.
Enfin, réaffirmons, les textes nous y autorisent, que le projet syndicaliste révolutionnaire est largement un projet qui repose sur l’éducation. Et que, pour parvenir à leur fin, les syndicalistes révolutionnaires se proposent d’user, sans exclusive de tous les registres éducatifs, pour y parvenir : la propagande, la formation générale et professionnelle, la culture et l’action. Et que pour eux, il s’agit bien d’éduquer pour émanciper.
Hugues LENOIR
CEP Paris X
BIBLIOGRAPHIE
Syndicalistes et militants
Besnard P., Le monde nouveau, Paris, Volonté anarchiste (hors série), s.d.
Besnard P., Les syndicats ouvriers et la révolution sociale, Carrare, Editions du Monde Nouveau, 1978.
Clément L., L’éducation de l’enfant : idée d’une école modèle dans chaque centre ouvrier sous le patronage des syndicats révolutionnaires, Paris, Temps nouveaux, s.d.
Delesalle P., L’action syndicale et les anarchistes, Paris, Temps Nouveaux, 1901.
Delesalle P., La Confédération Générale du Travail, Paris, La Publication sociale, 1907.
Delesalle P., Les deux méthodes du syndicalisme, Paris, La Publication sociale, s.d.
Guillaume J., L’Internationale, Genève, Editions Grounauer, 1980 pour le vol.1, Editions Gérard Lebovci, 1985 pour le vol. 2.
Griffuelhes V., Le syndicalisme révolutionnaire, supplément à Espoir n° 766, Toulouse, éditions CNT-AIT s.d.
Griffuelhes V., L’action syndicaliste, Paris, Les Editions syndicalistes, s. d.
Jouhaux L., L’action syndicaliste, La Publication sociale, 1912.
Jouhaux L., Notre syndicalisme, Paris, La publication sociale, 1912.
Jouhaux L. Le syndicalisme et la C.G.T., Paris, Editions de la Sirène, 1920.
Keufer A., L’éducation syndicale, Paris, Imprimerie nouvelle, 1910.
Lorulot A., Yvetot G., Le syndicalisme et la transformation sociale, Paris, Librairie internationaliste, 1909.
Méric V., Comment on fera la Révolution ? Paris, Les Hommes du jour, s. d.
Monatte P., La lutte syndicale, Paris, Ed. Maspéro, 1976.
Niel L., La valeur sociale du syndicalisme, Paris, La Publication sociale, 1909.
Pataud E., Pouget E Comment nous ferons la Révolution, Paris, Editions Syllepse, 1995.
Pelloutier F., Histoire des bourses du travail, Paris, Gordon et Breach, 1971.
Pelloutier Fernand., Les syndicats en France, Paris, Librairie ouvrière, 1897.
Pierrot M., Syndicalisme et Révolution, Paris, Temps Nouveaux, 1905.
Proudhon P.-J., De la capacité politique des classes ouvrières, Paris, Les Editions du Monde Libertaire, 1977, 2 tomes.
Pouget E., Les bases du syndicalisme, Paris, Bibliothèque syndicaliste, s.d.
Pouget E., La confédération générale du travail, suivi de Le parti du travail, Paris, Editions CNT, 1997.
Tristan F., Le Tour de France, Editions Tête de Feuilles, 1973.
Yvetot G., A. B. C. Syndicaliste, suppl à Espoir-CNT, n° 826, s.d.
Yvetot G., Le syndicalisme, les intellectuels et la C.G.T., Paris La Publication sociale, s.d.
Etudes et histoires sur le syndicalisme et le mouvement ouvrier
Bron J., Histoire du mouvement ouvrier français, Paris, Les Editions ouvrières, 1968,
3 tomes.
Cazalis Emile, Syndicalisme ouvrier et évolution sociale, Paris, Marcel Rivière, 1925.
Dreyfus M., Histoire de la CGT, Bruxelles, Ed Complexe, 1995.
Dolléans E., Histoire du mouvement ouvrier, Paris, A. Colin, 1957, 3 tomes.
Dufour (?), Le syndicalisme et la prochaine Révolution, Paris, M. Rivière, 1913.
Guérin D., Ni Dieu ni Maître, Anthologie de l’anarchisme, Paris, Maspéro, 1976, 4 tomes.
Juillard J., Autonomie ouvrière, études sur le syndicalisme d’action directe, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1988.
Juillard J., Fernand Pelloutier et les origines du syndicalisme d’action directe, Paris, Editions du Seuil, 1971.
Lefranc G., Histoire du mouvement syndical français, Paris, Librairie syndicale, 1937.
Leroy M., La coutume ouvrière, Paris, Giard et Brière, 1913, 2 tomes.
Louis P., Histoire du mouvement syndical en France, Paris, Librairie Valois, 1947 (t.1), 1948 (t. 2).
Maitron J., Le mouvement anarchiste en France, Paris, Maspéro, 1975, 2 tomes.
Moreau G., Le syndicalisme, Paris, Marcel Rivière, 1925.
Mouriau R., La CGT, Paris, Seuil, 1982.
Pawlowski A., La Confédération générale du travail, Paris, Alcan, 1910.
Reynaud J.-D., Les syndicats en France, Paris, Seuil, 1975
Willard C (dir.), La France ouvrière, Paris, Editions sociales, 1993, 3 tomes.
Éducation et formation
Charlot B., Figeat M., Histoire de la formation des ouvriers, 1789-1984, Paris, Minerve, 1985.
Dommanget M., Les grands socialistes et l’éducation : de Platon à Lénine, Paris, A. Colin, 1970.
Foucambert J., L’école de Jules Ferry, Paris, Retz, 1986.
Mercier L., Les universités populaires, 1899-1914, Education populaire et mouvement ouvrier au début du siècle, Paris, Les Editions ouvrières, 1986.
Terrot N., Histoire de l’Education des adultes en France, Paris, Edilig, 1983.
[1] En écho à la célèbre formule de Fernand Pelloutier : “instruire pour révolter”, cf. infra. Ce texte est à paraître dans les actes du colloque “Syndicalisme et formation” organisé par la CEP-CRIEP (Paris X).
[2] Pierrot M., Syndicalisme et Révolution, Paris, Temps Nouveaux, 1905.
[3] Pierrot M., Syndicalisme et Révolution, op. cit., p. 10. Soulignons que cette brochure de propagande éducatrice contient un chapitre entier (pp. 25-29) intitulé : L’enseignement révolutionnaire.
[4] C.G.T.-S.R. : Confédération Générale du Travail – Syndicaliste Révolutionnaire fondée en 1926 suite au départ de la C.G.T.-U (Unifiée) de certains militants.
[5] Tristan F., Le Tour de France, journal inédit 1843-1844, Paris, La Tête de Feuilles, 1973, p. 76.
[6] Proudhon P.-J., De la capacité politique des classes ouvrières, Paris, Les Editions du Monde libertaire, 1977, t. 2, p. 335.
[7] Proudhon P.-J., Correspondance, t. 4, A. Lacroix et Cie éditeurs, Paris, 1875, Lettre à Charles Edmond,
p. 196.
[8] Dommanget M., Les grands socialistes et l’éducation, Paris, A. Colin, 1973, p.254.
[9] Ibid., p. 253.
[10] Ibid., p. 252, ici Maurice Dommanget cite Proudhon.
[11] Proudhon P.-J., De la capacité politique des classes ouvrières, op. cit., t. 2, p. 337.
[12] Ibid., p. 336.
[13] Ibid., p. 344.
[14] Ibid., p. 346.
[15] Ibid., p. 344.
[16] Ibid., p. 336. On remarquera l’aspect contemporain et la modernité de la pensée éducative de Proudhon tant en ce qui concerne l’éducation intégrale, qui par bien des aspects rappelle l’alterance, que par la nécessité d’une éducation permanente tout au long de la vie.
[17] Dolleans E., Histoire du mouvement ouvrier, Paris, A. Colin, 1957, t.1, p. 282 ; souligné par l’auteur.
[18] Proudhon P.-J., De la justice dans la révolution et dans l’Eglise, Paris, M. Rivière, 1932, t. 3, p. 86, cité par Jean Maitron in Le mouvement anarchiste en France, Paris, Maspéro, 1975, t. 2, p. 349.
[19] Expression empruntée à Jean Maitron in op., cit., t. 3, p. 330.
[20] Allusion au texte d’Emile Pouget : Le parti du travail, Paris, Editions CNT-RP, 1997.
[21] Dommanget M., op. cit., p. 248.
[22] Dolléans E., op. cit., t. 1 p. 304.
[23] Ibid., t. 1, p. 307.
[24] Guillaume J., L’internationale, documents et souvenirs, Genève, Ed. Grouauer, 1980, t. 1, p. 70.
[25] Terrot N., Histoire de la formation des adultes en France, Paris, Edilig, 1983, p. 48.
[26] Ibid., p. 52.
[27] Foucambert J., L’école de Jules Ferry, Paris, Retz, 1986, p. 53.
[28] Dolléans E., op. cit., t. 2, p. 14.
[29] Ibid., t. 2, pp. 18-19
[30] Reynaud J.-D., Les syndicats en France, Paris, Seuil, 1975, t. 1, p. 67.
[31] Dreyfus M., Histoire de la CGT, Bruxelles, Ed. Complexe, 1995, p. 22.
[32] Voir à ce propos, Coll, La Charte d’Amiens de 1906 à aujourd’hui, Volonté anarchiste n° 32-33, Paris, 1987.
[33] Mouriau R., La CGT, Paris, Seuil, 1982.
[34] Pelloutier F. (1er mai 1895), cité par Dolléans E., Histoire du mouvement ouvrier, Paris, A. Colin, 1957, en exergue de la première partie du tome 2.
[35] Idem, Pelloutier F., propos du 1er mai 1895 que l’on retrouve in Les syndicats en France, Paris, Librairie ouvrière, 1897, p. 15.
[36] Mouriau R., op. cit., p. 145.
[37] Pelloutier F., L’ouvrier des deux mondes, n° 15, mai, 1898.
[38] Pelloutier F., Histoire des Bourses du Travail, Paris, Gordon et Breach, 1971, p. 190.
[39] Ibid., pp. 197-198. Ce qui renvoie et confirme le refus de parvenir largement partagé par les syndicalistes d’alors.
[40] Leroy M., La coutume ouvrière, Paris, Giard et Brière, 1913, p. 434.
[41] Ibid., p. 435.
[42] Ibid., p. 436.
[43] Pelloutier F. , op. cit., p. 192.
[44] Ibid., p. 198.
[45] Dreyfus M., op. cit., pp. 28-29.
[46] Pelloutier F., op. cit. p. 141.
[47] Ibid., pp. 191-192.
[48] Voir Dreyfus M., op. cit., p. 31 et Willard C (dir.), La France ouvrière, Pairs, Editions sociales/Editions de l’Atelier, 1993, t. 1, pp. 279-280.
[49] Terrot N., op. cit., p. 147.
[50] Pelloutier F., op. cit., p. 178.
[51] Dufour (?), Le syndicalisme et la prochaine Révolution, Paris, M. Rivière, 1913, p. 147.
[52] Dolleans E., op. cit., t. 2, p. 37.
[53] Bron J. Histoire du mouvement ouvrier français, Paris, Les Editions ouvrières, t. 2, p. 58.
[54] Pelloutier F., L’enseignement social : le musée du travail paru in L’ouvrier des deux mondes, n° 14, avril 1898, cité par Juillard J. : Fernand Pelloutier et les origines du syndicalisme d’action directe, Paris, Seuil, 1971, p. 500.
[55] Pelloutier cite ici l’administrateur de la Bourse de Saint-Etienne (1899).
[56] Pelloutier F., Histoire des Bourses du Travail, op. cit., pp. 198-199.
[57] Juillard J., op. cit., p. 247.
[58] Nous ne ferons allusion à Jouhaux que dans sa première période, celle où il se revendique du syndicalisme révolutionnaire.
[59] Pouget E., La confédération générale du travail suivi de Le parti du travail, Paris, Editions CNT, 1997,
p. 140
[60] Ibid., pp. 140-141.
[61] Pataud E., Pouget E., Comment nous ferons la Révolution, Paris, Editions Syllepse, 1995, p. 136.
[62] Ibid., p. 136.
[63] Méric V., Comment on fera la Révolution ? Paris, Les Hommes du jour, s.d., p. 30.
[64] Lorulot A., Yvetot G., Le syndicalisme et la transformation sociale, Paris, Librairie internationaliste, 1909, p. 15. Cette brochure reprend une série d’articles parus dans Le libertaire en 1905 reflétant le débat dans le milieu anarchiste sur la place du syndicalisme.
[65] Delesalle P., La Confédération Générale du Travail, Paris, La Publication sociale, 1907, p. 9.
[66] Pawlowski A., La Confédération Générale du Travail, Paris, Alcan, 1910, p. 95.
[67] Jouhaux L., Notre Syndicalisme, Paris, La Publication sociale, 1912, p. 8.
[68] Ibid., p. 6.
[69] Yvetot G., A.B.C. syndicaliste, suppl. Espoir-CNT, n° 826, s.d., p. 28.
[70] Clément L., L’éducation de l’enfant : idée d’une école modèle dans chaque centre ouvrier sous le patronage des syndicats révolutionnaires, Paris, Temps nouveaux, s.d.
[71] Ibid., p. 1.
[72] Ibid., p. 7.
[73] Dommanget M., op. cit., p. 411.
[74] Keufer A., L’éducation syndicale, Paris, Imprimerie nouvelle, 1910, p.5.
[75] Ibid., p. 16.
[76] Ibid., p. 17.
[77] Terrot N., op. cit., p. 149.
[78] Ibid., p. 134.
[79] Mercier L., Les universités populaires, 1899-1914, Education populaire et mouvement ouvrier au début du siècle, Paris, Editions ouvrières, 1986, p. 53.
[80] Charlot B., Figeat M., Histoire de la formation des ouvriers, 1789-1984, Paris, Minerve, 1985, p. 137.
[81] Juillard J., Autonomie ouvrière, études sur le syndicalisme d’action directe, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1988, p. 32.
[82] Lagardelle H., Le socialisme ouvrier (1911), p. 379, cité par Cazalis E. in Syndicalisme ouvrier et évolution sociale, Paris, M. Rivière, 1925, pp. 81-82.
[83] Expression empruntée à Albert Thierry cité par Maurice Dommanget in op. cit., p. 402.
[84] Terrot N., op. cit., p. 179.
[85] Charte de Lyon, renéotée, supplément à Solidarité ouvrière, n° 50, publiée par l’Alliance syndicaliste, s.d.
[86] Charte du Syndicalisme révolutionnaire dite charte de Paris (1946), Paris, Ed. CNT, 1978, p.8.
[87] Allusion à Besnard P., Le monde nouveau, organisation d’une société anarchiste, édité par le groupe de Fresns-Antony de la Fédération anarchiste, 4ème édition, s.d.
[88] Besnard P., Les syndicats ouvriers et la Révolution sociale, Editions le Monde Nouveau, Besançon (?), 1978, p. 320.
[89] Ibid., pp. 327-328.
[90] Besnard P., L’éthique du syndicalisme, Paris, Ed. CNT-RP, 1990, p. 46. Il s’agit bien ici de formation dans l’esprit “syndicaliste” et non de la formation exclusive des syndicalistes
[91] Ibid., pp. 50-51.
[92] Collectif Equipo Juvenal Confederal, La collectivité de Calanda, Ed. CNT-RP, 1997, pp. 28-29.
[93] Pierrot M., Syndicalisme et Révolution, Paris, Temps Nouveaux, 1905, p. 34, note 2. Cette brochure contient un chapitre dont le titre est L’écaducation révolutionnaire, pp. 25-29.
[94] Cité par Hess R. Weigand G., La relation pédagogique, Paris, A. Colin, 1994, p. 65.
[95] Pierrot M., op. cit., p. 27.
[96] Ibid., p. 31.
[97] Ibid., p. 31.